DE CAYENNE AUX ANDES,
PAR M. JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE FRANCAISE.
1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.
PREMIERE PARTIE. — EXPLORATION DE L'OYAPOCK ET DU PAROU.
I
Je n'ai pas fini que je veux recommencer. — J'écris mon premier voyage en commençant le second. — Demerara; sauvages en ville — Cayenne; personne au rendez-vous. — Promenade à Surinam à la recherche d'un équipage. — Ville sous l'eau.— Le pied d'éléphant — Gymnote électrique. Retour dans le Maroni. — Apatou retrouve. — Doutes sur la fameuse lanterne du fulgor. — Au clair de la lune. — Vieilles gravures et vieilles poteries. — Grenouilles prises Pour des hommes. — Départ pour l'Oyapock.
Je ne suis pas arrivé au terme de mon premier voyage que j'ai déjà conçu le projet d'une deuxième exploration.
Après avoir parcouru le Maroni et le Yary, il faut, pour compléter ma carte, explorer la chaîne de partage des eaux entre l'Oyapock et 1'Amazone, et descendre le Parou, un des plus grands cours d'eau de la Guyane absolument inconnu des géographes.
Arrivé en France à la fin de décembre, 1877, j'obtiens un conge de convalescence de six mois pour anémie profonde. Apres trois mois de malaise, ma constitution se relève rapidement, et, sans avoir pris de quinine, les accès de fièvre deviennent très rares.
Je rédige rapidement mes rapports, fais dresser mes cartes, et le 7 juillet 1878 je m'embarque à Saint-Nazaire, à bord d'un vapeur de la Compagnie transatlantique.
La relation de mon voyage destinée au Tour du Monde n'étant pas terminée, je l'achève en route et l'expédie depuis la Guyane anglaise. Pendant mon séjour à Demerara je fais connaissance d'un voyageur anglais, E. im Thurn, qui me présente une bande d'Indiens Macusis qu'il vient de ramener du haut Essequibo.
Grâce à cet aimable collègue je puis me procurer un grand nombre d'objets ethnographiques et prendre la photographie de ces types qui sont absolument semblables aux Indiens Roucouyennes. Entre autres objets que je n'avais pas vus dans le Yary, je trouve des sarbacanes et des souliers. Les sarbacanes, qui sont absolument semblables à celles des Indiens du haut Amazone, servent à projeter de petites flèches empoisonnées par une espèce de curare que Schomburgk a vu fabriquer avec le strychnos toxifera. Les souliers, dont la semelle a entaillée dans une spathe de miritis, servent à protéger les pieds à travers des savanes où le sol est principalement compose de minerai de fer.
Le 28 juillet 1878 je débarque pour la quatrième fois sur le sol de la Guyane française.
Mes deux noirs, le brave Apatou aussi bien que le peureux Joseph, qui m'avaient accompagne au premier voyage, ne sont pas au rendez-vous. Je ne trouve que mon petit domestique hindou, Sababodi, que j'avais envoyé pour cause de maladie.
Mgr Emonet et le P. Kroenner, revenus mourants du pays des Bonis, ont définitivement renoncé aux voyages.
Devant l'impossibilité de recruter un seul homme d'équipage à Cayenne, je pars le 3 août pour Surinam ou Paramaribo, chef-lieu de la Guyane hollandaise.
Je ne suis pas tout à fait seul dans ce voyage; Sababodi, revêtu d'un turban et d'une ceinture rouge qu'il a choisis dans ma pacotille, me sert d'escorte.
En route je fais connaissance de deux Français qui ont abandonné le boulevard parisien pour le métier de chercheurs d'or. Nous descendons tous trois à l'unique hôtel de la capitale de la Guyane hollandaise.
Nous devons partager la seule chambre et le seul lit qui sont réservés aux voyageurs. Ayant une heureuse idée d'apporter chacun notre hamac, nous laissons le lit à la disposition des puces que nous ne voulons pas déranger.
Paramaribo est une petite ville proprette (je ne parle pas de l'hôtellerie), remarquable par ses maisons blanches et pointues, alignées dans un terrain plat, sur la rive gauche de la rivière de Surinam. On se demande pourquoi on a bâti cette ville sur un sol qui est au-dessous du niveau des grandes eaux; les Hollandais ont sans doute choisi ce terrain pour montrer leur talent à faire des digues, des jetées, à creuser des canaux d'irrigation.
Paramaribo, malgré sa mauvaise situation, jouit d'une salubrité qui ne cède en rien à celle de Cayenne, située pourtant sur un sol plus élevé, avec l'avantage d'être ventile par la brise de mer.
Les créoles de la colonie hollandaise sont très aimables pour les voyageurs ; je ne leur fais qu'un reproche, c'est d'avoir conservé, sous un soleil riant et une folle végétation, le caractère froid et mélancolique des peuples du Nord.
Une grande partie de la population blanche est composée d'Israélites. On dit qu'ils se sont portes en masse sur cette colonie plutôt que sur d'autres pour cause du peu d'aptitude qu'ils ont pour la navigation. C'est que la Guyane est la moins éloignée des possessions hollandaises. Les descendants hébreux paraissent supporter assez bien les climats chauds. Un médecin israélite qui nous a fait les honneurs de sa ville natale nous a présenté cinq frères ou sœurs et ses parents qui jouissaient d'une parfaite sauté.
Secondé par l'obligeance de M. le gouverneur Van Suypesteyn, j'espérais recruter un équipage de nègres Bosh ou Youcas provenant de la rivière Tapanahoni. Ces sauvages sont plus difficiles à conduire que les noirs élégants, aux souliers vernis, à la cravate rouge, qui se promènent sur le quai, mais au moins ont-ils l'avantage d'être très habiles à diriger les canots au milieu des chutes sans nombre des rivières de la Guyane. A défaut de nègres des bois, je choisis quatre noirs de la ville, non pas parmi les plus vertueux, car je n'ai pas de renseignements sur leur moralité, mais parmi les plus solides. Je les enrôle à raison de cinq francs par jour, tous frais payes.
En passant la revue de mon équipage je remarque que les noirs civilises marchent les pieds en dehors, tandis que les nègres Youcas et Bonis ont les pieds presque parallèles comme les sauvages de l'Amérique du Sud. Cette différence provient sans doute de la difficulté de progression dans la forêt : l'étroitesse des passages force souvent le marcheur à mettre le pied gauche sur la piste qu'il a frayée du pied droit. Les maîtres de danse et d’escrime qui marchent affreusement en dehors pourraient redresser leurs pieds en faisant des excursions dans les forêts vierges d'Amérique.
J'attends avec impatience une occasion pour retourner à la Guyane française. Je suis désolé d'apprendre que la goélette qui fait le service de la poste entre Paramaribo et le Maroni vient de se perdre corps et biens près de l'embouchure de la rivière de Surinam; heureusement le gouverneur à l'idée de remplacer ce voilier par un vapeur de guerre qui partira dans quelques jours. J'occupe mes loisirs visiter l'hôpital, la petite ménagerie du gouvernement, et à causer avec un ingénieur, M. Van Rosenvelt, qui faisait partie de la commission franco-hollandaise qui a remonte le Maroni en 1861. Cet aimable vieillard a supporte vaillamment près de trente alludes de séjour à la Guyane : il me donne des indications intéressantes sur le pays. Entre autres choses il me communique des reproductions de gravures qu'il a trouvées sur des roches de la rivière Correnthyne qui sert de limite entre les Guyanes anglaise et hollandaise. Une de ces gravures représente la tête d'un chef recouverte d'une couronne de plumes.
A l'hôpital je suis frappe du grand nombre d'éléphantiasis que l’on remarque chez les noirs, les mulâtres et quelquefois chez des blancs. On sait que cette maladie est caractérisée par un développement prodigieux du tissu cellulaire qui donne au pied la forme et l'aspect d'un pied d'éléphant. De là son nom.
Cette infirmité étant incurable, les jeunes personnes préfèrent l'amputation à la conservation d'un membre hideux et presque inutile à la marche.
En visitant l'hôpital je vois une jeune et jolie mulâtresse
qui sollicite une amputation de la cuisse.
Je lui fais observer que l'opération est très dangereuse; elle nous montre alors
un grand linge blanc qu'elle apporte sous le bras. C'est un linceul pour l’ensevelir
en cas d'insuccès. Il est à noter que le mal s'arrête court après l'ablation,
et que la plaie souvent pratiquée au milieu de tissus déjà malades guérit souvent
par première intention.
Nous avons su depuis que cette malheureuse jeune fille avait pu marcher avec
un appareil de prothèse dix jours après l'amputation.
J'ai beaucoup de plaisir à observer la petite ménagerie
que M. Van Suypesteyn entretient dans le jardin du gouvernement. Le jeune Sababodi
passe son temps à imiter le cri du hoco, de l'agami qui se promènent en liberté
dans un petit parc. Un jour, le gardien nous montre un poisson noir ayant la
forme d'une anguille qui court en serpentant dans un petit vivier.
Je reconnais un gymnote électrique, mais Sababodi qui n'en a jamais vu se laisse
prendre au piège que le cicérone hollandais présente aux visiteurs; ayant touché
l'animal avec une baguette de fusil en fer, il éprouve une secousse qui le fait
tomber à la renverse.
Le 10 août j'embarque à bord de l'aviso de guerre qui se dirige sur le Maroni. Le trajet entre Paramaribo et Saint-Laurent du Maroni pourrait se faire en douze heures, mais, le navire devant faire de l'hydrographie, nous restons quatre jours en route. Il est inutile de dire que malgré l'accueil sympathique des officiers je ne m'amuse pas beaucoup à voir faire des sondages pendant trois jours en vue de la bouche du Maroni.
Les Hollandais ont intérêt à bien connaître cette partie de la côte parce que les navires arrivant d'Europe pour Surinam sont obliges d'atterrir en cette région. C'est que toute la cote des Guyanes anglaise et hollandaise est si basse que le navigateur n'y trouve pas un seul point de repère pour reconnaître sa position depuis la haute mer.
En débarquant au pénitencier de Saint-Laurent j'apprends
qu'Apatou est arrivé depuis quelques jours, mais il est malade à l'hôpital
pour une maladie interne et une plaie du pied qu'il a contractée en descendant
le Maroni.
Il est découragé et ne manifeste pas grande envie de s'aventurer dans une nouvelle
expédition. Par contre, sa soeur, une belle enfant du plus beau noir, veut m'accompagner
à tout prix.
Enfin l'amour des voyages revient chez mon ancien compagnon
en même temps que la santé; il se décide, mais à une condition, c'est que je
le conduirai en France après mon voyage : Tu as vu mon pays, me dit-il, je veux
voir le tien.
Malheureusement je ne puis emmener sa soeur de peur de jeter une pomme de discorde
dans mon camp.
Je console la belle Ayouba en lui offrant un joli collier de corail que je m'étais
procure à son intention à l'Exposition universelle de 1878.
Pendant qu'Apatou achève de se guérir je vais faire une excursion à la recherche d'une roche granitique qu'on dit couverte de gravures faites par les anciens habitants du Maroni.
Je fais cette excursion avec deux collègues de la marine
française et un négociant, M. Tollinche, qui habite le Maroni depuis de très
longues années, et veut bien nous servir de guide pour rechercher une roche
que de nombreux officiers sont allés voir sans jamais la trouver.
Partis vers trois heures de l'après-midi, nous arrivons vers sept heures du
soir à l’île Portal, qui est habitée par les quatre frères Bard depuis une vingtaine
d'années.
Apres un repas copieux, nous restons à causer et à fumer,
jusque vers onze heures du soir en attendant la marée descendants. La conversation
de l’aîné des frères Bard est particulièrement intéressante parce qu'en outre
de l'agriculture il s'occupe de faire des collections scientifiques qu'il s'empresse
de nous montrer.
Il nous fait voir une belle collection de papillons
et quelques autres insectes curieux parmi lesquels je cite le fulgor porte-lanterne,
trouvé pour la première fois dans 1'Oyapock par une intrépide Hollandaise, Mlle
de Merian, qui a paye de la vie son amour pour la science. Elle a raconte que
cet insecte donne une lumière suffisante pour permettre de dessiner.
Ce fait a été mis en doute pendant ces dernières années par un certain nombre
de voyageurs.
Les frères Bard, pas plus que nous-même, n'ont jamais eu l'occasion de
vérifier l'assertion de Mlle de Merian [1].
Nous nous mettons en route vers onze heures du soir.
La lune est pleine, le ciel est d'une sérénité parfaite, un de mes collègues
entonne une chanson et nous voguons gaiement sur les eaux calmes de ce beau
fleuve.
A minuit nous apercevons à la hauteur de l'île Portal, et tout prés de la rive
hollandaise, une roche granitique mamelonnée qui émerge d'une hauteur d'environ
un mètre cinquante. Sautant à terre le premier, je mets la main sur une excavation
qui n'est autre qu'un polissoir où les anciens aiguisaient leurs haches de pierre.
Au même moment, Saba, joyeux, reconnaît des traits graves dans la roche. Nous
apercevons bientôt deux autres gravures qui représentent l'une un homme, l'autre
un animal fantastique.
Ces dessins, ou plutôt ces ébauches enfantines,
sont creusées dans la roche à une profondeur d'un centimètre sur une longueur
de plus d'un mètre.
Nous mettant tous l'oeuvre, nous prenons rapidement le moulage de ces empreintes,
et, satisfaits de notre résultat, nous soupons sur cette roche que les Galibis
appellent Tineri.
Nous arrivons à midi très fatigués, mais enchantés de
cette promenade nocturne qui n'avait pas été sans résultat pour la science.
M. Melinon, directeur du pénitencier de Saint-Laurent, m'offre un débris de
poterie sur lequel on reconnaît l’image grossière d'un saurien. Cet objet, trouve
à une profondeur de plus d'un mètre dans un petit affluent de la crique Siparini,
à cote d'une hache en pierre qui m'est également donnée par un collègue, est
peut-être aussi ancien que les gravures que nous venons d'examiner.
Le géologue Brown, qui a trouve un grand nombre de gravures
sur les roches de l'Essequibo et du Correnthyne, les considère comme les vestiges
d'une civilisation beaucoup plus avancée que celles des Indiens actuels.
Nous ne partageons pas cette manière de voir, puisque une étude comparative
entre les dessins anciens et modernes des indigènes de la Guyane ne nous permet
pas de constater de différence.
Les dessins de grenouilles que Brown a trouves dans 1'Essequibo
ne sont autres que des images humaines telles que les Galibis, les Roucouyennes
et les Oyampys en représentent journellement sur leurs pagaras, leurs poteries
ou sur leur peau.
Nous avons cru nous-même, en examinant ces figures aux jambes et aux bras écartes,
qu'il s'agissait de grenouilles, mais les Indiens nous ont tous dit que c'était
leur manière de représenter l'homme.
On se demande quels ont été les instruments qui ont servi à l'exécution de ces
gravures. Brown pense qu'ils ont employé des stylets de fer ou la pointe d'un
bâton trempée dans le sable mouille.
Nous croyons que ces dessins ont été exécutes de la même
façon que les polissoirs qui se trouvaient à côté. C'est simplement par le frottement
de pierre contre pierre.
On doit se faire une autre question :
Quelle est la signification de ces dessins ?
Il y a lieu de supposer qu'ils ont été exécutés avec une intention religieuse.
Les Indiens actuels ne partent jamais en voyage ou en guerre sans se couvrir
le corps de peintures qui ont pour but, disent-ils, de chasser les diables qui
pourraient les faire mourir.
Ces peintures étant absolument semblables à ces anciennes gravures, on peut
croire que les unes et les autres ont la même signification.
Avant de partir pour Cayenne je fais encore une excursion
chez les Indiens Galibis dans le but de faire des études anthropologiques et
ethnographiques.
Je remarque que ces indigènes de la côte ressemblent à s'y méprendre à tous
les Indiens que nous avons rencontrés dans les Guyanes française, hollandaise,
anglaise et brésilienne.
Je m'embarque le 15 avril à bord d'un aviso français qui me conduit à Cayenne
avec mon équipage et deux jolies pirogues fabriquées par les négres Bonis.
Arrive à Cayenne j'apprends que le gouverneur va faire une excursion dans l'Oyapock dans cinq ou six jours; c'est juste le temps nécessaire pour faire mes préparatifs de départ et permettre à Apatou d'achever sa guérison. Sur ces entrefaites je vois arriver le noir Joseph et son beau-frère qui viennent m'offrir leurs services, mais je suis oblige de les refuser parce qu'ils ont l'audace de me demander une solde de cinq cents francs par mois.
Je m'occupe de mes derniers achats, je fais calfater mes pirogues et je m'embarque le 21 avec M. le gouverneur Huart, M. le directeur de l'intérieur Quintrio et plusieurs autorités du pays qui se montrent très sympathiques au succès de ma mission.
II
Nom trompeur d'une montagne. — Hiéroglyphes indiens pris pour tin monument de la conquête. —Salut de la nature. — Pas d'entrain — Loin du faste et des grandeurs. — Dieu au milieu de ses oeuvres. — En route! — Le malheur de l'un sert à l'autre. — Première nuit en campagne. — Bales dans les tours d'eau de la Guyane. — Les avant-coureurs des chutes. — Une ruine historique. — Jacques ou le Robinson français. — Le pataoua des Indiens Oyampys. — Un astre qui nous persécute. — Une prouesse de chasse. — Divers modes de sépulture. — Une terrible épreuve des jeunes piays. — Bacoves.
Le 22 au matin nous apercevons la montagne d'Argent,
ainsi nommée parce qu'on y voit en abondance un arbre à tige fistuleuse appelé
bois canon, dont l'écorce et les feuilles ont des reflets blanc argenté.
Cette éminence, connue de tons les navigateurs français parce qu'elle est un
point de repère excellent pour atterrir, était naguère occupée par une colonie
pénitentiaire qui produisait un café très reputé.
Une soeur de Cayenne à qui j'ai montre les gravures des anciens Indiens du Maroni
m'a dit avoir trouvé des dessins semblables sur des roches de la montagne d'Argent.
C'est sans doute une de ces pierres qui a si fort intrigue les Portugais lorsqu'ils cherchaient des arguments pour faire valoir leurs droits sur le territoire compris entre l'Amazone et l'Oyapock.
Nous doublons bientôt la terre basse du cap d'orange
et nous entrons dans l'Oyapock.
La nature semble avoir fait des frais pour nous recevoir.
Des milliers d'aigrettes au plumage blanc et au panache de colonel, des ibis
rouge de feu, se déplacent devant le navire. Plus loin, ce sont des compagnies
de ravissantes perruches vertes qui traversent la rivière.
Nous échouons en remontant le fleuve, et pourtant le
capitaine du navire, M. Cony, est l'auteur d'un travail hydrographique depuis
la bouche jusqu'au pénitencier de Saint-Georges; c'est que le pilote nous fait
passer en dehors du chenal sous prétexte qu'un banc de sable s'est déplace depuis
les derniers sondages.
Cette erreur qui nous fait perdre un jour donne aux officiers l'occasion d'aller
tirer des perruches postes sur des arbres le long des rives.
Je reste à bord ainsi qu'Apatou. Mon compagnon, qui n'est pas encore complètement guéri, ne montre pas beaucoup d'entrain; il est inquiet, non seulement sur sa santé, mais sur l'attitude que vont prendre avec nous les Indiens Oyampys qui ont fait longtemps la guerre avec les gens de sa tribu. Pour ma part, je ne suis pas sans inquiétude sur le succès de ma mission ; c'est qu'un de mes collègues que je viens de voir à Cayenne m'a raconte que ce fleuve était très malsain en ce moment ; huit jours d'excursion dans le bas de la rivière l'ont rendu si malade, lui et deux gendarmes qui l'accompagnaient, qu'ils sont arrives à Cayenne dans un état d'anémie profonde après une absence qui n'avait pas duré plus de quinze jours.
Je ne saurais prendre assez de précautions pour éviter
cette affreuse fièvre qui menace de renverser tous mes projets. La connaissance
du danger me rend beaucoup moins audacieux qu'à mon premier voyage.
Nous arrivons devant le pénitencier de Saint-Georges le 24 août dans l'après-midi.
Le navire à peine mouillé, nous recevons une visite du R. P. Ledhui. C'est un
missionnaire simple, modeste, qu'on trouve dans tons les postes dangereux.
J'ai fait sa connaissance dans l'épidémie de fièvre jaune des lies du Salut,
et nous le retrouvons ici parce que le curé vient de succomber à la fièvre.
Le Père Dur-à-cuire, c'est ainsi que l'appellent les soldats, n'a ni
vin ni pain dans son presbytère, ou plutôt dans la hutte qui lui sert d'abri;
il vit de couac, de Poisson et de gibier comme ses humbles paroissiens.
Le lendemain nous assistons à une messe militaire dans
une église en chaume ouverte aux oiseaux qui viennent gazouiller autour de l'autel.
Ce temple au milieu des bois parait plus imposant que la plus élégante cathédrale
d'une grande ville.
Dans l'après-midi je fais débarquer les bagages et les pirogues et je tache de compléter un équipage, mais je me heurte à un contretemps désagréable : un chercheur d'or de Cayenne vient d'enrôler tous les hommes valides pour établir un placer dans le cirque Sikini.
Pendant qu'Apatou arrange les pirogues, je descends la
rivière pour aller m'entendre avec ce mineur.
Je le trouve occupe à réparer un canot qu'il a brisé quelques jours auparavant
en essayant de franchir la première chute. M. Bugeat ne peut me céder aucun
de ses hommes parce qu'il a besoin d'un grand nombre de bras pour lutter contre
la violence du courant; enfin, après avoir couru toute la journée, allant de
case en case à la recherche de pagayeurs, je trouve un vieillard et deux jeunes
Indiens que j'engage séance tenante et ramène à Saint-Georges avec moi.
Je fais un dîner d'adieu avec les officiers de l'aviso qui ont été pour moi
d'une amabilité parfaite. Nous buvons ensemble quelques bouteilles d'un vin
généreux qui m'ont été gracieusement envoyées par M. Guido Cora, directeur du
Cosmos de Turin.
Je dois partir le 26 au matin, mais voila que tous mes
hommes, Indiens et noirs, à l'exception des fidèles Apatou et Sababodi, sont
dans un tel état d'ivresse qu'il m'est impossible d'en rien faire.
Les deux jeunes Indiens ayant reçu quelques avances viennent de se sauver. Afin
de ne pas perdre le troisième je me décide à me mettre en route à quatre heures
du soir.
Pour entraîner mes hommes je fais tirer plusieurs coups de fusil en quittant
la jetée, et Apatou se met à chanter.
A quatre heures et demie nous rencontrons une pirogue
qui navigue vent arrière. La mature et la voilure sont composées de feuilles
de palmier disposées en éventail.
Une heure après, le patron nous indique prés de la rive gauche, dans un coude
de la rivière, des roches cachées sous l'eau sur lesquelles s'est perdu le vapeur
Eridan. Ce navire de guerre construit en fer s'étant ouvert la coque
contre ces roches a coulé à fond dans l'espace de quelques minutes.
Ce naufrage, qui a causé la disgrâce d'un gouverneur, a été une bonne fortune
pour les Indiens Oyampys; ils se sont servis de la carcasse pour faire des harpons.
Auparavant ils étaient obliges, comme les Roucouyennes, de se servir d'un os
taille en pointe (généralement un éclat de radius de couata) qu'ils attachaient
avec une ficelle goudronnée à l'extrémité d'un bois dur de manière à former
un crochet.
A la tombée de la nuit nous arrivons à une petite Ile
appelée Platnaré, on nous nous arrêtons pour coucher. La se trouve une petite
hutte on vivent quelques Indiens civilises. Ces gens n'ayant aucune nourriture
à nous procurer, nous commençons à attaquer nos conserves.
Apres un repas de boeuf sale arrose d'un coup de tafia, nous allons nous étendre
dans nos hamacs accrochés au poteau qui supporte la toiture. Je me console des
ennuis de la journée en fumant quelques cigarettes.
Le 27, je fais distribuer une ration de café à tout mon
équipage et nous nous mettons en route au lever du soleil.
Laissant le grand canot voguer tout soul, je vais reconnaître l'embouchure de
la crique Platnaré qui est un affluent de droite de l'Oyapock, navigable, dit-on,
à deux jours de canotage.
Une demi-heure après je découvre sur la même rive une
crique appelée Siparini, navigable à une demi-journée.
Nous devons remarquer que ce nom désigne un grand nombre de cours d'eau de la
Guyane. Il y a une crique Siparini dans le bas Maroni, une autre dans 1'Essequibo.
Dans la langue de tous les indigènes sipari signifie raie. Ce poisson,
qui est un objet de terreur pour les canotiers à cause des piqûres qu'il détermine,
est commun dans tons les cours d'eau appelées Siparini.
L'explorateur doit s'attacher à conserver les noms géographiques des indigènes, puisqu'ils ont toujours une signification.
Nous avançons lentement parce que nos canots sont trop
chargés et que mes noirs de Surinam savent à peine l'usage de la pagaye. Apatou
commande la grande pirogue, ayant avec lui trois négres et Saba.
L'embarcation que je monte, faite d'un petit tronc d'arbre ayant cinq mètres
de long sur soixante-quinze centimètres de large, devrait marcher très vite;
mais le vieil Indien qui me sert de patron n'a pas de force et le négre Stuart
qui est à l'avant fait son apprentissage de canotier. Ne sachant pas mesurer
ses coups de pagaye, il m'envoie à chaque instant de l'eau à la figure et sur
mes cahiers de notes.
Depuis le départ de Saint-Georges nous voyons les rives s'élever graduellement.
D'autre part des Iles nombreuses interceptent la rivière ; c'est autant de signes
qui prouvent que nous allons rencontrer des chutes.
Vers huit heures nous passons devant la petite île de Casfésoca sur laquelle s'élève une vieille tourelle qui serait effondrée depuis longtemps si elle n'était soutenue par des arbres et des lianes qui masquent complètement les pierres. Ce fort était occupe autrefois par un petit poste de soldats charges de défendre le bas Oyapock contre les négres Bonis, que l'on redoutait beaucoup à cause de la réputation guerrière qu'ils avaient acquise dans leurs luttes avec le pays de Surinam.
C'est la qu'un officier français à fait massacrer des hommes sans armes et des femmes de la tribu des Bonis qui venaient avec des intentions pacifiques.
Je console le fidèle Apatou, qui éprouve un sentiment de rage à la vue de cette tourelle, en lui disant que l'officier qui commandait le poste a été mis en disgrâce.
A la hauteur de cette île les rives forment des montagnes
élevées de cent cinquante mètres. C'est une petite chaîne parallèle à la cote
que l'Oyapock à du déchirer pour se frayer un passage.
Le noyau de la montagne étant forme de granit,le fleuve n'a pu le détruire complètement,
et son lit reste parsemé de grandes roches sur lesquelles l'eau court en formant
des rapides et des sauts.
C'est au milieu de la première chute de l'Oyapock que
se trouve une petite île qui a été habitée pendant de longues années par un
soldat du maréchal de Villars blesse à Malplaquet : il y menait la vie solitaire
d'un Robinson.
Cet homme était centenaire lorsqu'il fut rencontré par le célèbre Malouet, gouverneur
de la colonie.
L'île qu'habitait Jacques est appelée par les indigènes
actuels Ile Acajou, du nom d'un fruit jaune acide (anacardium occidentals),
qui est certainement originaire de l'Amérique du Sud, puisque les navigateurs
de l'époque de la conquête et les explorateurs modernes l'ont trouvé chez tous
les sauvages.
L'île Acajou est un point délicieux on les indigènes avaient l'habitude de passer
la nuit. On trouve sur les roches des rainures et des cavités ovalaires qui
ne sont autres que des polissoirs où les Oyampys aiguisaient leurs haches de
pierre.
Je conseille aux amateurs de belle nature de venir passer une nuit dans cette
Ile.
Le saut Robinson est l’équivalent d'Hermina qui commence la série des chutes et des rapides du Maroni.
Il est à remarquer que toutes les rivières des Guyanes
française, hollandaise et anglaise ne sont pas navigables en vapeur au delà
de quatre-vingts à cent kilomètres.
Elles sont interceptées par des roches granitiques qui ne permettent la navigation
qu'en embarcations légères sans quille ni gouvernail.
Un peu en amont du saut nous trouvons sur la rive gauche un petit affluent appelé Courmouri, qui signifie bambou. Les Indiens prenant la partie pour le tout désignent également par ce nom leurs flèches, terminé es par un morceau de bambou taille en lame de couteau, et avec lesquelles ils tuent le jaguar, le cabiai et même le tapir qui est pourtant un pachyderme.
Mes hommes éprouvent quelques difficultés à monter le
grand canot, mais M. Bugeat que nous avons la chance de rencontrer met son équipage
à ma disposition.
Dix hommes halant de toutes leurs forces sur une corde amarrée à l'avant le
font glisser avec rapidité sur les grandes roches mamelonnées qui barrent le
passage.
Un petit accident donne un peu de gaieté à mon équipage. Le noir Hopou, qui ne sait pas nager,ayant glissé sur une roche, est tombe au milieu du courant. Apatou qui l'aperçoit lui jette une corde et le retire comme un gros poisson suspendu à une ligne. Il a un air si piteux que tout mon équipage est pris d'un fou rire.
Nous déjeunons à l'île Acajou et continuons à passer
les sauts. Le soir nous campons sur des roches granitiques mamelonnées attenant
à la rive droite. Les noirs de Surinam qui sont fort irascibles se plaignent
amèrement de ce que je les fais toucher sur une roche ou il est impossible de
suspendre les hamacs, mais Apatou et le vieil Indien arrivent bientôt avec trois
arbres qu'ils ont ébranchés. Ils les amarrent par le sommet et les dressent
en faisceaux. Ces trois pieux ferment un triangle isocèle dont chaque coté peut
être occupe par un hamac.
Cet appareil employé journellement par les Oyampys s'appelle pataoua. Les
Indiens, qui sont pourtant fort paresseux, ne manquent jamais de le disposer
tous les soirs. C'est un surcroît de travail en arrivant au campement, mais
on évite ainsi toutes les bêtes qui sont capables d'incommoder le voyageur.
Apres avoir fait mes observations astronomiques je prends
un bain délicieux et partage mon dîner avec M. Bugeat.
Ne manquant de rien, nous buvons d'excellent vin, nous prenons d'excellent café
et voire même des liqueurs.
Apres ce repas nous allons fumer de bons cigares dans nos hamacs suspendus au
pataoua.
Nous avons bien soin de tourner le dos à la lune dont
les reflets argentes fatiguent la vue.
Les créoles de la Guyane, M. Bugeat est du nombre, redoutent autant les effets
de la lune que ceux du soleil; c'est pour cela que les bonnes d'enfants ne circulent
jamais le soir dans les rues de Cayenne sans tenir un large parapluie au-dessus
de la tête du nourrisson.
Je me réveille de mauvaise humeur au milieu de la nuit; c'est que cette affreuse
lune qui a marche quelques heures vient nous agacer la vue. Nous sommes obliges
de nous lever pour lui tourner le dos.
III
Mots français dérivant de l'oyampys. — Ancienne mission de Saint-Paul. — Un bal d'oiseaux. — Détail de toilette du singe hurleur — Son incapacité de faire des duos à lui tout seul. — Guérison du bégaiement. — Quelques mots sur les plantes — l'ordre du jour, le conguerecou et le carapa. — La saison des pluies se prolonge. — Un tamouchy de la tribu des Oyampys. — Costumes. — Vanitas vanitatum, amnia vanitas. — Le bois des arcs et la Ole du Paria.
28 août. — Dans la journée nous passons devant un affluent de droite assez important appelé Koricour.
Les rapides et les chutes se succèdent sans interruption; je suis forcé de descendre souvent sur les roches pour alléger mon embarcation. C'est une occasion pour Masser mes jambes engourdies et prendre des hauteurs de soleil avec mon théodolite; malheureusement la saison des pluies n'est pas complètement finie, et comme l'astre n'apparaît que par intervalles, il m'arrive des contretemps très désagréables.
Souvent il disparaît sous un gros nuage juste au moment on je mets dans la lunette. C'est une perte de travail d'un quart d'heure pour sortir mon instrument, le niveler et le rentrer.
Nous campons sur une Ile située au milieu du saut Nourououaca, célèbre par la mort d'un colon français,le comte de Bagotte, qui s'y est noyé en descendant le fleuve.
Nous sommes en face de la crique Aramontabo, affluent de gauche qui est navigable à plusieurs jours.
En arrivant à terre Sababodi me montre un animal qui est presque de la grosseur de la tête d'un enfant.
C'est le fameux crapaud géant que je vais tuer pour l'examiner à mon aise.
M'approchant pour ramasser ma proie, je sens une odeur qui me fait quitter la place au plus vite. Mon gibier qui paraissait prêt à sauter à l'eau à la moindre alerte est mort depuis quelques jours. Plusieurs trous à la peau ont laisse sortir les gaz qui gonflaient son abdomen et le faisaient paraître encore plus gros qu'il n'était en réalité.
Telle est la première impression de chasse. A mon voyage de 1877 je n'avais pas même emporte de fusil, mais cette fois j'ai l'intention de chasser, sinon pour mon plaisir, au moins pour subvenir l'alimentation.
Vers neuf heures nous arrivons à une île pittoresque occupée par deux huttes d'Indiens Oyampys.
J'apprends qu'elles viennent d'être abandonnées à la suite d'une épidémie qui a détruit la moitie des habitants. Mon patron, redoutant une maladie contagieuse, ne vent pas descendre à terre, mais le reste de l’equipage saute sur la rive. Les Indiens Oyampys ne brillent pas leurs morts comme les Roucouyennes, ils les enterrent dans un trou très profond, mais n'ayant pas plus d'un mètre de longueur. Le cadavre est place verticalement, les jambes, les bras et la tête fléchis comme le foetus dans le sein maternel.
Quelquefois ils le laissent se décomposer dans le bois, et ce n'est qu'au bout d'une année qu'ils ensevelissent les os dans un grand pot d'argile. Mgr Emonet m'a fait présent d'un de ces vases funéraires. La sépulture est toujours tardive chez les Indiens non civilises ; les Galibis conservent leurs morts pendant une semaine. Le cadavre est couche dans un hamac,au-dessous duquel se trouve un grand vase servant à recueillir le liquide qui s'écoule des chairs en décomposition, et, chose horrible à dire, qui pourtant a été vue par des négres Bonis, les futurs piays, c'est-à-dire les étudiants en médecine, sont obliges de prouver leur force de caractère en buvant une macération de feuilles de tabac et d'une Plante appelée quinquina, à laquelle on ajoute quelques gouttes de sanie cadavérique.
Mes hommes cueillent dans l'abatis des fruits d'acajou
et des papays qu'une bande de macaques étaient en train de dévorer. Ils trouvent
également un régime de petites bananes que les Oyampys appellent baco, et que
l'on désigne à Cayenne sous le nom de bacoves.
Beaucoup de mots usités non seulement dans les divers langages des créoles de
l'Amérique du Sud, mais dans toutes les langues européennes, n'ont pas d'autre
origine que la langue des sauvages de la Guyane et du Brasil.
Un peu plus loin nous trouvons un saut appelé Yacarécin.
Le yacare des Oyampys n'est autre que le crocodile d'Amérique que d'autres
Indiens appellent caiman.
Vers quatre heures nous arrivons à un long canal sans roches dirige vers le sud-ouest, oh le courant devient imperceptible, et nous ne tardons pas à gagner la crique Mouchiri à l'embouchure de laquelle nous passons la nuit.
Le 30, je fais une petite reconnaissance dans la crique
Mouchiri (voy. la carte, p. 35), et je prends une hauteur de soleil à l'embouchure
et continue ma route.
Vers neuf heures nous arrivons à une petite colline située sur la - rive gauche.
Les Jésuites y avaient établi la mission de Saint-Paul au siècle dernier.
On n'y voit plus de traces de culture ni de vestiges de construction. Une Croix
vermoulue est seule restée debout pour attester le passage de la civilisation.
Je remarque un assez grand nombre d'excavations allongées et disposées parallèlement. C'est l'ancien cimetière qui, d'après mon guide, aurait été saccagé par des Indiens venus des sources du Camopi; les misérables ont violé les tombes pour arracher aux squelettes quelques médailles et des crucifix oxydés.
A quatre cents mètres en amont du même mon Indien me
fait visiter une grande roche granitique située à une faible distance de la
rivière. On y trouve des excavations qui servent de repaire aux bêtes fauves.
C'est pour cette raison qu'elle est appelée Yauara-quara, ce qui vent
dire « antre du jaguar ».
Inutile de faire remarquer que le mot français jaguar vient du mot oyampys yauar.
Nous dormons sur les roches Tacouenda, ainsi nommées
àcause d'un banc de sable situé en aval qui sert de place de danse aux aigrettes.
Les Indiens qui prêtent de l'esprit aux bêtes, puisqu'ils admettent qu'elles
ont des piays aussi bien qu'eux, reconnaissent des jours de fête pour les oiseaux.
Il pleut toute la nuit; il nous est impossible déformer
l'oeil, étant incommodes non seulement par l'eau, mais par des nuées de moustiques
et les beuglements des alouates ou singes hurleurs.
Je me suis trop avancé en disant que le bruit épouvantable que l'on entend journellement
dans les forêts des Guyanes était produit par un seul hurleur qui chantait en
se promenant pendant que les autres restaient immobiles et muets. Apatou prétend
que sur une bande de dix singes il y en a toujours deux qui se promènent en
chantant; ce sont deux males, le plus gros et le plus petit de la troupe. Il
soutient que le gros fait la basse et le petit le chant.
Ce dernier se distingue non seulement par sa voix fluttée, mais par son pelage
qui est plus fonce. Un fait qui étonne les Bonis, c'est que le petit chanteur
à souvent la chair aussi coriace que le chef de la bande.
Nous ne sommes pas loin de croire qu'il s'agit d'une espèce différente[2].
Les négres marrons du Maroni ne tuent jamais un singe hurleur sans lui enlever le larynx. Ils font avec la grande Cavite qui est creusée dans l'os hyoide une coupe destinée à la guérison du bégaiement. Au dire d'Apatou, à qui je laisse la responsabilité de la recette, les enfants bègues ne manquent pas d'être guéris après avoir bu quelques mois dans l'appareil vocal du singe rouge.
31 août - Nous arrivons à huit heures devant la crique Ouaracoucin, qui porte le nom d'un petit poisson.
A trois kilomètres plus haut, nous rencontrons sur la rive droite la crique Anotaye, qui, dit-on, est navigable à une assez grande distance. On trouve à l'embouchure près de la rive droite une petite Ile qui peut la faire reconnaître ; elle se dirige vers l’est, puis vers le sud-est. Au tournant se trouve une montagne granitique. Il est à noter qu'on trouve des montagnes à l'embouchure de presque toutes les criques importantes des rivières de la Guyane.
Depuis le matin nous trouvons le courant très rapide: cela tient non seulement à un rétrécissement du fleuve, mais aux pluies des jours précédents; nous en avons une preuve puisque des pataouas qui naguère étaient à sec sont immerges sur une hauteur d'un mètre. Les pagayes ne suffisant pas pour avancer, nous sommes obliges de nous servir de longues perches que les Indiens appellent tacaris. Lorsque le lit est trop profond, nous ne pouvons remonter qu'en nous accrochant aux branches qui bordent la rivière.
Parmi les arbres que nous voyons en passant nous reconnaissons
le conguérecou (xylopia frutescens) et le carapa.
Le premier, dont la taille n'est pas élevée, forme des buissons aux feuilles
fixes ayant une forte odeur de poivre. Cette plante n'est pas nouvelle pour
nous, puisque nous l'avons rapportée en France en 1869.
M. Oury, qui la cultivait, lui attribuait une action analogue au poivre de copahu.
C'est ce que nous avons pu constater nous-même en expérimentant les graines
desséchées et moulues comme du poivre.
Le congudrecou est actuellement employé dans la thérapeutique française.
Le carapa donne un gros fruit rond rempli de graines
qui fournissent une huile dont les Indiens se servent pour se peindre avec le
roucou, et pour chasser les chiques et les tiques.
Cet arbre, que l'industrie recherche pour faire de l'huile, ne parait pas assez
nombreux dans l'Oyapock pour en faire l'exploitation sur une grande échelle.
Apatou me dit que le carapa qui existe par toute la Guyane est plus commun dans
les terrains marécageux.
II l'a vu dans l'île qui se trouve en face de l'ancien pénitencier de Saint-Louis
et dans l'île Portal.
Il est particulièrement très abondant dans un affluent de droite de la rivière
de Surinam, la crique Caouina, dont les eaux sont aussi noires que celles
de l'Ana, affluent du bas Maroni, et du rio Negro lui-même.
Les sources de la Caouina sont voisines de la rivière
de Paramaca. Les noirs du même nom fuyant les Hollandais ont remonte la Caouina
et ont atteint les sources de la rivière Paramaca, qu'ils ont ainsi nommée du
nom d'un petit palmier qui leur a sauve la vie en leur fournissant ses fruits.
Les graines de carapa commencent à tomber au commencement de la saison sèche,
c'est-à-dire vers la fin de juillet. Les Indiens se les disputent avec les pakiras
et les agoutis qui en sont très friands.
Les Roucouyennes gardent ces graines pendant une année en les enterrant dans
la terre, c'est-à-dire en faisant de véritables silos comparables à ceux des
Arabes. Si l'on ne prend pas cette précaution, elles ne se conservent pas au
delà de trois semaines à un mois.
Pour obtenir l'huile de carapa les Oyampys font cuire les graines et les abandonnent
pendant quelques semaines dans un tronc d'arbre évidé. Ensuite on les écrase
avec les pieds et on verse la pulpe sur une spathe de palmier qu'on expose au
soleil et qu'on incline légèrement pour que l'huile s'égoutte dans un autre
récipient.
On obtient moins d'huile qu'en exprimant, mais elle est d'une limpidité parfaite
et Presque blanche.
Nous dormons dans le bois un peu au-dessus de la crique
Yacareitapoucan, qui signifie front de caïman.
Le grand canot restant en arrière je serais oblige de dormir sans souper si
je n'étais rejoint par M. Bugeat qui vient de tuer un magnifique tapir.
N'ayant pas de hamac je dors sur la terre avec une petite couverture que je partage avec un de mes noirs. Nous sommes abrités de la pluie par un ajoupa,c'est-à-dire une tente fabriquée en feuilles de palmier.
1er septembre - Arrivé un peu avant midi à une petite
île granitique, je m'efforce en vain de sortir mon théodolite de sa boite gonflée
par l'humidité.
Je suis furieux de ne pouvoir prendre la méridienne,lorsque j'aperçois plusieurs
embarcations à l'horizon.
C'est, me dit le patron, le tamouchy Jean-Pierre et son frere Alicolé.
Ces Indiens, qui sont pourtant nos frères en Jésus-Christ,
puisqu'ils ont été baptisés par Mgr Emonet, n'ont pour vêtement d'étoffe qu'un
couyou, c'est-à-dire un petit morceau de linge. Le reste de leur costume
consiste en une couche de peinture rouge entremêlée d'arabesques noires qui
les recouvre comme un maillot d'arlequin des pieds à la tête.
C'est une splendide occasion pour inviter M. Bugeat à dîner. J'ouvre une boite
de boeuf sale (cornedbeef), j'en prends une part, et je distribue le
reste l'équipage. M. Bugeat me fait remarquer que Jean-Pierre ne mange pas et
parait faire la moue. C'est qu'il est froissé de ne pas s'asseoir à coté du
chef blanc.
M'étant empressé de l'inviter, je vois la figure aux
joues larges, aux pommettes saillantes et au nez aquilin s'épanouir subitement.
Ce rayon d'orgueil que je viens de voir transpirer chez ce sauvage est une lueur
d'espérance pour le succès de mon entreprise. Sachant que la vanité est la corde
sensible de Jean-Pierre, je suis sûr d'arriver à mes fins : je conduirai le
chef des Oyampys comme un enfant; il faudra qu'il me donne un équipage, il faudra
qu'il m'accompagne lui-même jusqu'aux sources de l'Oyapock.
Au dessert, qui se compose d'une galette de biscuit, j'invite le capitaine Jean-Pierre
— c'est ainsi que je l'appelle— à s'en retourner jusqu'a son village. C'est
là que je lui montrerai les cadeaux que je lui destine s'il veut m'accompagner
jusqu'aux sources de l'Oyapock.
Quelques instants après nous passons devant une petite crique appelée Païrapiki.
Le mot païra désigne l'arc des sauvages et le bois très dur dans il est
composé.
Cet affluent est ainsi nomme parce qu'on y trouve du
bois d'art que les créoles de Cayenne appellent bois de lètre, et les naturalistes
Amanoaguianensis.
La côte du Paria, la première terre du continent américain qui fut découverte
par Christophe Colomb, doit son nom à ce que les indigènes y trouvaient le bois
qui sert à la fabrication des arcs.
Nous tampons dans la foret en face de la crique Ménoura, en amont d'un
saut qui est prés de l'embouchure de ce petit affluent de droite.
Docteur J. CREVAUX
(La suite à la prochaine livraison.)
DE CAYENNE AUX ANDES,
PAR M. JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE FRANCAISE.
1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.
PREMIERE PARTIE. — EXPLORATION DE L'OYAPOCK ET DU PAROU.
IV
La roche Emonet. — Réception chez le chef des Oyampys. — Le bâton du commandement. — Les mangeurs d'oeufs deviennent stériles.— Arrivée d'Indiens Emerillons. — Apatou géographe. — Solution d'un problème important. —Il faut diminuer la longueur de la Mana d'un tiers. — Fabrication des arcs et des flèches. — Emerillons mangeurs de tigres et amateurs de pain frais. — De l'utilité des hôpitaux. — Un musicien voguant sur les eaux de l'Oyapock. — Je montre la lune aux Oyampys — Les indigènes de la Guyane n'adorent pas les astres.
2 septembre. — Le tamouchy, voulant nous précéder à son village pour nous en faire les honneurs, part avant le lever du soleil.
J'arrive vers dix heures à la hauteur de son habitation;
mais pour donner à mon hôte le loisir de faire ses préparatifs de réception,
je vais visiter une grande roche granitique noire située prés de la rive droite
que les Oyampys appellent Roche mon Père, parce que les anciens missionnaires
avaient l'habitude de s'y arrêter.
Je la parcours dans tous les sens, àla recherche de polissoirs ou d'anciennes
gravures, mais je ne trouve absolument aucune trace des anciens indigènes.
Je la baptise du nom du R. P. Emonet, en souvenir de mon ancien compagnon
de voyage.
Nous arrivons vers onze heures devant l’habitation de
Jean-Pierre qui est située derrière une grande île sur la rive gauche.
Apres une décharge de tous nos fusils, je descends à terre escorte de tout mon
équipage qui suit à la file indienne.
J'ai bien soin de marcher la canne à la main, car je sais que chez les Oyampys comme chez tons les indigènes de la Guyane le bâton est le signe du commandement Le chef des Oyampys, revêtu d'une couche fraîche de peinture rouge, portant à la main une canne de tambour-major, ayant au cou une pièce de cinq francs à l'effigie de Louis XVIII, parait radieux et fier comme le grand roi Louis XIV recevant les ambassadeurs chinois.
Apatou distribue une ration de tafia à tout le monde
tandis que je fais boire le tamouchy dans ma gourde.
Ayant donne un peigne et quelques épingles à sa femme, elle s'empresse de m'apporter
en échange une poule et quelques oeufs.
Je remarque que les Oyampys, pas plus que les Roucouyennes,
ne mangent ni les poules ni leurs produits.
Demandant à mon hôte la raison de sa répulsion pour les oeufs, il me répond
que malgré son age avance il vent encore avoir des enfants. Les oeufs de toutes
les espèces d'oiseaux sont réservés aux vieillards des deux sexes. Quant aux
poules, elles ne servent qu'à fournir des plumes pour les ornements de tête
destinés aux jours de fête.
Apres dîner je décide Jean-Pierre à m'accompagner jusque chez les Indiens Roucouyennes
du Yari. Je le paye d'avance avec un fusil, des haches, des sabres et des verroteries.
3 septembre. — Le matin, pendant que nous observions
le soleil sur une roche, nous voyons arriver deux pirogues portant des Indiens
Emerillons qui viennent d'un village nomme Macoucaoua, connu par Apatou, et
situé entre les sources de la crique Inini, affluent du Maroni, et 1'Approuague.
Leurs embarcations sont recouvertes d'un pamacari, c'est-à-dire d'une couverture
en feuilles de palmier, qui sert d'abri à des macaques, des hoccos, des aras
et principalement à de minuscules perroquets verts très recherches à Cayenne
sous le nom de perruches de l'Oyapock.
Mon compagnon est très heureux de retrouver des connaissances qu'il a visitées
pendant mon voyage en France.
En compulsant les renseignements fournis par Apatou et ces Indiens Emerillons je puis résoudre une question géographique assez importante. Je vois que la rivière Mana, relevée à la boussole par Gatier, est d'un tiers trop longue; la carte dressée par ce voyageur fait passer le cours supérieur de la Mana entre la crique Inini et l'Approuague. C'est évidemment une erreur, puisque Apatou est allé de l'Inini à l'Approuague sans rencontrer de rivière. On met deux jours pour aller de l'Inini à l'Approuague en passant par Macoucaoua, situé sur la chaîne de partage des eaux.
Je recueille un autre renseignement géographique important,
c'est que l'Inini et l'Approuague sont très rapproches vers leurs sources. Le
capitaine Cofi, de la tribu des Bonis, prétend que dans les grandes eaux on
peut passer en canot d'une rivière à l'autre.
Pour atteindre l'Oyapock, les Emerillons remontent 1'Approuague, font une traversée
de deux jours à pied, et atteignent un grand affluent de l'Oyapock, le Camopi.
Je profite de la présence de quelques Emerillons pour me livrer à des études anthropologiques et ethnographiques. A ce premier point de vue, je constate qu'ils ne différent par aucun caractère physique du reste des Indiens que j'ai eu l'occasion de voir.
Ils ne se distinguent des autres tribus que par des détails de moeurs et d'usage. Ainsi chez les Calibis ce sent les femmes qui se serrent le mollet en haut et en bas pour le faire proéminer, tandis que chez les Emerillons, les hommes seuls portent des liens en coton non seulement à la jambe, 'Mais au poignet et au niveau du biceps. Les ligatures du bras, usitées chez presque tous les indigènes de l'Amérique du Sud, servent à renfoncer les gaines de leurs muscles pendant qu'ils tirent de l'arc.
Leurs arcs sont très longs, comme ceux des Roucouyennes et des Oyampys qui ne mesurent pas moins d'un mètre soixante-quinze à deux mètres; ils en diffèrent un peu parce qu'une des faces, au lieu d'être plane, est légèrement excavée, autrement dit, la section de ces instruments, au lieu d'être plan-convexe, est concavo-convexe.
Comme tous les Indiens ils les fabriquent avec le coeur du bois de létre, qui est d'une belle couleur brunâtre souvent tachetée de jaune et qui, dans ce cas, est très estimé des ébénistes de Cayenne sous le nom de létre moucheté. Le coeur de cet arbre est entouré d'un aubier très épais que les Indiens n'ont pas la peine d'enlever puisqu'ils ne choisissent que des arbres tombes de vétusté et dont le bois tendre a été détruit par les termites.
Le bois de paria, lourd et dur comme le bois de fer des sauvages africains, se divise facilement dans le sens longitudinal. Une fois fendu à coups de hache, 1'Indien achève son oeuvre avec les défenses d'un animal appelé pakira qui présente de la ressemblance avec nos sangliers d'Europe.
On trouve dans toutes les huttes d'Indiens de l'Amérique du Sud des mâchoires inférieures de cet animal coupées au niveau de la branche montante; ce sont de véritables rabots qui servent à la fabrication de leurs arcs.
En examinant les petits pagaras de ces Indiens, je vois qu'ils renferment presque tous deux petits os fixes par le milieu à une ficelle d'un mètre de longueur. Cet objet, que j'ai retrouvé depuis chez tous les indigènes de l'Amérique équatoriale, est employé pour la construction des flèches.
Il faut savoir que cette arme est composée généralement
d'un roseau ayant un mètre vingt-cinq de longueur sur lequel il faut adapter
une lamelle de bambou taillée en forme de lance. Cette partie ne pouvant s'adapter
directement sur le roseau, on place entre les deux un bâton arrondi en bois
dur qui, d'une part, est encastré dans une échancrure faite à la base de la
lance, et de l'autre dans une cavité creusée dans le roseau. C'est pour le serrer
sur le bâtonnet que l'Indien, entourant cette partie avec une ficelle fixée
à deux os, fait des mouvements de va-et-vient en tirant aux extrémités tantôt
avec le pied, tantôt avec la main.
Lorsque l'extrémité du roseau est écrasée en forme de cône, le constructeur
l'enduit d'une couche épaisse d'une espèce de goudron appelé mani qu'il
égalise avec un os provenant de l'avant-bras de l'ai. Il achève la consolidation
avec un fil enduit de cette résine.
Dans le récit de mon premier voyage j'ai dit que les
Roucouyennes ont une passion pour la chair des grenouilles; les Emerillons préfèrent
la viande de jaguar, qu'ils appellent caïcouchy, à toute espèce de gibier.
Apatou me raconte que lorsque ces Indiens voyagent ils ne font pas de provisions
de cassave ou de couac, mais se contentent d'emporter des racines de manioc
qu'ils râpent, expriment et font cuire à la hâte sur un plateau en terre.
Leurs sentiments affectifs ne sont pas plus développés
que chez les Galibis et les Roucouyennes.
Apatou a trouvé en descendant la crique Inini une petite fille malade abandonnée
dans un hamac sur le bord de la rivière.
Les voyageurs qui feront des excursions chez ces Indiens
auront soin de mettre des souliers pour s'engager dans les sentiers qui conduisent
aux abatis.
En effet, Apatou me signale que l’on y trouve très souvent des pointes en bois
dur (maripa) disposées dans la terre comme des chevaux de frise pour empêcher
le passage.
Vers midi, Apatou m'appelle à la plage pour que je voie descendre un radeau forme de gros troncs d'arbres sur lequel se trouve un jeune Indien qui joue paisiblement de la flûte. Ce bois que mon patron reconnaît pour du grignon et de l'acajou doit être conduit jusqu'à Saint-Georges afin d'y être échange contre une hache et quelques couteaux.
Dans la soirée j'installe une lunette astronomique au
milieu du village pour observer une occultation d'étoiles, mais je ne puis rien
voir parce que la lune se trouve masquée par de grands arbres au moment où l'étoile
passe derrière cet astre.
Les Indiens, qui paraissaient fort intrigués par cette opération, sont ravis
lorsque je montre à chacun d'eux les montagnes de la lune et les satellites
de Jupiter.
Les traites de physiologie disent que certains sauvages
distinguent à l'oeil nu ces points qui ne sont visibles qu'avec une lunette.
Sur beaucoup d'Indiens et de noirs que nous avons interroges, nous n'en avons
pas trouvé un seul jouissant de ce privilège.
Les Oyampys, comme tous les Indiens de la Guyane, n’empêchent jamais les voyageurs
d'observer les astres.
C'est qu'ils ne les considèrent pas comme des divinités. Un Indien interrogé sur la lune me répond :
« Yolock oua », c'est-à-dire : ce n'est pas un diable.
V
Discorde. — Manière de tuer les parasites. — Un prodige d'éducation — Le Camopi. — Leblond et Leprieur. — Les RR. PP. Grillet el Bechamel. — Glande à huile du hocco ; effets toxiques — Campement pittoresque. — rencontre d'un boa. — Légende du saut Massara. — Le pécher originel raconte par Apatou.
Nous quittons le petit village de Jean-Pierre le lendemain
vers dix heures, escortes d'un troisième canot monte par deux Indiens. Le capitaine
embarque avec moi en qualité de patron, avec sa femme et trois petits enfants.
Pour loger tout ce personnel je suis oblige de charger presque tous mes bagages
sur le troisième canot.
Nous passons la journée à franchir des sauts. Apres cinq heures de marche dans des chutes qui se succèdent sans interruption, nous arrivons à l'embouchure de la crique Sikini, où M. Bugeat doit s'engager pour exploiter des alluvions aurifères.
La nuit est déplorable à cause de la pluie et des moustiques,
et le matin Apatou, qui vient d'avoir une nouvelle querelle avec mes noirs hollandais,
demande à s'en aller. Ce n'est qu'après avoir parlemente pendant deux heures
que je le décide à continuer la route.
Ces dissensions m'inquiètent beaucoup parce que non seulement je suis menacé
de perdre mon équipage, mais encore je suis exposé à me voir abandonner par
les gens du pays qu'une guerre intestine ne manque pas d'effrayer.
La journée toutefois s'écoule sans incidents; j'occupe les loisirs, que me laissent mes observations la boussole, à observer les moeurs de mes compagnons de voyage. La femme du chef est assise coté de moi sur une planche mal rabotée où je suis fort gêné à cause de l'étroitesse de ma pirogue. Elle porte sur le cote un hamac en miniature dans lequel est couche un garçon de deux ans appelé Michel, qui, depuis le jour de sa naissance, est tamouchy, autrement dit l'héritier présomptif de la couronne de plumes du royaume de Jean-Pierre. C'est lui qui portera l'écu d'argent, la canne de tambour-major et le ceinturon doré que j'ai promis a. Jean-Pierre s'il restait fidèle à ses engagements.
Le jeune tamouchy, épithète par laquelle son père ne
manque jamais de l'appeler, pleure et donne des coups à sa mère. Celle-ci, supposant
qu'il a soif, lui offre le sein, mais il refuse et continue de bouder.
La mère, le voyant se passer souvent la main dans ses cheveux, le sort de son
hamac et lui examine la tête qu'elle tient entre ses genoux. Un pediculus
qui s'est laisse surprendre, tenu entre le pouce et l'index, est présenté
à l'enfant. Michel le prend et s'empresse de le jeter à l'eau. La femme dit
quelques paroles que je ne comprends pas, mais qui semblent des reproches.
Enfin l'enfant profite de la remontrance maternelle ; un deuxième insecte capturé
est place sous ses petites- dents, croque et savoure. La mère parait très satisfaite
de ce résultat.
Apatou me fait remarquer à cette occasion que le pou de l'Indien est Bien différent de celui des nègres. J'ai cru constater moi-même que ces deux espèces n'étaient pas semblables au pediculus capitis de la race blanche.
Devant moi sont assises sur une caisse deux petites filles
de quatre cinq ans. Ces enfants n'ont pas la peau plus foncée que celle des
habitants du sud de l'Europe, et malgré la largeur des joues et la saillie des
pommettes, l'ensemble de la figure, rehaussée par des yeux bruns et des cheveux
noirs bleuâtres, compose une physionomie douce et des plus agréables.
Je constate également qu'elles sont bien gentilles.
L'aînée, qui s'appelle Marie, m'aide à vider l'eau du canoë un peu fendille à la suite des secousses qu'il a revues en franchissant les sauts. Ces enfants n'ont d'autre costume qu'un collier bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire aux couleurs françaises, que je leur ai donné. La mère est revêtue d'un petit carré composé de petites verroteries enfilées qui forment des arabesques ressemblant non seulement à celles que les Indiens actuels dessinent sur leur peau, mais aux vieilles gravures dont nous avons parlé.
A midi nous atteignons une île rocheuse à moitié couverte par un bouquet de philodendron aux feuilles larges et touffues que l’on rencontre dans toutes les rivières de la Guyane. C'est un endroit délicieux pour observer le soleil.
Apatou, descendu à terre avec Hopou et Stuart, me fait remarquer des polissoirs, et, s'il faut en juger d'après les vestiges laisses par les anciens indigènes, on peut croire que l'Oyapock actuellement désert était occupé par une nombreuse population.
Dans l'après-midi nous passons devant les collines Martini,
ainsi designees du nom d'un mineur qui a trouve de l'or en poudre dans ces parages.
Vers quatre heures et demie nous apercevons de petites montagnes qui sont au
confluent du Camopi, et bientôt nous nous arrêtons à un îlot situe prés de l’embouchure.
Cette rivière, dont le débit dépasse la moitie du cours du haut Oyapock, à ses sources peu éloignées des affluents du Maroni. Les nègres Bonis venant faire des incursions chez les Oyampys, remontaient 1'Inini jusqu'à ses sources, et de passaient dans le Camopi.
Deux voyageurs français, le médecin naturaliste Leblond,
en 1787, et le pharmacien de la marine Leprieur (de Dieuze), en 1836, out atteint
le Maroni par le Camopi et la crique Araoua. Ce dernier avait l'intention d'atteindre
les sources du Maroni où les anciens géographes plaçaient le pays légendaire
de l'Eldorado. Ayant été bien accueilli par les nègres Bonis, ainsi qu'il résulte
d'une lettre inédite que nous avons vue à Cayenne, sa tête fut mise à prix par
les nègres Youcas qui voulaient avoir le monopole du commerce dans le Maroni.
I1 fut obligé de battre en retraite par 1'Araoua et le Camopi. Cet intrépide
voyageur, qui avait déjà fait en 1832, avec Adam de Bauve, une tentative pour
atteindre les sources du Maroni par le haut Oyapock, du renoncer définitivement
ses projets d’exploration.
Le Camopi, qui ne compte plus un seul habitant, était autrefois peuple par les
Indiens Acoquas visités en 1674 par les RR. PP. Grillet et Bechamel.
5 septembre. — Nous passons dans la journée devant les
collines Bagotte, situées sur la rive droite, et ainsi nommées parce que le
comte Bagotte à fait des prospections aurifères dans ces terrains.
Il avait trouve de l'or, mais en trop faible proportion pour en faire une exploitation
lucrative.
A une heure nous passons devant la crique Morocom.
Le radical moroco ou maraca sert à designer dans presque toutes
les langues de 1'Amerique du Sud un hochet que les piays font sonner lorsqu'ils
veulent entrer en relation avec le diable.
Pendant que j'observe le soleil vers quatre heures, Apatou fait une petite excursion dans le bois et revient avec un hocco. C'est le premier gibier convenable que nous ayons tué dans ce voyage; jusqu'alors nous n'avions pu nous occuper de chasse à cause du mauvais temps et des difficultés de la navigation avec un équipage sans expérience ni discipline.
En mangeant le croupion de cet oiseau qu'Apatou m'a réservé comme la meilleure portion, j'éprouve une sensation d'amertume très désagréable. Cette saveur provient d'une glande à huile à laquelle l'oiseau puise avec son bec pour lustrer ses plumes. Jean- Pierre dit qu'un de ses chiens qui avait dévoré le derrière d'un hocco récemment tue fut pris d'accidents nerveux qui durèrent un mois. L'animal avait les yeux hagards, il aboyait et courait dans tous les sens comme s'il eût été à la piste d'un gibier imaginaire.
Nous dormons à l'embouchure d'une crique minuscule située à gauche, dont le lit est formé de roches granitiques entièrement polies par l'aiguisage des instruments en pierre. C'est que les Indiens s'arrêtaient volontiers en cet endroit parce qu'il y a des pacous (coumarous) dans les petits sauts qui se trouvent aux environs. Peut-être existait-il un village important dans ces parages, mais la végétation tropicale, qui triomphe facilement des oeuvres de l'homme, n'a laisse d'autres vestiges que ceux qui ont été imprimés sur le granit. Les arbres des rives n'étant plus tourmentés par les haches de pierre, des Indiens ont étendu leurs branches jusqu'à se donner la main.
La terre ne suffit pas à cette végétation dévorante, il faut qu'elle empiète sur le lit des rivières pour accaparer l'air et la lumière.
Cette tonnelle sous laquelle nous suspendons nos hamacs n'est pourtant pas assez touffue pour intercepter complètement la clarté de la lune dont les rayons argentes font ressortir les silhouettes rouges de mes Indiens.
6 septembre. — Vers neuf heures j'aperçois au milieu d'un buisson à moitié noyé un corps blanc recouvert d'écailles qui brille comme une cuirasse d’acier.
Je sens une odeur désagréable analogue à celle du muse.
C'est celle d'un serpent boa, ou plutôt d'une couleuvre, comme disent les créoles
de Cayenne, qui, ayant reçu une décharge à une distance de deux pas, fait des
contorsions effrayantes. L'animal passant à ranger ma pirogue je puis voir sortir
le sang d'une large blessure au ventre.
Un instant après j'entends un coup de fusil : c'est Apatou, qui achève le serpent.
Jean-Pierre, qui voulait m'empêcher de tirer, dit que le diable punira la mort
du matapi en faisant tomber la pluie.
A trois heures nous franchissons le petit saut Massara,
ou un Indien se fait une forte contusion du genou en glissant sur un bloc de
quartz. Jean-Pierre considère cet accident comme une vengeance du mauvais esprit;
le matapi que nous avons tué ce matin est peut-être le fils d'une couleuvre
légendaire que les Oyampys redoutent en passant dans ces parages.
Cet animal est si gros, me dit le capitaine, qu'un jour il avala plusieurs Calinas
(c'est ainsi qu'ils s'appellent entre eux) et la pirogue qu'ils montaient en
passant le grand saut Massara. Les malheureux ne sortirent des entrailles du
monstre qu'à la hauteur du petit saut Massara, où ils furent déposés vivants
sur une roche en même temps que leur embarcation.
Nous campons sur un îlot granitique prés de la rive gauche. La soirée se montrant très belle malgré la prédiction du capitaine, je passe mon temps à fumer des cigarettes auprès du feu en écoutant la conversation de mon équipage.
Apatou trouve les Indiens stupides parce qu'ils ne veulent
pas détruire les serpents; il nous fait le récit suivant que je transcris mot
à. mot.
Longtemps, ma grand’mère dit : Gadou (le bon Dieu) faire oun moun Adam, et oun
femme Eva, et ti commande rester petit village ou qu'y gagne beaucoup manioc,
beaucoup poisson, beaucoup viande qui pouvez manger sans travailler.
Gadou dit : Ou pouvez manger tout chose, mais pas oun graine appelée amanda,
qui bon oun so (seulement) pour serpent; si graine la tomber, ou pas toucher.
Un jour Adam vu Eva qui aller chercher de l'eau dans la rivière, trouve serpent
qui dit : Goûtez graine là.
— Adam dit : Non, bon Dieu pas voulé.
— Serpent dit : Eva, goûtez, pas gagné chose qui bon passe ça.
— Eva qui mange dit : Oh! C’est bon, Adam, venez manger.
— Adam dit : non.
— Goûtez oun sô.
— Non.
— Troisième fois, Adam mange morceau.
Apres cela, Gadou dit : Adam, Eva, veni vite.
— Adam qui gagné peur, pas savé pourquoi, mette oun feuille, et sa femme aussi.
Bon Dieu dit : Adam, toi mange graine là.
— Adam dit : Non,
— Adam, toi mange graine là.
— Troisieme fois, Adam dit : Oui, pas moi qui ramasse, Eva qui donne.
Bon Dieu pas content dit : Adam, Eva, ou pouvez aller ; toi, Adam, besoin travailler
pour gagner manioc, et flécher pour gagner viande ; Eva, toi pour gagner mal
au ventre pour faire petit moun; serpent, toi plus gagner pieds pour marcher.
»
La morale donnée par la grand’mère d'Apatou à ses enfants était de tuer tous
les serpents qu'ils trouveraient sur leur chemin. C'est pour cela que les Bonis
sont devenus très habiles à leur faire la guerre.
Il est à remarquer que les Bonis étaient restés un siècle et demi sans aucune
communication avec les missionnaires de la Foi.
VI
Le baiser du sauvage. — La crique Yave. — Pêche au pacou. —Variation de la végétation suivant la nature du terrain. — Le payement chez les Indiens. — Nous trouvons l'étymologie de trois rivières. — Commerce et religion. — La crique Motoura — Saba pris par la fièvre. — Effet de la chaleur sur les nouveaux débarques. — Activité fébrile précède la cachexie tropicale — Espérances de succès. — Les difficultés de la navigation sur l'Oyapock sont exagérées.— Noirs récalcitrants, Indiens bons enfants. — Le succès d'une exploration dépend du choix de l'équipage. — Cheveux en voyage.
7 septembre. — Nous marchons lentement, de sorte que je puis observer à l'aise mon jeune ami Michel et ses petites soeurs. Je remarque que les enfants Calinas manifestent leur tendresse par des baisers, non pas sur les lèvres, mais sur toutes les parties du corps. Michel embrasse la petite Marie, qui est d'ailleurs toute nue, plutôt sur la poitrine que sur la figure.
Le jeune tamouchy jouant à cache-cache se dérobe tantôt dans le sein de sa mère, tantôt derrière son dos. C'est en faisant ces évolutions que Michel étant tombe à l'eau la tête la première fut sauvé par son père qui le saisit au passage par le pied.
Nous arrivons avant midi à une crique assez importante
appelée Yave, que nous remontons à une petite distance pour trouver un joli
saut qui à la réputation d'être très favorable à la pêche du pacou.
En effet, en arrivant aux premières roches qui sont à fleur d'eau, j'aperçois
deux gros poissons qui se battent. C'est un piraï qui d'un coup de dents à dévoré
le ventre et une partie de la queue d'un pacou.
La section des chairs parait aussi nette que si elle avait été pratiquée par
un chirurgien.
Mes Indiens et Apatou, armes d'arcs et de flèches, courent
au milieu des roches pour assaillir de nombreux pacous qui sillonnent ces eaux
limpides, très courantes, mais peu profondes.
A chaque minute on voit décocher une flèche qui disparaît une seconde, puis,
émargeant d'un mètre, court en vibrant dans toutes les directions.
C'est que le dard a pénétré dans le dos d'un pacou qui fait de vains efforts
pour s'en débarrasser. Saba, armé d'un bâton, poursuit la flèche, la relève
doucement et achève d'un bon coup le poison qui pourrait encore le mordre.
Les pacous blesses vont quelquefois se réfugier sous des buissons où on les perd de vie; c'est pour cela que certains Roucouyennes du Maroni mettent de petits grelots l'extrémité du roseau. Trente et un poissons pesant chacun plus d'un kilogramme sont pris dans l'espace de deux heures. Nous continuons le canotage, mais nous nous arrêtons bien avant la nuit à l'embouchure de la crique Crouatou afin de laisser le temps à l'équipage de faire la cuisine et de préparer les boucans pour faire fumer les pacous.
8 septembre. — A partir de la crique Crouatou le fleuve
se dirige en ligne droite vers le sud-ouest un quart sud sur un parcours de
plus de six kilomètres.
Cette direction rectiligne que nous rencontrons pour la première fois n'a pas
d'autre cause que l'absence de roches dures capables de changer le cours des
eaux.
En effet les rives sont basses, marécageuses comme celles que nous avons trouvées
dans le haut Maroni.
Les arbres rabougris présentent entre eux des lacunes qui sont comblées par
des bambous, des palmiers et des lianes sans nombre.
Quelle différence entre la végétation des terrains marécageux et celle des terres
fermes! Ici, rien que des feuilles; c'est un manteau de verdure impénétrable,
tandis que là on ne voit que des troncs d'arbres bien droits, s'élevant à perte
de vue, entre lesquels la circulation est presque aussi libre que sur une promenade
publique.
Vers deux heures, nous revoyons les rives se relever au niveau de la petite crique Yaroupi. Quelques instants après, nous franchissons un saut appelé Pacouchili, qui peut avoir un mètre de hauteur en deux chutes.
Enfin à cinq heures nous apercevons un dégrade près duquel
se trouvent deux petits carbets d'Indiens Oyampys. J'arrive éreinté par treize
jours de marche sans relâche, mourant de faim. Je bois un bon coup de sec, comme
on dit en terme de marine, c'est-à-dire une ration de tafia que je partage avec
l'équipage.
L'alcool est l'aliment de la misère. Le chef des habitations étant un ami de
Jean-Pierre, je lui propose de garder chez lui la femme et les enfants du capitaine.
Ces malheureux petits êtres, obliges de rester dix heures par jour dans ma pirogue
la tête au soleil, les pieds dans l'eau, sont tous trois indisposés.
Je dois également abandonner l'Indien qui s'est contusionné le genou et dont
l'état ne fait que s'aggraver malgré les scarifications qu'il s'est faites lui
même sur la partie malade. Je remplace ces bouches inutiles par deux jeunes
Indiens qui sont contents de m'accompagner au prix d'une hache, d'un couteau,
de quelques mètres de calicot.
Les Oyampys, comme tous les Indiens de l'intérieur des
Guyanes, demandent à être payés d'avance, et, une fois qu'ils ont reçu les objets
demandés, il est très rare qu'ils abandonnent le voyageur sans avoir accompli
au moins une partie de leurs engagements.
Un homme que j'avais enrôlé et qui a changé d'avis pendant la nuit, sans doute
sur le conseil de sa femme, a eu l'honnêteté de me rapporter les bagages que
je lui avais donnes en payement..
9 septembre. — Je passe la matinée à faire quelques observations
tandis que mes hommes lavent leur linge , et leurs hamacs sur de belles roches
granitiques qui sont en face du village. Nous ne partons qu'après avoir pris
la méridienne et nous allons camper au saut Couyary qui est fort peu distant,
mais difficile à atteindre à cause de la rapidité du courant.
En route un indien qui était debout, manoeuvrant un tacari, tombe à l'eau :
heureusement il est ramasse aussitôt par le canot d'Apatou qui nous suivait
de près.
Le mot Couyary, que nous avons déjà, vu employer pour
designer un affluent important du Yary, signifie soleil dans la langue des Oyampys.
Le mot Yary lui-même signifie lune dans l'idiome de ces Indiens.
A propos de ces étymologies je fais quelques interrogations à mes compagnons
de voyage sur le nom du fleuve que nous parcourons.
Si le terme Oyapock n'a aucun sens, nous trouvons le substantif Couyapock, qui
en oyampys comme en roucouyenne sert à designer une espèce de toucan connu des
naturalistes sous le nom de Rhamphastusloco.
10 septembre. — A neuf heures nous arrivons devant le
saut Grand-Massara que les Indiens continuent à redouter, bien que le monstre
qui l'habitait eût été exorcisé par le R. P. Leroy qui accompagnait Mgr Emonet.
Ce courageux missionnaire s'était pourtant donne la peine de traverser le saut
à la nage pour prouver que le diable avait déserté ces parages.
L'histoire de ce monstre a probablement été inventée par un de leurs piays qui
voulait empêcher les hommes de sa tribu d'accompagner des voyageurs ou des trafiquants
dans le haut Oyapock. Beaucoup de croyances religieuses des peuples barbares
n'ont d'autre origine qu'un intérêt commercial.
Nous passons la journée à franchir de petites chutes
qui traversent des montagnes granitiques hautes de cent cinquante à deux cents
mètres au-dessus du niveau de la rivière.
Nous arrivons vers deux heures à l'embouchure de la crique Motoura, qui est
assez importante puisqu'elle présente cinquante-cinq mètres de largeur à son
embouchure, tandis que l'Oyapock n'en présente plus que cent dix (mensuration
à la ficelle) au-dessus de cet affluent.
Nous remontons la rivière Motoura, qui se dirige vers le sud-est, jusqu'a une
distance d'un kilomètre pour trouver une habitation d'Indiens Oyampys.
Un jeune homme que je rencontre au dégrade consent volontiers à m'accompagner moyennant quelques objets qu'il choisit lui-même dans ma pacotille, mais son père, qui est un vieil Indien corrompu par un séjour prolonge dans le bas Oyapock, demande en outre quatre bouteilles de tafia et une quantité d'objets.
En remontant cette crique, à un jour de marche plus loin, on trouve un petit village d'Indiens Oyampys qui ont été visités par Mgr Emonet. 11 septembre. — A huit heures nous franchissons un petit saut au-dessus duquel je vois quelques arbres arrêtés dans la rivière; c'est que le volume des eaux diminue considérablement au-dessus de la crique Motoura. Nous entrons bientôt dans les terrains bas et marécageux où le courant est très faible.
Dans la journée Saba est prix d'un accès de fièvre.
C'est le premier qui se déclare depuis que nous sommes en route. Quant à moi,
je me trouve plus alerte qu'au départ de France.
Je suis sans doute sous l'influence de cette excitation qui s'empare de tous
les Européens dans les premiers mois de leur résidence aux colonies.
Le voyageur doit profiter de cette période pour s'avancer résolument, car bientôt
cette force qui n'est que factice va disparaître, pour laisser derrière elle
un état d'anémie qui l'entravera dans l'exécution de ses projets.
Nous nous arrêtons sur des roches granitiques situées au milieu de la rivière, dans un endroit bien découvert ou je voudrais observer une occultation d'étoiles qui doit avoir lieu vers minuit. Ne voulant pas m'endormir de peur de manquer le moment favorable, je passe mon temps à prendre du café et à fumer des cigarettes, tantôt me promenant sur les roches, tantôt m'asseyant dans mon hamac qui est suspendu au pataoua. Je me trouve de belle humeur parce que j'entrevois de beaux résultats pour mon voyage. Le moral d'Apatou se relève depuis qu'il voit que nous sommes presque certains d'arriver aux sources de l'Oyapock sans le moindre péril. Les gens auxquels il avait demandé des renseignements lui avaient tous exagéré les difficultés de la navigation de ce fleuve qui, en réalité, sont beaucoup moins grandes que celles du Maroni.
Les indigènes, faut en juger d'après ceux que nous avons rencontres, sont d'un moral si doux et si facile que je les trouve beaucoup plus maniables que les hommes de mon équipage qui sont pourtant des gens civilisés ou qui ont la prétention de l'être. Ces noirs qui sont incapables de prendre un poisson ou de tuer un gibier se plaignent continuellement de la nourriture, tandis que les Indiens, qui d'ailleurs appartiennent à une race plus intelligente, ne laissent pas échapper la moindre plainte. Aujourd'hui mes nègres ont voulu se révolter sous prétexte n'avaient d'autre chose à manger que du bacallao (morue) et des pois. Je n'ai pas eu d'autre argument pour les calmer que de leur dire que s'ils n'étaient pas contents je partirais sans eux. Mais l'impéritie et la couardise font de ces mauvais garnements les êtres les plus fidèles qu'on puisse rencontrer; je suis sur qu'ils ne m'abandonneront pas; ils auraient trop peur de se noyer en descendant l'Oyapock, et d'ailleurs ils seraient fort en peine de traverser la mer pour retourner dans leur pays. Si j'avais eu affaire à des noirs de la Guyane française, j'aurais été à leur merci parce qu'ils auraient connu la route pour s'en retourner chez eux.
En règle générale, il est donc préférable pour les voyages d'exploration d'avoir un équipage principalement composé de gens étrangers au pays qui sert de point de départ.
N'ayant pu observer mon occultation, je prends une hauteur de lune, aidé par Saba ; il m'éclaire avec une bougie qu'il est obligé d'approcher très prés pour que je puisse lire les divisions très fines de mon instrument. Deux fois il met le feu à ma longue chevelure qui me préserve des insolations en regardant le soleil, mais qui me gène considérablement pour les observations nocturnes.
VII
Moucou-moucou des régions marécageuses. — Elégance stérile de la végétation. — Domination du règne animal par le règne végétal. — Nom de la capitale de l'Eldorado. — Véritable cause du succès de mon premier voyage. — Un seul mot pour désigner le piment dans des tribus éloignées de plus de mille lieues. — Saut de l'Indigestion. — Crique de la fièvre. — Le premier gué de l'Oyapock. — Eboulement de la rive. — Les Trois sauts. — Les gens distraits doivent savoir nager. — Une amazone. — Etymologie du mot canot. — Soleil à pic. — Une mission de jésuites dont il ne reste pas de vestiges.
12 septembre. — Le courant étant faible nous avançons beaucoup plus vite que les jours précédents.
Dans la matinée je trouve pour la première fois la rive dénudée de grands arbres sur un espace de quelques centaines de mètres. Je remarque beaucoup de légumineuses parmi les arbustes qui la recouvrent.
On trouve quelque moucou-moucou (caladium arborescens) sur les bords, mais ils sont beaucoup moins nombreux que dans le haut Maroni. C'est une preuve que cette partie de l'Oyapock est moins marécageuse. L'aspect du paysage devient très monotone; le lit forme des anses qui deviennent d'autant plus courtes que le débit des eaux est moins considérable. D'un coté c'est une rive argileuse blanche teintée de rouge taillée à pic sur une hauteur d'un mètre cinquante; de l'autre c'est un terrain bas formé de limon récemment déposé couvert de plantes aquatiques. Bien que la végétation ne manque pas d'élégance et de pittoresque, nous reprochons à cette nature d'être prodigue en feuilles tandis qu'elle est parcimonieuse en fleurs et en fruits.
A coté de cette folle végétation — on peut l'appeler ainsi puisqu'elle sacrifie tout à l'élégance — le règne animal fait une piteuse figure. Je vois peu de papillons, et voila huit jours que je n'ai pas remarqué un colibri. Le gibier est rare et l'espèce humaine n'est pas représentée même par un habitant par kilomètre carré.
L'Oyapock, comme le Maroni et le Yari, présente trois parties distinctes. La région la plus pittoresque, la plus saine, la plus facile pour l'alimentation est celle des chutes, où l'on trouve des poissons exquis à profusion. C'est dans cette portion du Maroni que les nègres marrons hollandais sont venus se réfugier.
Les régions situées en amont et en aval, c'est-à-dire les sources et l'embouchure, sont marécageuses.
Dans l'après-midi nous franchissons le petit saut Yenourou, dont le nom signifie oeil. Nous passons devant une crique assez importante appelée Inguerarou; enfin nous dormons sur une petite roche appelée Manoa, du nom d'une vieille Indienne qui s'y est noyée. Ne sachant pas le sens du mot Manoa nous ferons remarquer seulement qu'il nous parait le même que le nom de Menoa qui servait à désigner cette ville légendaire aux maisons couvertes d'or, située, disait-on, sur les bords du lac Parime, dans le pays de l'Eldorado.
13 septembre. — La rivière, qui devient de plus en plus étroite, ne forme pas d'îles. C'est à peine si elle est entrecoupée de temps à autre par quelques roches granitiques qui font des rapides ou mes hommes s'amusent à flécher des pacous.
Vers quatre heures nous voyons, une petite colline située sur la rive gauche, que Jean-Pierre appelle Yauar parce que Mgr Emonet qu'il accompagnait y a tue un gros jaguar. A cette occasion Apatou me fait remarquer que jusqu'ici nous n'avons pas rencontre un seul tigre, ce qui est de bon augure pour le succès de notre expédition. Il déclare qu'une des raisons qui l’ont déterminé à me suivre en toute confiance jusque dans le Yari, est que nous avons remonte tout le Maroni sans voir un de ces animaux. Il croit comme les Roucouyennes que le diable des bois se montre sous les traits du tigre pour dévorer les gens mal intentionnés.
A quatre heures et demie nous passons devant une petite crique appelée Ouarapouroutou, en aval de laquelle se trouve un grand nombre de roches mamelonnées qui ressemblent à des tas de foin. Nous étant arrêtés un peu en aval, je m'amuse à mesurer la rivière avec Apatou au moyen d'une corde. Elle n'a pas plus de cinquante mètres sur une profondeur qui varie d'un àa deux mètres avec un courant qui est de moins d'un mille. Son lit est formé de gravier parmi lequel on remarque beaucoup de morceaux de quartz blanc.
Nous faisons un dîner très copieux avec d'excellent pacou bouilli avec l'achi ou piment rouge des Indiens.
Les Oyampys, comme les Roucouyennes, les Galibis, les Emerillons, désignent ainsi le poivre de Cayenne.
D'autre part, le fils de Christophe Colomb, qui a écrit la vie de son père, nous raconte que les Espagnols trouvèrent dans une île des Antilles à un certain poivre nomme achi beaucoup plus fort que le poivre ordinaire. Nous verrons plus loin que le piment très usité par tous les Indiens de l'Amérique intertropicale s'appelle également achi chez des populations qui vivent au pied des Andes.
M'étant couche vers neuf heures j'ai de la peine m'endormir parce qu'il a fait très chaud dans la journée.
Je me réveille plusieurs fois au milieu de la nuit pour aller boire l'eau de la rivière qui me parait très fraîche, bien que sa température soit de vingt-quatre degrés centigrades. Chaque fois je rencontre Jean- Pierre ou un de mes hommes se promenant sur la roche, et je suppose qu'ils se trouvent indisposés.
14 septembre. — L'équipage a beaucoup de peine se mettre en route, et, quelques instants après le départ, Jean-Pierre, épuisé, se couche au fond de ma pirogue.Un profond désespoir parait s'emparer de lui.
« Il faudra, me dit-il, que je te quitte au dégrad des Banares, car les Oyampys qui ont peur de la maladie se sauveraient voyant que nous sommes tous malades.» Je serais désolé moi-même si je ne m'étais donné la peine d'étudier la cause de cette épidémie qui s'est abattue, comme la foudre, sur tous les Indiens aussi bien que sur mes noirs. C'est que sur vingt pacous qui ont été pris la veille, quinze ont été manges dans la soirée; il s'agit simplement d'une indigestion provoquée par plus d'un kilogramme de poisson absorbé par chacun des convives.
Les roches sur lesquelles nous avons passe la nuit pourraient s'appeler saut de l’Indigestion, puisque Jean-Pierre m'avoue qu'il ne l’a jamais traversé sans avoir la colique. Les Oyampys viennent quelquefois de très loin pour flécher des pacous dans ces parages.
Une heure après le départ nous passons devant un petit affluent de gauche appelé Caraéguar, ce qui signifie crique de la fièvre. Mes hommes, quoique fatigués, effrayés par la réputation d'insalubrité de ces parages, marchent vite pour atteindre des régions moins basses et moins marécageuses.
Vers dix heures nous arrivons à la crique Eureupoucin, qui à vingt mètres de largeur sur un mètre quarante de profondeur, mais dont le courant est faible Au-dessus de ce point l’Oyapock présente encore cinquante mètres de largeur, mais il n'a pas plus d'un mètre de profondeur.
Jean-Pierre me dit qu'il y a un peu plus haut un endroit où l'on peut traverser le fleuve sans se mouiller. En effet, nous rencontrons bientôt un barrage sur lequel un Indien s'amuse à traverser l'eau en sautant: d'une roche à l'autre.
A partir de ce point je remarque que les eaux du fleuve, qui étaient absolument limpides, se troublent légèrement et ont une coloration brune dans les endroits profonds.
A midi je prends une hauteur de soleil sur une rive taillée à pic ayant deux mètres d'élévation. Au moment où je finissais mon observation un Indien qui était resté dans le canot s'aperçoit que la berge sur laquelle je me trouvais avec Apatou et Saba vient de se fendiller, et menace de tomber à la rivière.
Nous n'avons que le temps de nous sauver pour ne pas tomber à l'eau avec deux grands arbres qui s'abattent avec fracas.
Vers deux heures nous voyons les rives s'élever et le courant devenir plus rapide. Bientôt après nous arrivons devant une chute magnifique que l'on peut designer sous le nom des Trois Sauts; elle est remarquable par trois gradins qui forment un escalier majestueux sur lesquels l’eau bouillonne et tombe en cascade.
Il est absolument impossible de franchir cet obstacle dans le courant. On transporte les bagages à dos d'homme et on hale les canots sur une grande roche granitique située sur la rive gauche.
Pendant que mes hommes font le transbordement je prends un bain délicieux tout près de la berge en amont de la chute. Dans un moment de distraction je perds pied tout à coup et je me laisse entraîner par le courant. J'allais franchir le premier gradin lorsque j'ai le bonheur de rencontrer une roche à fleur d'eau sur laquelle je me cramponne. Un Indien me jetant une longue liane me permet de sortir de la sans le moindre accident.
Ce bain, précédé de huit heures de canotage, me donne un très grand appétit. Je mange à moi seul la moitie d'un excellent coumarou qui a été pris dans la chute. Au, dessert je débouche une vieille bouteille de bordeaux que je partage avec Apatou, Jean-Pierre et Saba. Pour exciter un peu le reste de l’équipage qui ne manque pas déjà d'être enthousiasme par l'aspect ravissant de ces parages, je lui fais distribuer double ration de tafia et ordonne de faire cuire du riz pour le lendemain matin.
Dans la soirée Jean-Pierre raconte qu'il a conduit jusqu'ici un habitant de Cayenne, M. Voisin, qui venait chasser les meou ou coqs de roche, très rares dans nos collections d'histoire naturelle, mais assez communs aux environs des Trois Sauts.
II y avait alors, près de la chute, une vieille Indienne, aux cheveux blancs, de la tribu des Ouayanas, qui vivait de pêche et de chasse sans avoir le moindre rapport avec les Indiens Oyampys. C'était une véritable amazone qu'avec un peu d'imagination on pouvait considérer comme la dernière de ces femmes chasseresses qu'Orellana, traversant le premier l'Amérique équatoriale, a rencontrées près de l'embouchure du Trombette. On sait que c'est à la suite du récit fantastique de ce voyageur que le plus grand fleuve du monde, le Maranon, a reçu le nom élégant de fleuve des Amazones.
Nous dormons paisiblement au bruit de cette chute la plus imposante que nous ayons rencontrée dans l'Oyapock et le Maroni.
15 septembre. — Au réveil, une partie des hommes, s'occupent à charger les bagages pendant que les autres font bouillir le poisson. Nous nous mettons en route comme d'habitude à sept heures du matin.
Nous trouvons les eaux très calmes en amont du saut; c'est que les roches sur lesquelles l'eau tombe en cascade forment un barrage, une véritable digue qui empêche les cours d'eau de la Guyane de se vider complètement pendant la saison sèche qui peut durer cinq mois sans la moindre pluie.
A huit heures, le patron du grand canot nous hèle de loin. Craignant un accident, je fais retourner ma pirogue pour aller au-devant de cette embarcation.
C'est ce pauvre Saba qui claque des dents sous l'effet d'un nouvel accès de fièvre. Lui ayant donne une chemise de flanelle dans laquelle il s'enveloppe, il se blottit dans un petit coin au milieu des caisses et des dames-jeannes et attend sans murmurer la fin de l’accès.
En certains points l'Oyapock ne dépasse pas quarante
mètres de largeur sur un mètre soixante de profondeur, le courant étant très
faible. Les grands arbres s'inclinent vers la rivière à la recherche rayons
solaires et donnent un ombrage très agréable.
Vêtu seulement d'un pantalon et d'une chemise, j’éprouve une sensation de froid
qui me fait revêtir avec plaisir un paletot de flanelle.
A midi j'observe le petit saut Canaoua, qui est difficile à monter. Les Indiens ne le passent jamais sans décharger leurs bagages, mais Apatou, trouvant le transbordement inutile, nous fait franchir ces obstacles sans le moindre accident. Le mot canaoua, qui est usité, par tous les Indiens de l'Amérique équatoriale, sert à designer une embarcation. Il est très probable que le mot français canot provient de la langue des sauvages de l'Amérique du Sud.
II fait une chaleur épouvantable. La hauteur du soleil
à midi est de 89° 23'. La température est presque aussi élevée quo celle de
la côte. C'est que les régions que nous atteignons n'ont pas une altitude de
plus de quatre-vingt-dix mètres au-dessus du niveau de la mer.
Sababodi est dans la période de transpiration; il reste couché sur une grosse
roche granitique qui doit servir d'antre à un tigre, s'il faut en juger par
les débris d'os que nous trouvons à cote: Nous franchissons dans l'après-midi
le saut Itortatin.
A ce point, la rivière, divisée en un grand nombre de bras, forme une infinité d'îlots granitiques entre lesquels l'eau tombe en cascades pittoresques.
Nous nous arrêtons pour toucher sur des roches situées un peu en amont d'une île où Jean-Pierre a vu, pendant son enfance, les débris d'une croix qui avait été érigée par les anciens missionnaires.
Pendant que l'équipage flèche des coumarous, je prends un canot avec deux hommes pour aller reconnaître cette île ou je ne trouve plus aucun vestige.
En regagnant le campement les deux noirs qui m'accompagnent manoeuvrent si mal qu'ils ne peuvent diriger l'embarcation. Ils se montrent si maladroits que les indiens qui les regardent ne peuvent s'empêcher de rire aux éclats; il faut que je mette la main à l'oeuvre pour les aider à sortir de ce passage qui ne présentait pas de difficulté.
16 septembre. —Vers neuf heures nous arrivons à la crique
Moutaquere, affluent de droite assez important.
Au-dessus, le fleuve, qui ne mesure plus guère que vingt-cinq mètres, est environné
de terres basses et marécageuses que nous traversons le plus rapidement possible
pour éviter d'y contracter la fièvre.
Vers dix heures l'Oyapock se divise en deux branches à peu prés d'égale largeur. Apres avoir pris un bain dans l'affluent de gauche que je traverse sans avoir de l'eau au-dessus de la ceinture, nous nous engageons dans l'affluent de droite que nous appellerons Rivière Leblond en souvenir du voyageur français.
Des arbres tombés en travers rendent la navigation si difficile que nous renonçons à aller plus loin en canots. Enfin, à dix heures du matin, après vingt-deux jours de canotage sans interruption, nous arrivons au dégrad des Banares, ainsi nomme parce que les Oyampys repentent à chaque instant le mot banare qui veut dire ami.
Depuis Saint-Georges nous avons fait cent soixante heures
de canotage et parcouru une distance que j'estime à quatre cents kilomètres,
ce qui fait à peu prés deux kilomètres et demi à l’heure.
L'Oyapock est d'un tiers moins long que le Maroni, qui nous a demandé trente-trois
jours de navigation pour remonter de Saint-Louis au dégrad des Roucouyennes.
L'altitude de l'Oyapock est de quatre-vingt-dix metres au degrad des Banares,
tandis que celle du Maroni est de cent dix mètres au point on nous avons cessé
la navigation.
Docteur J. CREVAUX.
(La suite à la prochaine livraison.)
DE CAYENNE AUX ANDES,
PAR M. JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE FRANCAISE.
1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.
PREMIERE PARTIE. — EXPLORATION DE L'OYAPOCK ET DU PAROU.
VIII
A la recherche des indigènes. — Pas de porteurs pour franchir la montagne. — Je brûle mes vaisseaux. — Un repas homérique aux sources de l'Oyapock. — Légende d'Anancy. — Le coup de l’étrier. — Une heureuse rencontre : nous atteignons un village oyampys.— Une ménagerie. — Un détail de fabrication des poteries. — Pas de pays où l'on rencontre plus de ruisseaux. — Manière de franchir les arbres tombés. — La folie des voyages. — Adieu à mes souliers.
Je fais faire une hutte et décharger nos bagages, tandis que je vais avec Jean-Pierre à la recherche de quelques habitations d'Indiens Oyampys.
Nous trouvons un sentier assez Bien fraye, mais une marche accélérée de deux heures ne nous fait pas découvrir d'habitation. Désespérant de trouver des porteurs, je prends la résolution suivante : Sababodi malade et deux noirs qui sont trop faibles pour continuer resteront au dégrad en attendant Jean-Pierre qui pourra me quitter une fois que j'aurai trouve des Indiens. Je conserve un équipage de trois nègres: Apatou, Stuart et Hopou.
Mes hommes font immédiatement des catouris et emballent les bagages. Nous ne pouvons transporter que nos hamacs, deux chemises, nos instruments, deux bouteilles de sel et des vivres pour cinq jours de marche.
Que faire de mes provisions et des vins exquis que j'avais épargnés pour les jours de misère? Je les livre au pillage dans la soirée.
Le vin de Marsala a coulé à flots aux sources de l'Oyapock.
Après le repas, Indiens et noirs, qui sont devenus les meilleurs amis du monde, parlent avec volubilité. Apatou leur ayant dit que j'étais médecin des blancs, ils pensent que je dois être comme leurs piays très au courant des affaires de religion.
Ils sont saisis d'admiration et d'enthousiasme lorsque je leur apprends qu'il n'y a qu'un seul bon Dieu pour les blancs, les noirs et les Indiens. Se donnant la main comme des frères, ils dansent autour d'une croix que Mgr Emonet a élevée il y a deux ans prés du dégrad des Banares.
Après la danse ils se mettent à raconter toutes sortes d'histoires; Apatou intéresse vivement Jean-Pierre par le récit fantastique suivant que je vous donne textuellement :
« Oun année qui faire sec trop, tout bête dans bois mouri faim. Anancy (l’araignee) qui gagne esprit passe tout moun (a plus d'esprit que tout être), trouve oun carbet où qui gagné ignames beaucoup. Ly faire oun gros catouri (panier) qui meté tout plein ignames. Quand sorti maison rencontre oun serpent qui dit : «Si toi prendre mes ignames, moi piqué toi. »
Anancy dit : « Non, moi porter ignames et toi venir demain pou piqué moi. »
Petit morceau (peu) après, li trouvé oun tapir qui gagné (avait) faim. Anancy dit : « Viens a mo maison, moi gagné beaucoup ignames qui partager avec toi. »
Quand fini Bien manger, Anancy dit : « Toi coucher à coté la porte et si quelqu'un appeler, toi ouvrir vite.» Serpent qui veni bon matin, faire : « Toc... ! toc... ! » Tapir ouvri et serpent piqué ly et pi sauve. Tapir mouri vite, Anancy faire bouilli morceau et pi boucaner reste.
Quand li fini, li retourne à maison où qui gagné vivres. Serpent voulé toujours pique. Anancy dit : « Non, pas besoin aujourd'hui, toi veni demain. »
Anancy trouve dans chemin oun petit tatou qui gagné faim. Ly alle ensemble à maison, mange bien et tatou dormi à cote la porte.
Bon matin, Anancy entendé faire : « Toc... ! toc... ! » Ly faire oun fois, deux fois. Ly appeler tatou qui pas répondre. Ly cherche partout et py li trouve à cote la porte oun trou qui faire tatou pour sauver pendant la nuit.
Serpent faire : « Toc... ! toc » Anancy voulé sauvé, mais ly pas pouvé.
Ly songe morceau et puis faire boum. Quand maison fini trembler, ly dit : Qui ca faire ca ? moi croyé serpent qui parlé avec so ventre.
Serpent dit : « Pas moi qui faire ca. »
Anancy dit : « Si, vous-même qui faire boum, ça pas bien, moun qui gagne esprit pas parlé avec so ventre, ly parlé avec so bouche.
Serpent dit : « Non, pas moi qui faire ça »
Anancy dit : « Si, vous qui faire ca »
Anancy parlé fort, serpent qui gagné peur beaucoup dit : « Ouvri morceau, moi besoin pane avec vous. »
Serpent entre, Anancy dit : « Si pas menteur,vous pas gagné peur mo sabre, moun qui pas méchant pas pouve mouri. Serpent mette so tete sur bois, Anancy tape fort avec so sabre et ly couper.
Quand serpent plus gagné tête, autres bêtes qui avait mouri faim, partage ignames.
Cette légende qui se propage par tradition chez les nègres Bonis n'est peut-être qu'une réminiscence d'un enseignement chrétien défiguré par l'imagination des conteurs.
17 septembre. — Au lever, nous faisons bouillir un pakira tué la veille et nous déjeunons à la hâte. Ayant voulu boire le coup de l’étrier, je suis obligé de me contenter d'eau, car on a suivi mes ordres à la lettre ;vins et liqueurs sont épuisés jusqu'a la dernière goutte.
Je fais mes adieux à Saba, qui se met à pleurer ; puis nous nous engageons résolument dans la piste que nous avons découverte la veille. Après quatre heures de marche sur un terrain plat entrecoupé par de nombreux cours d'eau qui se jettent dans la rivière Leblond, nous arrivons à une petite colline où nous trouvons une piste mieux frayée. Apatou qui marche derrière moi s'arrête subitement et prête l’oreille, disant qu'il vient d'entendre le bruit sourd d'une hache cognant un tronc d'arbre.
Nous étant portés dans cette direction, nous apercevons du haut de la colline un homme rouge qui est si préoccupé de son travail que nous approchons de lui à dix mètres sans qu'il nous aperçoive. Ce sauvage qui connaît Jean-Pierre ne manifeste aucune surprise en nous voyant. Il nous dit que son village n'est pas loin. Quelques instants après, nous traversons un abatis planté de manioc et apercevons quelques huttes d'Indiens.
Ayant tire un coup de fusil pour .annoncer mon arrivée, les chiens se mettent à aboyer en courant au devant de nous. Le chef de la tribu que Mgr Emonet a baptisé sous le nom de Jean-Louis me fait asseoir sur un petit banc excavé comme ceux des Roucouyennes et s'entretient avec moi pendant que sa femme apporte un vase en terre contenant de petits poissons bouillis.
Après le repas, je propose au tamouchy de m'accompagner jusqu'au pays des Roucouyennes moyennant tels et tels objets que je lui donnerai en payement. Il se décide à venir avec ses deux femmes et deux jeunes gens.
Je vois que les Oyampys comme les Roucouyennes ont tiré grande quantité d'animaux apprivoises dans leurs habitations. Ce sont des agamis où oiseaux trompette (Trompet birds des Anglais), des hoccos, des mirayes et des aras au plumage rouge et bleu.
Dans cette véritable collection zoologique je vois en cage un tout jeune aiglon qui a pourtant la taille d'une dinde. Cet oiseau terrible (Harpia ferox),qui attaque toutes sortes de gibiers et les serpents les plus dangereux, est appelé pia par les Oyampys et les Roucouyennes, et gonini par les nègres Bonis. Ses plumes sont très recherchées par les Indiens pour garnir leurs flèches. C'est sans doute du nom de cet oiseau qu'un affluent important du Maroni, la crique Gonini, a tiré son nom.
Regrettant de ne pouvoir envoyer ce magnifique échantillon tout vivant à Cayenne, je l'achète pour un petit couteau, et, Apatou l'ayant assommé d'un coup de bâton, nous le mettons en peau pour l'envoyer dans cet état par l'intermédiaire de Jean-Pierre.
Ayant l'occasion d'assister à la fabrication de poteries en terre, nous remarquons que chez les Oyampys comme chez tous les Indiens de la Guyane ce sont les femmes qui sont exclusivement chargées de cette industrie. Pour les vases destines à conserver de l'eau que les Espagnols appellent alcarazas et nos créoles gargoulettes, ils ont soin d'ajouter la cendre d'une écorce appelée couépi, qui, rendant l'argile plus poreuse, favorise le refroidissement par évaporation.
Nous prenons un jour de repos en attendant que les femmes préparent la cassave, et nous partons le 19 à huit heures du matin.
A huit heures un quart nous rencontrons la crique Leblond, qui présente une largeur de huit mètres sur une profondeur d'un mètre cinquante. Mes baromètres androïdes indiquent sept cent cinquante millimètres de pression, c'est-à-dire une hauteur d'environ cent mètres au-dessus du niveau de la mer.
Le pays est tellement irrigué que nous ne passons pas cinq minutes, chiffre moyen, sans rencontrer de l'eau ; tantôt c'est une crique que nous franchissons sur un tronc d'arbre, tantôt c'est un pripri, c'est-à-dire un marécage où nous enfonçons jusqu'à la ceinture.
Nous pourrions disparaître si nous ne mettions pied sur une spathe ou une palme du ouapou qui est très abondant dans les terres noyées.
En franchissant les petites collines qui séparent des innombrables tours d'eau, nous rencontrons quantité de troncs d'arbres tombés de vétusté. II est à noter que l'Indien ne courbe jamais l’échine pour passer sous un arbre qui barre la route ; il préfère escalader le pont que de passer dessous. C'est que les arbres pourris renferment une infinité d'insectes tels que des fourmis et surtout des termites qui tomberaient au moindre choc. Je m'inquiète peu de ces obstacles que j'escalade machinalement. Tout en marchant je rêve au succès de mon entreprise et je fais les projets de voyage les plus insensés. Je suis sous l'influence d'une impulsion mentale que les missionnaires évangéliques appellent la foi, et les gens de lettres le feu sacré.
Nous faisons une halte de dix heures et demie à onze
heures. Quelques instants après nous traversons la rivière Leblond sur un mince
tronc d'arbre. Apatou, qui marche derrière moi, vient à glisser et tombe à la
rivière, qui n'est pas profonde, mais très rapide. S’étant relevé sans accident,
il s'aperçoit qu'il a perdu son sabre, son couteau et un de mes souliers que
j'avais retirés pour avoir le pied plus sur.
Nous retrouvons le sabre et le couteau, mais il nous est impossible de mettre
la main sur ma chaussure. Je serai obligé de marcher pieds nus pendant le reste`du
voyage.
Nous nous arrêtons à midi et demi après avoir fait quatorze
mille cent pas. Ce chiffre m'est indiqué par l'instrument nouveau appelé podomètre
que je porte suspendu au mollet. A chaque pas il se produit dans l'instrument
une secousse qui fait avancer une aiguille sur le cadran.
Jean-Louis me dit que l'endroit où nous nous arrêtons était autrefois le dégrad
des Banares. Il y avait près de là un village qu'on a abandonné à la suite d'une
épidémie qui a détruit une partie de la population.
Nous n'avons marché que quatre heures ; je trouve que c'est une étape
trop courte, mais les Indiens ne veulent pas aller plus loin sous prétexte que
nous avons fort peu mangé la veille et qu'aujourd'hui nous n'avons absolument
que de la cassave et un peu de riz.
Pendant que mes hommes coupent du bois pour faire du feu et construisent des ajoupas pour nous abriter, un jeune Indien nomme Yami (ce qui signifie tortue) demande mon fusil pour aller à la chasse. Je n'hésite pas à le lui confier après lui avoir montre la manière de s'en servir.
J'ai faim. Apatou me fait cuire une poignée de riz à
l'eau. N'ayant plus ni cuillers ni fourchettes, et n'étant pas assez habile
pour me servir de bâtonnets comme les Chinois, je fais de grosses boulettes
que j'ingurgite à la hâte.
Mon frugal repas est interrompu par l'arrivée du jeune Yami, le fusil en main
et portant sur le dos un catouri fait avec des feuilles fraîches de palmier
et contenant un gros quartier de tapir que le chasseur à bien enveloppée pour
éviter des taches de sang dont les Indiens Oyampys ont horreur.
Un tapir tué raide d'un seul coup de fusil et avec du petit plomb me parait un fait merveilleux puisque j'ai vu a mon dernier voyage des chevrotines envoyées à une distance de sept à huit mètres s'arrêtent sur la peau. C'est que Yami, ayant trouve l'animal endormi, s'est glissé avec la légèreté et la ruse d'un jaguar jusqu'à une distance de deux mètres de son gibier, et, ayant mis le genou à terre, il l'a ajusté au défaut de l'épaule. La charge à fait balle, et l'animal a succombé sur place.
Apatou découpe immédiatement un filet qu'il fait griller à la manière Indiens, c'est-à-dire au bout d'un bâton recourbé dont l’autre extrémité est enfoncé en terre. Le gibier est coupé par quartiers et mis à boucaner pendant toute la nuit.
20 septembre. — A six heures du matin, c'est-à-dire au
lever du soleil, je vois mes Indiens ayant le catouri sur le dos défiler à coté
de mon hamac. Cette diligence à se mettre en route me fait plaisir, mais j'entends
Apatou qui leur crie d'arrêter. C'est que, se trouvant trop chargés, ils ont
laissé non seulement une partie de mes bagages, mais toute la viande boucanée.
Pour la conserver jusqu'à leur retour, ils l'ont enfouie en terre en ayant soin
de disposer des branchages au fond du trou, et d'entourer la viande de beaucoup
de feuilles.
Les jeunes gens sont loin ; je suis obligé de
donner un surcroît de bagages à Jean-Louis et à ses deux femmes.
Partis à sept heures et demie, nous traversons la rivière Leblond deux heures
après. Arrivée à cette hauteur elle ne mesure déjà plus que huit mètres de largeur
sur dix à quinze centimètres de profondeur.
En suivant ce tours d'eau nous voyons que son volume décroît rapidement, puisqu'à
onze heures il n'a déjà plus que quatre mètres de largeur sur dix centimètres
de profondeur. Un peu au-dessus, nous le voyons se diviser en deux branches
qui ne sont plus que des ruisseaux insignifiants.
Ayant remonté celui de droite, nous remarquons qu'il prend naissance au pied
d'une grosse roche granitique sur laquelle sont quatre dépressions disposées
de manière à représenter l'empreinte de la patte d'un gros tigre.
Les indigènes prétendent que cette marque dans la roche a été produite par un tigre sorcier (Yauarpiay) qui garde les sources de l'Oyapock. Nous avons pu constater que ces excavations n'ont pas été creusées par l'homme; c'est par un effet du pur hasard que ces cavités simulent grossièrement la piste du féroce animal.
Il y a douze heures de marche effective pour aller du dégrad actuel aux sources, tandis que l'ancien n'était qu'à une distance de quatre heures.
L'Oyapock se termine comme le Maroni; il se divise en
une infinité de criques qui se ramifient au pied des monts Tumuc-Humac. Son
parcours est de quatre cent quatre-vingt-cinq kilomètres environ en comptant
les détours, tandis que le Maroni en mesure six cent quatre-vingts.
Le débit de l'Oyapock est plus considérable que celui du Rhône et de la Loire,
qui mesurent pourtant mille kilomètres.
L'importance des fleuves de la Guyane provient non seulement de l'abondance
des pluies, mais de l'imperméabilité du sol.
L'argile si utile à l'Indien pour la fabrication de ses poteries ne manque nulle part dans toute la région.
IX
Origine du mot Tumuc-Humac. — Perdus dans le bois. — Rectification cartographique. — II faut réduire des deux tiers le cours de la rivière Anasurapucu.— Oyampys déguisé en jaguar. — Pourquoi Pagami est-il qualifié de trompette ? — Collections ethnographiques, Flûtes analogues à celles des Romains, couronnes, paniers. — L'arouma. — Comparaison de l’oyampys avec les autres langues de l'Amérique du Sud. — Mots français empruntés aux sauvages de l'Oyapock.
La fameuse roche Yauar est située au pied d'un pic sur
la gauche duquel passe le sentier qui va des sources de l'Oyapock au Rouapir,
un affluent de la crique Kou qui se jette dans le Yari.
Je ne saurais passer près de cette montagne sans la visiter. Je m'empresse de
l'escalader avec Apatou et Yami qui nous sert de guide.
Depuis le sommet qui, d'après l'indication de mes baromètres, n'est pas à plus de trois cent trente mètres au-dessus du niveau de la mer, nous trouvons une éclaircie qui nous permet de reconnaître des collines lointaines entre lesquelles on voit la naissance de l'Oyapock.
Les éminences formées de roches granitiques sont la continuation de la chaîne de montagnes que les géographes appellent Tumuc-Humac ou Cumuc-Humac, tandis que les Indiens la qualifient quelquefois du nom de Coumou-Coumou. Ils l'appellent ainsi du nom du palmier coumou (cenocarpus bacaba) dont le fruit noir écrasé dans l'eau chaude donne un suc de la couleur du café au lait, très recherche par les indigènes. On voit dans le Maroni, un peu en aval du village de Cotica, un saut qui porte le même nom.
Nous trouvons également le nom de Cumu-Cumu servant à designer une montagne qui se trouve dans la Guyane anglaise entre les sources de l'Essequibo et du rio Branco.
Nous revenons vers une heure à la roche Yauar pour nous remettre en route, mais voila que Yami, entraîné à la poursuite d'un hocco, s'est séparé de nous.
Les Oyampys qui ne s'occupent pas des retardataires ont
tous défilé sans s'inquiéter du blanc. Ne voyant aucune trace de chemin,
j'éprouve un moment d'inquiétude, mais Apatou, très habitué à la piste Indienne,
ne tarde pas à nous remettre en bonne direction.
Mon meilleur baromètre, qui au sommet du pic indiquait sept cent vingt-sept
millimètres, en marque sept cent trente-trois, ce qui ferait une différence
de hauteur d'environ soixante mètres entre le sommet du pic et la roche Yauar.
A une heure douze minutes nous voyons une fontaine qui
coule vers le sud. Ses eaux dirigées en sens opposé de l'Oyapock sont nécessairement
tributaires de l'Amazone; c'est la source d'un affluent du Yari, le Rouapir,
qui se trouve à dix minutes de marche de celle de 1'Oyapock.
Ce fait est en contradiction avec les cartes qui représentent une grande rivière
entre l'Oyapock et le Yari. A ce niveau le baromètre marque sept cent trente
quatre.
Nous faisons route vers le sud-ouest et nous ne tardons
pas à voir sur notre gauche une colline où l'on vient de faire un abatis pour
planter du manioc.
Au pied coule le Rouapir qui grossit à vue d'oeil, grâce à la convergence d'une
infinité de ruisseaux. Nous arrivons à deux heures cinquante à un village d'Indiens
Oyampys qui renferme environ trente habitants.
Nous avons fait dans la journée vingt-quatre mille quatre cents pas, dont deux mille en fausse direction, pour visiter le pic qui sépare le bassin de l'Oyapock de celui de l'Amazone.
Le Rouapir qui coule prés du village est déjà assez large pour nous donner la satisfaction de prendre un bain délicieux. Il n'a pas moins de six mètres de largeur sur quarante centimètres de profondeur, et il serait navigable pour une petite pirogue si on se donnait la peine de couper les arbres qui interceptent son tours.
On voit ainsi que depuis l'ancien dégrad des Banares dans la crique Leblond jusqu'au point où le Rouapir pourrait être navigable il n'y a pas plus de quinze kilomètres en comptant les détours et de dix environ en ligne droite.
Les Indiens Oyampys, qui ont été prévenus de notre arrivée et qui par conséquent ont eu le temps de mettre ordre à leur toilette, ont autant de goût pour la peinture que les Indiens Roucouyennes ; je ne trouve pas un homme ou une femme qui ne soit bariolé de rouge et de noir des pieds à la tête. Celui qui se croit le plus beau de tous est le chef de la tribu, qui a tout le corps recouvert de taches noires sur un fond rouge. Il a voulu sans doute ressembler au yauar qui, chez tous les Indiens, est considéré comme le roi des animaux.
Mon équipage ayant abandonne la viande du tapir, nous n'avons à manger qu'un massacara, c'est-à-dire un coq que le tamouchy me donne en échange d'une petite glace dans laquelle il est très heureux d'admirer les moustaches que sa femme lui a dessinées avec du genipa. Heureusement Yami revient bientôt avec deux agamis qu'il a tirées en route. L'oiseau trompette est ainsi nomme parce que son cri ressemble non pas à une trompette de cuivre, mais une corne de berger.
Un médecin hollandais du siècle dernier, Fermin, a cru longtemps que l'appareil musical de l’oiseau trompette n'était autre que l'extrémité inférieure du tube digestif. Les Oyampys partagent complètement cette opinion, parce qu'en appuyant sur le croupion d'un agami mort ils déterminent un bruit sourd semblable à celui que produit l'animal pendant la vie.
Jamais ils ne tuent un mainhali sans répéter cette expérience qui fait toujours rire l'assistance.
Jean-Pierre, qui s'était engagé à m'accompagner jusqu'au pays des Roucouyennes, dit qu'il est trop vieux et trop fatigué pour marcher davantage. Je consens à le laisser retourner parce que Saba et les deux noirs que j'ai laissés au dégrad des Banares doivent attendre son retour avec impatience ; mais il faut que je recrute d'autres porteurs.
Je passe donc la soirée à causer avec le tamouchy et à aller de case en case pour enrôler des hommes.
Comme la pacotille que j'ai apportée plait beaucoup à ces Indiens, je puis non seulement me procurer des porteurs à discrétion, mais toutes sortes d'objets de curiosité que Jean-Pierre conduira dans le bas Oyapock.
Entre autres choses je collectionne des flûtes en tibia de biche, qui portent trois trous et une petite encoche sur la face postérieure, et de jolies petites couronnes qui servent à maintenir les cheveux. Elles sont de trois couleurs; les unes, noires, sont faites avec les plumes du sommet de la tête de l'agami; d'autres, qui sont blanches, sont composées de plumes provenant du poitrail d'une espèce de toucan appelé Couyapock (Rhamphastus toco), qui se distingue par son large poitrail blanc portant un liseré rouge à la partie inférieure; enfin une troisième espèce, qui est la plus jolie, est formée de quatre segments égaux, dont deux rouges et deux jaunes. Ces plumes qui présentent des couleurs très vives proviennent du poitrail d'une autre espèce de toucan appelée Cui-cui par les indigènes(Rhamphastus Vitellinus) et dont la partie supérieure est rouge et la partie inférieure jaune; à l'arriere pend à un fil le petit poitrail rouge de feu d'un oiseau-mouche.
Pour faire leurs couronnes, les Oyampys comme les Roucouyennes montrent une habileté et une patience admirable; les plumes sont fixées avec un fil de coton enroule sur un cercle fait d'une liane fondue appelée mamie qui jouit d'une grande flexibilité, de sorte qu'on peut la retourner à volonté. Par suite de ce renversement, les plumes qui étaient en dehors passent en dedans et ne sont pas exposées à être froissées quand 1'Indien rentre la parure dans son pagara.
Leurs paniers appelés pagaras sont composés comme tous
ceux des Galibis et des Roucouyennes de deux parties qui s'emboîtent comme les
doubles caisses dont se servent actuellement nos commis voyageurs pour y mettre
leurs échantillons.
Ils les suspendent au moyen d'une corde fixée par les deux extrémités à la caisse
inférieure qui est destinée à rentrer dans l'autre. La corde glisse sur les
deux cotes de la caisse extérieure où elle est maintenue par un anneau en ficelle.
Au moyen de cette disposition on peut enfoncer les deux parties l'une dans l'autre
en tirant sur l'anse qu'on porte à la main.
Le pagara des Oyampys est fait avec l’écorce d'arouma (stromanthe sanguinea),
employée par tous les indigènes de la Guyane comme l'osier en Europe pour
faire des objets de vannerie. Les petites baguettes disposées à angle droit
sont fixées à chaque intersection par des fils de colon croisés en X qui forment
une espèce de broderie composée de petits losanges.
Apatou achète un chien qu'il a la prétention de vouloir
conduire jusque dans le haut Yari, où son frère et sa jeune soeur la belle Ayouba
doivent venir à notre rencontre.
Je m'arrête un jour en attendant les préparatifs de mes nouveaux porteurs.
Je profite de ce délai pour apprendre l'oyampys.
Le tamouchy me sert volontiers de professeur à condition que je lui apprenne ma langue. Je suis étonné de la facilité avec laquelle il prononce le français; suffit que je lui dise une fois un mot pour qu'il le répète correctement. Il prononce les r aussi nettement que le Français de la métropole.
Un certain nombre de mots oyampys sont identiques à différents idiomes de l'Amérique du Sud; par exemple, les mots : baco, bananes; paira, are; coui,calebasse; couyou, vêtement ; yaman, tête ; banaré,ami, sont employés par les Galibis aussi bien que par les Indiens des sources de l'Oyapock.
D'autre part les mots: toupan, tonnerre; oka, carbet; aouassi, mais; yauar, tigre ; uh, eau; di, paresseux (Bradypus), petum, tabac, trouvent des analogues dans la langue que parlaient les Toupinambas de la baie de Janeiro visites par Jean de Lery en l'année 1557.
La plupart de ces mots se trouvent dans la linguagera ou langue tupis usitée actuellement chez les Indiens habitant les rives de l'Amazone.
Les Oyampys appellent leurs hamacs, qu'ils font en coton, ini. Nous pensons que c'est ce mot qui a servi à designer la rivière Inini dont nous avons parle.
Un certain nombre de mots français tirent leur origine de l'oyampys. Nous citerons entre autres les mots pirogue, qui signifie petit canot, et aï, qui dans les deux langues sert à designer l'animal que les créoles de Cayenne appellent mouton paresseux à cause de son poil touffu et de sa lenteur.
X
Jean-Pierre dans les honneurs. — Une rivière à chaque pas. —Vernis noir sur les roches. — La cigarette des Oyampys. —Chasse à l'agouti. — Moeurs des Indiens. — L'art culinaire en déshonneur chez les hommes. — Manières spéciales de manger et de s'asseoir. — Arrivée chez Acara. — Un heureux mortel.— Une situation lamentable. — Manière d'éloigner les serpents. — Un Indien qui a quelque ressemblance avec les Chinois. —Les Oyampys savent dessiner.—Vêtement appelé couyou.— Les Pleiades servent à indiquer les saisons. — Un singe qui casse des noix. — Indications géographiques. — II n'y aura bientôt plus d'Indiens. — Absence d'embarcation au dégrad. — Nous construisons une pirogue d'écorce.
22 septembre. — A sept heures nous buvons le cachiri qui a été fabriqué à l'occasion de notre arrivée.
J'ai beaucoup de peine à faire partir mon équipage et mes porteurs. Apatou est désolé de ne pas retrouver son chien au moment du départ; il a beaucoup de mal à obtenir qu'on lui rende le couteau qu'il avait donné en payement.
En faisant mes adieux à Jean-Pierre, je lui remets devant tous les Oyampys assemblés un ceinturon d'uniforme, qu'il met aussitôt autour de son gros ventre, et une vieille dragonne qu'il se suspend au cou.
Il me dit à cette occasion que son père a toujours bien servi les Français depuis que son grand-père a reçu une canne de tambour-major et une médaille d'un chef blanc qui allait visiter les Oyampys. J'ai su depuis que l'auteur de ces cadeaux était l'ingénieur Bodin, qui en 1823 a remonté l'Oyapock jusqu'aux Trois Sauts. Ce voyageur, qui était en nombreuse compagnie, a été obligé de battre en retraite à cause de la fièvre qui sévissait sur lui et son escorte succomba, ainsi que plusieurs compagnons, quelque temps après son retour à Cayenne.
Nous nous mettons en route à huit heures avec mes trois noirs, dix Indiens et deux femmes. Le jeune Yami est exempte de porter des bagages afin qu'il puisse chasser en route.
Beaucoup de roches des ruisseaux que nous traversons, sont couvertes d'un enduit noir luisant, que nous avons déjà trouve dans le Maroni et le Yari, non seulement sur les roches, mais sur les troncs d'arbres émergés dans la saison des pluies. Ces dépôts, signalés dans presque tous les affluents de 1'Amazone, ne sont autres que du carbonate de chaux englobant des matieres organiques.
Je marche avec peu d'entrain parce que j'ai mal dormi et que depuis vingt-quatre heures je n'ai mangé que de la cassave. En voulant franchir un gros tronc d'arbre, je fais un effort insuffisant pour l'escalader et retombe en arrière. En me relevant, je sens ma jambe enlacée par un corps rond et froid qui me donne le frisson; je crois être saisi par un serpent, mais c'est une liane qui dans la chute s'est enroulée autour de mon pied.
En arrivant au campement, Apatou m'invite à prendre un bain: je refuse ; j'ai si faim que j'évite tout exercice qui ne ferait qu'augmenter mon appétit. Je m'étends dans mon hamac en attendant que chasseurs et pécheurs apportent à manger. Mais le soir arrive et nous n'avons ni Poisson ni gibier; il faut nous contenter pour souper d'une espèce de panade faite avec de la cassave bouillie dans l'eau. Heureusement je me suis procure au dernier village une carotte de petum, c'est-à-dire de tabac, dont je fais de grandes cigarettes avec une écorce appelée taouari par les Oyampys.
Je m'exerce à les rouler à la façon Indienne en faisant des mouvements de va-et-vient avec la paume des mains.
Il n'y a rien de tel que la misère pour réveiller les souvenirs du pays natal. Aujourd'hui, dimanche, c'est la fête de mon village. A cette heure même on mange des pâtes, des tartes, des gâteaux, on boit des vins exquis, on prend du café délicieux, des liqueurs, du champagne, tandis que moi, qui n'ai pourtant commis aucun crime, je dois me coucher sans souper. Apatou, à qui je fais mes confidences, me trouve si triste qu'il se met à rire de bon coeur.
23 septembre.—N'étant pas retardés par le déjeuner, nous sommes en marche à six heures et demie. Nous nous dirigeons au sud-ouest après avoir traversé plusieurs ruisseaux qui apportent leurs eaux au Rouapir.
A neuf heures, Yami, en marche devant moi, s'arrête brusquement : il vient d'entendre un agouti. Il roule une feuille en cornet et se met à siffler avec cette espèce d'appeau en imitant le cri de l'agouti; quelques instants après je vois ce gibier défiler, mais je le manque. Yami me conduit à la requête, et bientôt nous entendons du bruit dans un tronc d'arbre creux.
Yami coupe un bâton et l'enfonce dans l'arbre; l'animal
fait un grognement effrayant, brou..., brou..., mais ne vent pas quitter son
repaire. Apatou arrive, fend l'arbre à coups de hache, et le pauvre agouti est
tué à coups de bâton.
Nous faisons halte pour le faire bouillir.
Mes Indiens, bien que pressés par la faim, restent immobiles et regardent faire les femmes. Ce sont elles qui allument le feu et vont chercher de l'eau qu'elles font chauffer pour échauder l'animal; puis elles le raclent comme un petit cochon. Ensuite l’animal est ouvert à coups de couteau, et on en retire les viscères. Un Indien prend le foie, et, l'enfilant au bout d'un bâton plante en terre, le fait rôtir à la flamme. Après quelques minutes il le trempe dans l'eau bouillante, m'en donne un petit morceau et partage le reste avec plusieurs camarades. Chacun n'en a qu'une bien petite part, mais l'Indien la savoure avec de la cassave qu'il fait tremper dans la soupe.
Je remarque que les Oyampys, comme tous les Indiens, ne mordent pas comme nous dans la viande à belles dents, mais la déchirent avec les doigts et la portent à la bouche par petits morceaux.
La main gauche leur servant d'assiette, ils tiennent le morceau de cassave qui remplace le pain entre l'auriculaire et l'annulaire de la main droite, tandis que le petit morceau de viande est maintenu entre le ponce et l'index. Ils économisent du travail en n'employant qu'une main pour porter la viande et le pain à la bouche.
La cuisinière, la plus âgée des femmes, continue à faire cuire la viande, qu'elle remue de temps à autre avec une palette en bois. Elle active le feu avec une espèce d'éventail en feuilles de palmier tressées, sans craindre de m'envoyer des cendres dans les yeux, et lorsque le bouillon va s'échapper, elle arrête l'ébullition en projetant avec la bouche une pluie d'eau dans la marmite.
Apres une demi-heure de cuisson le gibier est partagé entre les seize convives. On fait cercle autour de la marmite, les hommes accroupis sur leurs pieds qui ne touchent le sol que par la plante, les femmes assises sur les jambes repliées sous le corps. On finit le repas en cassant les os avec une pierre pour en savourer la moelle.
Ensuite chacun allume une cigarette, et nous reprenons la route à onze heures et demie. Je marche gaillardement et pourtant mon caractère devient désagréable. Je réprimande Apatou qui a rencontre de magnifiques aras rouges et bleus, mais n'a pas pu les tirer, ayant donné son fusil à un Indien reste en arrière. Celui qui nous a montre les aras court au devant du retardataire et apporte le fusil; mais voilà qu'il n'est pas charge. C'est toujours la faute d'Apatou. Je me sens sous le coup d'un accès de fièvre. Nous arrivons à une heure et demie à une crique assez large appelée Piraouiri.
Les Oyampys s'arrêtent pour prendre un bain et faire
leur toilette. Pendant que mes élégants compagnons arrangent leurs colliers
et se peignent les cheveux, j'entends un oiseau qui fait coo-coo. aussitôt
aperçu je le tire et l'abats. Au moment où je ramassais mon gibier, un Indien
furieux parait et me dit toutes sortes de choses sans doute désagréables, bien
que je ne comprenne que le mot nicatou, qui veut dire pas bon. C'est
que je viens de tuer un beau hocco bien apprivoise qui appartenait au tamouchy
du village où nous arrivons à deux heures.
II est inutile de dire que nous sommes fort mal reçus, mais je me hâte de réparer
ma maladresse en payant largement le propriétaire de l'oiseau.
Acara, c'est le nom du tamouchy de ce village qui n'est composé que de quatre maisons dont une abandonnée, est un jeune homme, grand, bien fait, un joli garçon qui vit paisiblement dans son petit coin de terre avec sa mère et deux jolies petites femmes qui paraissent l'aimer tendrement.
 |
Sa mère est grande et svelte, mais elle est affligée d'une luxation interne des orteils : ce qui constitue une infirmité assez fréquente chez les Indiens et qu'on désigne sous le nom d'ocopi.
Je constate que les Indiens Oyampys, comme les Roucouyennes, ont à l'état normal une déviation constante des orteils. Le pouce fortement écarté regarde toujours en dedans, tandis que le troisième, le quatrième et le cinquième sont tournés en dehors.
Un assez grand nombre d'entre eux ont également les jambes courbées en dedans.
Mes Indiens ne voulant pas toucher à mon hocco, parce qu'ils trouvent abominable de manger la chair d'un animal domestique, j'en fais un grand régal avec mes noirs qui paraissent très heureux de ce préjugé.
Le lendemain Apatou est de mauvaise humeur parce qu'il a mal au pied; ce n'est qu'une épine enfoncée dans le talon qu'une femme arrache avec un os effilé comme une aiguille. Il me demande à passer un jour ici parce qu'il ne peut pas marcher; je n'insiste pas pour partir, j'ai moi-même besoin de repos.
Je me sens tout étourdi et ne tarde pas à éprouver une sensation de froid, bien que le soleil soil déjà haut. Sans rien dire, car je ne veux pas effrayer mes compagnons, je vais me coucher dans un hamac qui est au premier étage de la vieille maison.
Quelques minutes après je tremble, mes dents claquent et j'éprouve une soif inextinguible.
Au plus fort du frisson une des cordes du hamac casse et je tombe assis sur le plancher pourri qui menace de s'effondrer. La secousse est telle que, n'ayant plus la force de me relever, je reste là jusqu'au retour d'Apatou qui vient par hasard chercher quelque chose dans la hutte.
Il amarre mon hamac, et je me recouche pendant qu'il fait des fumigations sur des charbons ardents.
Je croyais qu'il voulait désinfecter l'air, mais il me dit avoir vu un serpent se réfugier dans les feuilles de la toiture. Il est certain, dit-il, de le mettre en fuite en brillant des graines de coton.
Enfin vers quatre heures, l’accès passé, je vais prendre un bain et je dis à mes hôtes, inquiets de ma maladie, que mon malaise n'est que passager.
25 septembre. — Je croyais exagérer en les rassurant ainsi, mais après une bonne nuit je me trouve assez valide pour me mettre en route.
Départ à sept heures vingt-cinq, route au sud-ouest.
Nous continuons à traverser une infinité de cours d'eau parmi lesquels je citerai seulement la crique Yenouparaou que nous longeons pendant quelque temps. Dans les premiers moments de la marche, j'éprouve de la sécheresse de peau et une soif assez vive que je ne puis tarir, Bien que je boive à tous les cours d'eau. Enfin vers dix heures, ayant traverse une petite montagne d'un pas accéléré, je sens la sueur perler sur mon front et alors j'éprouve un sentiment de bien-être.
En continuant notre marche nous traversons les criques Timboraou et Ourouapi, qui, comme la crique yenouparaou,, n'ont d'autre intérêt que leurs noms qui out une signification dans la langue des Oyampys.
Yenoupa est le nom d'un fruit, le genipa americana,qui, lorsqu'on le coupe, noircit au contact de l'air et fournit cette couleur noir bleuâtre avec laquelle les Indiens Oyampys se bariolent tout le corps.
Le mot Timbo est le nom du Robinia Nicou qui sert à enivrer le poisson, et ourou signifie cassave.
A onze heures cinquante-quatre, après avoir fait quatre heures de marche effective et vingt mille deux cents pas, nous nous arrêtons à une habitation dont le chef s'appelle Kinoro ; c'est le nom d'un ara rouge qui a des taches jaunes sur les ailes (Ara Canga).
 |
Je passe l'après-midi à observer mes hôtes et à apprendre leur langue. Je remarque un vieillard qui par exception porte la barbe, c'est-à-dire quelques rares poils noirs et assez durs au-dessus de la lèvre supérieure et du menton. Cet homme, avec sa barbe tout à fait insérer comme celle de la race asiatique, avec ses pommettes saillantes, son teint jaune, ses yeux obliques et légèrement brides en dehors, ressemble à un Chinois.
Les Indiens ont l'habitude de s'épiler de la manière suivante. Ils saisissent le poil entre une lamelle de bambou et le pouce et l'arrachent ou le cassent en faisant un mouvement de bascule.
Les Oyampys portent les cheveux très longs et flottants,mais coupés carrément sur le front à la hauteur de l'arcade sourcilière. Les femmes se coiffent absolument de la même manière que les hommes ne mettent jamais de couronnes pour maintenir leurs cheveux.
Je m'amuse à reproduire les figures et les arabesques dont sont couverts les gens du village. Elles présentent beaucoup d'analogie avec les gravures de la roche Timeri du Maroni. Il me vient ensuite l'idée de tailler un morceau de charbon et de le donner au capitaine Jean-Louis en le priant de dessiner sur mon cahier, qu'il nomme careta, tandis qu'il appelle les dessins qu'il exécuté coussiouar. Jean-Louis ne sait guère dessiner. Au contraire le jeune Yami me fait rapidement, non plus avec du charbon, mais avec un crayon, des dessins d'homme, de chien, de tigre, enfin de tous les animaux et diables du pays.
Un autre Indien reproduit toutes sortes d'arabesques
qu'il a l'habitude de peindre avec la genipa.
Ayant donne quelques aiguilles à mes dessinateurs, c’est à qui me demandera
un crayon pour noircir du papier.
Je vois que ces sauvages qu'on accuse d'être absolument ignorants des beaux-arts dessinent tous avec une facilité extraordinaire ; les femmes elles-mêmes, que les voyageurs ont l'habitude de décrire comme des bêtes de somme, me demandent également des crayons pour gagner quelques aiguilles en reproduisant les dessins qu'elles ont l'habitude d'exécuter sur leurs poteries.
Pendant que nous nous livrons à ces études un chien arrive au milieu de nous. Il remue la queue et se met à caresser son maître en ayant l'air de l'engager à le suivre. Apatou, qui a entendu dire que ce chien est très habile à la chasse du pakira, m'engagea aller dans le bois avec l'Indien.
Aprés dix minutes de marche le chien entre dans un terrier de tatou. Nous entendons des aboiements et des grognements : c'est le chien qui est aux prises avec le pakira; enfin celui-ci sort du cul-de-sac dans lequel il est traqué, et Apatou le tue raide d'un coup de sabre qu'il lui assène sur la tête. Le chien parait radieux de son exploit, bien qu'il ait reçu quelques coups de boutoir qui l'ont blessé au cou.
Le pakira (Dicotyles torquatus), appelé aussi
pécari à collier, à cause d'une raie blanche qu'il porte au niveau des
épaules, est un des gibiers les plus savoureux de l'Amérique du Sud. N'ayant
pas d'odeur prononcée il donne la meilleure soupe qu'on puisse faire en voyage.
Je fais distribuer tout le corps pour le repas du soir et je garde la tête pour
le lendemain matin.
Stuart, qui est devenu mon cuisinier, allume du feu à deux heures du matin et
fait bouillir cette tête jusqu'au jour dans une grande marmite de campement
en fer battu qui constitue toute notre batterie de cuivre.
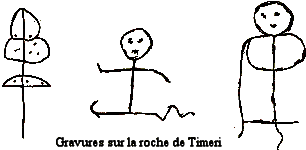 |
26 septembre. — Nous prenons notre repas au lever du soleil, suivant l'usage que nous avons adopté en nous conformant aux moeurs des indigènes. Les Oyampys en voyage font deux bons repas, un avant le départ, l'autre le soir. En route on grignote seulement vers midi un morceau de cassave trempé dans l'eau fraîche d'une crique et un peu de viande boucanée, si par hasard il en reste du repas du matin.
Partis à six heures et demie du matin nous arrivons à
une habitation isolée. Nous trouvons un homme seul avec des femmes. Il nous
informe que nous ne sommes pas éloignés d'un village plus important.
Nous nous arrêtons quelque temps pour manger un melon très rafraîchissant et
ramasser quelques haricots à graines très larges cultivés autour des habitations.
Nous regrettons de ne pouvoir en recueillir que quelques
poignées, car depuis notre départ nous n'avons pas mangé de légumes: notre nourriture
a été exclusivement composée de cassave, de viande ou de poisson bouilli avec
l'achi traditionnel.
Je me procure aussi un hamac qu'une femme vient d'achever et m'offre d'échanger
contre un couteau. Le lit portatif des Indiens Oyampys est tissé de coton comme
celui des Roucouyennes, mais il est à mailles plus serrées.
J'ai le plaisir d'acheter un couyou, qui est une fort belle curiosité ethnographique.
 |
Ce vêtement est appliqué entre les cuisses par le milieu, tandis que les extrémités passées sur une petite ceinture en coton tombent en avant et en arrière. II mesure un mètre quarante de long et, sa largeur est trente-quatre centimètres au milieu et quarante-cinq aux extrémités. Fait de coton Blanc, il est ornemente de raies noires formant des arabesques et de franges tombant aux quatre coins. La coloration noire est obtenue au moyen d'une infusion faite avec la feuille d'une liane dans laquelle Gravure sur la roche on trempe les fils de coton avant de procéder au tissage. La perfection de ce tissu exécuté par des gens absolument sauvages ne le cède en rien aux travaux fabriqués dans nos ateliers.
A neuf heures, après avoir parcouru une distance totale de dix mille pas, nous arrivons à l'habitation du tamouchy Tapiira, où il y a une vingtaine d'habitants.
Le capitaine Jean-Louis nous avait dit que nous trouverions là des hommes pour nous montrer le dégrad du Rouapir et nous conduire jusqu'au pays des Roucouyennes, mais les Indiens que nous rencontrons nous disent qu'il n'y a pas de canots au dégrad, que par conséquent il est inutile d'aller jusque-la puisqu'il nous sera impossible de descendre cette rivière.
Les braves gens pensaient que ces arguments suffiraient pour nous faire retourner à l'Oyapock, mais je leur dis que s'ils ne veulent pas nous conduire au Rouapir, nous irions quand même et quitterions leur village sans leur donner de couteaux.
Enfin, après avoir délibéré longtemps, cinq d'entre eux se décident à m'accompagner à un dégrad nous trouverons des arbres dont l'écorce se détache facilement; l'un d'eux avoue connaître la fabrication des pirogues en écorce.
Je passe l'après-midi à monter dans les oka, c'est-à-dire les carbets, pour amasser des vivres. J'ai beaucoup de peine à recueillir un peu de cassave, des bacoves, du maïs et une portion de singe boucané.
Je ne suis malheureusement pas secondé par mes noirs qui passent leur temps à se quereller au sujet de la cuisine. Stuart boude comme un enfant parce que nous n'avons à manger que de la viande d'une espèce de daim appelé cariacou, qui à Surinam passe pour donner le cocobé, c'est-à-dire la lèpre. Je dors peu pendant la nuit à cause de la fièvre et de l'inquiétude de voir ma mission échouer par le mauvais vouloir des Oyampys qui veulent nous empêcher de porter nos objets d'échange dans le pays des Roucouyennes.
Je vais m'asseoir à cote d'un Indien qui fait du feu en roulant vivement un roseau dans une cavité creusée dans une tige de roucou. En cinq minutes il enflamme un morceau d'étoupe ou d'amadou placé dans une échancrure située sur le bord de l'excavation qu'un Indien à faite sous son hamac.
J'allume une cigarette et passe une heure à causer et à regarder les étoiles. Mon compagnon me montrant les Pléiades me demande comment elles s'appellent, et me dit que dans sa langue elles se nomment Eiou.
Les Pléiades sont connues de tous les indigènes de la Guyane française; ils saluent avec joie leur retour à l'horizon parce qu'il coïncide avec le commencement de la saison sèche. Leur disparition qui a lieu vers le mois de mai est accompagnée d'une recrudescence de pluies qui rend les tours d'eau tellement impétueux que la navigation est absolument impossible.
Les Bonis, qui appellent les Pléiades Sebita, prétendent que les serpents cessent d'être venimeux au moment de la disparition de ces étoiles.
M'étant couche à quatre heures du matin, j'ai beaucoup de peine à me réveiller, et pour me donner de l'entrain je suis obligé d'aller prendre un bain glacé dans la crique voisine.
Vers neuf heures j'entends un bruit sourd qui ressemble au choc d'une hache contre un arbre. Nous étant portés dans cette direction, nous apercevons un gros singe noir, un couata assis sur une branche, qui tient un fruit dur entre les deux mains, et essaye de le briser en frappant sur l'arbre. Cet animal étant très occupé à cette opération, nous pouvons l'observer à notre aise. Apatou me fait remarquer qu'il ne donne que deux coups de suite, tandis que les hommes frappent à coups redoublés. L'imperfection de ses mains ne lui permettant pas de maintenir le fruit avec solidité, il est oblige d'interrompre le choc pour ressaisir l'objet qui risque de s'échapper.
Ce fruit est connu de nos créoles sous le nom de canari macaque,c'est-à-dire marmite de singe. Il est produit par un arbre connu des naturalistes sous le nom de lecythis grandiflora(Aubl.).
Ayant détache le couvercle de la marmite,nous trouvons dans l'intérieur des amandes savoureuses,mais qui ne valent pas les fruits du bertholetia.
Nous atteignons le Rouapir vers onze heures.
Au total, de 1'Oyapock au Rouapir, nous avons fait cent cinquante-six mille pas indiqués par les oscillations du podomètre. En estimant la longueur du pas moyen à soixante-dix centimetres [3], cela fait une distance de cent dix kilomètres que nous avons parcourus dans une marche effective de trentecinq heures (environ trois kilomètres à l'heure).
Sur cette distance nous avons perdu trois heures (neuf kilomètres) parce que nos guides nous ont fait faire des détours pour visiter des villages. A vol d'oiseau il y a soixante-six kilomètres environ du dégrad des Banares au point ou nous embarquons sur le Rouapir. La direction générale est sud-ouest.
Ce trajet est plus long que celui que nous avons parcouru à notre premier voyage entre le Maroni et l'Apaouani (vingt-sept heures et cinquante-quatre kilomètres à vol d'oiseau); mais il est plus facile parce que le terrain est beaucoup moins accidenté et qu'on n'y est pas exposé à mourir de faim.
En arrivant au dégrad, je vois deux Indiens que j'avais envoyés en avarice occupés à manger. Ils paraissent très désolés en me disant qu'ils n'ont pas trouvé d'écorce pour faire un canot. Connaissant leur mauvaise volonté, je vais moi-même avec Apatou faire des recherches dans les terrains marécageux qui longent le Rouapir, et cinq minutes après nous trouvons un gros arbre bien droit et dont l'écorce parait se détacher facilement. Les Indiens, obliges de s'exécuter, font autour de l'arbre un échafaudage élevé de cinq à six mètres et se mettent immédiatement à tailler un grand morceau d'écorce de forme ovalaire qui se détache d'une seule pièce et sans déchirure. Le tégument de cet arbre mis à terre et plie en forme de Canot est cousu avec des morceaux de lianes aussi facilement que s'il s'agissait d'un cuir de boeuf. On termine le travail en fixant en travers des bâtons qui serviront de bancs. Enfin, en moins de quatre heures, nous avons une embarcation qui ne vaut certainement pas une pirogue creusée dans un tronc d'arbre, mais qui est au moins suffisante pour atteindre un port peu éloigné ou nous trouverons des canots.
Docteur J. CREVAUX.
(La suite à la prochaine livraison.)
DE CAYENNE AUX ANDES,
PAR M. JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE FRANCAISE.
1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.
PREMIERE PARTIE. — EXPLORATION DE L'OYAPOCK ET DU PAROU.
XI
Une race qui s'éteint. — Piqué par un scorpion. — Suicide de cet insecte. — Un voyageur qui n'est malade que dans ses moments de loisir. — Fuite des porteurs. — Un canot au fond de l'eau; une autre avarie. — Un passage à coups de hache. — Brûlés par le suc d'un arbre. — Pêche de l'aymara. — Une tonnelle. — Indien blessé. — Honoré. — Raccommodage des canots. — On trouve des cordages et de l'étoupe dans la forêt. — Terrains noyés pendant la saison des pluies. — Toujours la hache à la main. — Déception. — Nouvelle espérance. — Un nid de mouches à miel. — Oasis au milieu du grand bois. — Le repas des serpents. — Guêpes comestibles. — Nouvelles difficultés. — Découragement. — Murmures. — La dernière cigarette.
La population de l'Oyapock diminue d'une manière effrayante si nous devons comparer les faits que nous avons observes avec les récits des anciens voyageurs. Bodin, qui n'a remonte l'Oyapock que jusqu'aux Trois-Sauts, estime la population qu'il a vue à cinq mille Ames, tandis qu'en remontant le fleuve jusqu'à ses sources et en parcourait le pays qui sépare le Bassin de l'Oyapock de celui de la rivière Kou, nous n'avons pas compte plus de deux cents Indiens.
Si cette décroissance continue, il ne restera bientôt plus d'Indiens Oyampys. Déjà les Acoquas visités par les RR. PP. Grillet et Bechamel ont disparu complètement. D'autres tribus sont sur le point de s'éteindre; ainsi les Emerillons ne comptent pas aujourd'hui plus de cinquante personnes, et les Aramichaux, qui étaient assez nombreux dans la rivière Araoua pour soutenir la guerre avec les Roucouyennes, ne sent plus représentés aujourd'hui que par un seul individu qui s'est éloigne de sa rivière pour demander l'hospitalité aux Galibis du bas Maroni.
Un journal des Missions catholiques françaises estime que la population comprise entre l'Oyapock et1'Amazone, c'est-à-dire dans le territoire contesté entre la France et le Brésil, n'est pas de moins de deux cent mille habitants. Si l'on doit juger par analogie et d'après ce qu'a vu Apatou, qui au retour du Para a relâché en plusieurs points de cette contrée, nous ne croyons pas que la population soit supérieure à deux ou trois mille habitants.
28 septembre. Nous passons la nuit dans un vieil ajoupa on j'ai fait mettre tous mes bagages à l'abri. Le matin, en passant la manche de mon paletot de laine, j'éprouve tout à coup une douleur atroce à l'extrémité de l'index. Quelle est la bête qui m'a pique? Est-ce un serpent ou une araignée-crabe? En tout cas j'ai si mal que je pousse un cri aigu qui fait accourir Apatou. Ayant lave la piqûre avec de l’acide phénique, je fais faire une enquête dans la manche de mon paletot on l'on trouve un gros scorpion noir. Mes hommes vont le tuer, mais j'intercède pour qu'on lui conserve la vie afin de faire une expérience physiologique. Les voyageurs ont dit et répété que le scorpion environné de feu ne manquait jamais de se suicider en se piquant lui-même avec ses dards venimeux. Apatou fait un cercle avec des charbons incandescents, saisit le scorpion prés de la queue pour ne pas être piqué et le place au centre du foyer. Deux secondes après, l'animal fait un mouvement convulsif et tombe comme foudroyé. Cette contraction violente qui précède la mort est bien accompagnée d'un relèvement de la queue, mais ce mouvement n'est pas assez étendu pour déterminer une piqûre à la tête.
Nous passons la journée à faire une deuxième pirogue et à charger nos bagages.
29 septembre. J’ai eu la fièvre toute la journée d'hier, mais, après un bain pris dans les eaux noires du Rouapir, je me suis trouvé à mon aise et j'ai dormi comme un bienheureux.
N'est-ce pas une chance extrême pour un voyageur de n'être malade que dans ses instants de loisir ?
J'ai été indisposé pendant tout le temps qu'on préparait mes canots, et voila, qu'aujourd'hui, au moment de m'aventurer dans des régions inconnues, je jouis d'une santé parfaite.
En me réveillant au jour, c'est-à-dire à six heures du matin, je vois mes porteurs s'en aller d'un pas accéléré. Je saute à terre et m'approche d'un Indien qui plie son hamac pour s'enfuir avec les autres. Le nomme Couassi, se sentant dans l'impossibilité de fuir, car il redoute le fusil que je porte sur l'épaule, s'exécute de bonne grâce pour remplir ses engagements.
Nous distribuons les bagages dans les deux canots et nous nous mettons en route.
A une distance de quatre cents mètres, le Rouapir, qui paraissait navigable, est obstrué par de gros arbres qui barrent le passage. Le premier est si gros qu'il serait impossible de le couper. Hopou et Stuart, qui sont dans la première pirogue, descendent à l'eau et hissent leur embarcation en la poussant par derrière. Arrivée au milieu de l'obstacle elle bascule, et, tombant dans l'eau sous un angle trop grand, disparaît aussitôt avec tous les bagages. Heureusement que le courant est nul et que la profondeur ne dépasse pas un mètre cinquante. Nous ne tardons pas à retrouver tous les objets qui avaient disparu.
Mon embarcation manoeuvrée habilement par Apatou, qui la reçoit sur ses épaules au moment on elle retombe , éprouve pourtant des avaries assez sérieuses; l'écorce écrasée en frottant sur le tronc d'arbre a subi une déchirure qui laisse pénétrer l'eau. Nous sommes obliges de nous arrêter une heure pour mettre une pièce d'écorce à notre canot qu'Apatou répare comme un vêtement déchiré.
Les autres arbres doivent être coupés à la hache, ce qui demande de longues heures de travail et des efforts inouïs de mon équipage.
Plus loin nous trouvons de petits arbres dont les branches fortement inclinées sur la rivière et se donnant la main d'une rive à l'autre empêchent la circulation.
Elles tombent sous les sabres d'abatis de mes quatre vigoureux compagnons, mais elles laissent échapper un suc blanc laiteux qui nous brûle les bras et la figure au plus léger contact.
Apatou déclare que le canotage de cette rivière est plus difficile qu'une navigation dans la forêt vierge lorsque les terres sont inondées.
A cinq heures du soir il faut songer à choisir un lieu de campement; mais les rives sont si basses, si marécageuses que nous devons naviguer jusqu'à la nuit avant de trouver un endroit propice pour nous arrêter.
Mes hommes entraînés dans la lutte n'ont pas songé à leur nourriture, et n'ayant ni poisson, ni gibier, nous sommes obligés de nous coucher après avoir soupé d'un peu de cassave trempée dans l'eau.
Je dormais déjà, d'un profond sommeil lorsque j'entends un cri d'allégresse du noir Hopou. A la lueur d'un tison je vois notre Oyampys qui donne des coups de sabre sur un animal qui se débat à terre; il tue un aymara, excellent poisson pesant cinq kilogrammes, qu'il a ramené au bout d'un gros hameçon que je lui ai donné la veille.
Tout le monde est bientôt debout. L'un va chercher de l'eau dans la marmite, l'autre écaille le poisson avec son sabre, le fend par gros quartiers, et nous attendons avec impatience le moment de la cuisson.
L'aymara, qui a beaucoup d'analogie avec nos carpes d'Europe, se tient volontiers dans les eaux calmes, se promène la nuit, tandis que pendant la journée on le trouve couché au fond de l'eau, quelquefois sur un tronc d'arbre, le plus souvent sur des feuilles ou de la vase formant un petit banc près de l'embouchure d'une petite crique.
Les Indiens ont l'habitude de le prendre avec une flèche, mais on peut le saisir avec un gros hameçon auquel on suspend de la viande ou une petite grenouille. A défaut de ce dernier appât qui est le meilleur, mon Indien s'est servi tout simplement d'un morceau d'écorce de taouari écrasée à coups de bâton. Le poisson stupide s'est laissé prendre en voyant traîner dans l'eau ces filaments rougeâtres qui ont à peu près l'apparence des fibres musculaires.
J'oubliais de dire que mon Indien a employé également un stratagème connu en Europe. Il a eu soin de faire un petit feu sur la rive ou il avait tendu ses cordeaux.
L'aymara se nourrit principalement de poissons, de grenouilles et de petites tortues. Quoique moins vorace que le piraï, il lui arrive parfois de donner un coup de dent à la main d'une femme qui lave du gibier à la rivière.
30 septembre. — La marche est encore plus difficile que la veille. Nous ne cessons de rencontrer ces arbres malfaisants aux arcades pittoresques et aux racines adventives qui se terminent par un chevelu inextricable. Apatou dit qu'il faut sortir au plus vite de ce mauvais pas, car il voit que les eaux baissent considerablement. En effet, ces radicelles qui devraient être immergées sont à un mètre au-dessus du niveau de l'eau.
Occupé à relever le tracé de la rivière, je suis exposé à me heurter tantôt contre des branches, tantôt contre ces ravines qui laissent tomber du limon desséché et des milliers d'insectes désagréables.
Dans l'après-midi le paysage change tout à fait. A ces arceaux pittoresques succède un fouillis forme par des lianes entremêlées au milieu desquelles le chemin disparaît complètement. Il faut redoubler d'efforts pour faire une tranchée.
Au premier coup de sabre nous voyons un serpent réveille en sursaut qui fuit comme un éclair.
Sur une distance de cinquante mètres nous sommes obligés de creuser une véritable tonnelle que nous mettons deux heures et demie à franchir.
Les hommes sont obligés de se relayer dans ce travail difficile ; les embarcations se remplacent à tour de rôle pour frayer la route.
Couassi, qui met beaucoup d'ardeur à la besogne, se fait une profonde entaille sur le genou et est forcé d'abandonner la partie. Je récompense son zèle en lui faisant cadeau du sabre qui l'a blessé.
Après onze heures de lutte opiniâtre contre cette folle végétation, nous trouvons une éclaircie où nous jugeons à propos de nous arrêter pour y passer la nuit.
Pendant que nous faisons bouillir un maigre honoré (botorus tigrinus) que j'ai tué dans la journée, Couassi, malgré sa blessure, se met à pêcher avec les viscères de cet oiseau qu'il emploie comme appât.
L'honoré, remarquable par sa maigreur, son air efflanqué, est très commun dans les rivières de la Guyane. Il se nourrit de petits poissons qu'il prend dans les endroits peu profonds, fuyant à l'approche d'un canot; il ne vole pas loin: on le voit se reposer tantôt sur une roche, tantôt sur un tronc d'arbre penché sur la rivière.
En moins d'une heure. Couassi a lancé sur la berge trois gros aymaras qu'il a tués à coups de sabre. Cette capture me fait un grand plaisir puisqu'elle nous donne des vivres pour trois repas. Demain je n'aurai pas l'esprit inquiété en songeant à l’alimentation de mon équipage.
Avant d'aller plus loin, je dois dire que depuis notre embarquement nous avons parcouru une distance totale de neuf kilomètres en descendant le Rouapir.
Ayant travaillé deux grandes journées pour parcourir ce trajet, nous n'avons pas fait en moyenne plus de cinq cents mètres à l'heure.
Ce qui nous désole, c'est que plus nous allons, plus nous trouvons de difficulté, puisque le premier jour nous avons avancé de cinq kilomètres en huit heures, tandis que le deuxième il nous a fallu onze heures pour quatre kilomètres. Notons que le baromètre marque sept cent trente-neuf millimètres.
1er octobre. — Au moment du départ nous nous apercevons que nos canots d'écorce font tellement d'eau qu'il est impossible d'aller plus loin sans faire de sérieuses réparations. C'est en vain qu'Apatou leur met des pièces qu'il coud avec des racines adventives que lui fournit une plante appelée mami par les Roucouyennes et camina par les nègres Bonis. Cette espèce de philodendron que l'on rencontre dans toute l'Amérique équatoriale est connue de tous les Indiens, qui s'en servent en guise de corde pour haler leurs canots à travers les chutes. Plus flexible que l'arouma elle est également employée en vannerie par les Galibis et les Roucouyennes [4].
Nous regrettions de ne pas trouver d'étoupe pour obstruer les fissures, lorsque Couassi, qui marche un peu malgré sa blessure, nous apporte une grande bande d'écorce épaisse qu'il vient d'arracher à un grand arbre, le bertholeti aexcelsa, que les Hollandais appellent toca et qui fournit une graine que les Brésiliens expédient en Europe sous le nom de castana. Cette amande, qui est très prisée des singes et des Indiens, est employée par les confiseurs français et anglais sous le nom de noix du Brésil.
Couassi coupe un morceau de cette écorce, la dresse sur le sol, et frappant sur l'extrémité libre à coups de bâton il en dégage les fibres textiles qui servent admirablement à boucher les derniers trous de nos embarcations.
Pendant que mes hommes font ces réparations, je pars le fusil sur le dos pour faire une reconnaissance. Je remarque que le terrain des alentours est très ondulé ; il semble avoir été ravage par les eaux qui ont levé la terre dans toutes les parties où elle n'était pas abritée par un arbre ou retenue par une racine. Nous voyons une infinité de petits canaux se coupant dans tous les sens qui sont remplis de limon à moitie dessèché.
C'est la région la plus malsaine que nous ayons jamais vue. Hâtons-nous de la quitter au plus vite.
Vers dix heures, la rivière se divisant en trois branches, nous nous engageons dans celle dont le débit parait le plus considérable, mais bientôt nous trouvons des troncs d'arbres et une végétation si touffue que nous sommes obligés de revenir sur nos pas. Apatou est allé en reconnaissance et pense que le bras droit est le plus favorable à la navigation. Nous y étant engagés, nous ne tardons pas à trouver les mêmes difficultés; c'est toujours la hache ou le sabre à la main qu'il faut se créer un passage.
Vers midi je remarque que la rive droite change d'aspect; elle est plus élevée et ne présente plus les salons des terres noyées pendant la saison des pluies. Bientôt nous rencontrons quelques roches granitiques qui accélèrent le courant des eaux et nous apercevons sur la rive droite l'embouchure d'une petite crique appelée Rouassaour.
La rivière est complètement dégagée, nous marchons très vite, entraînes par le courant et par les vigoureux coups de pagayes de mon équipage qui est radieux d'être sorti de ce pas difficile.
Notre allégresse n'est pas de longue durée. La rivière se redivisant pour former des Iles se laisse de nouveau envahir par cette végétation impitoyable qui semble vouloir nous enfermer dans cette région pestilentielle.
Mes hommes, révoltes contre cette nature ingrate,frappent et frappent à coups redoubles comme des guerriers dans la fureur du combat.
Enfin nous revoyons une éclaircie. Apatou distingue un carbet abandonne sur la rive droite. C'est une nouvelle lueur d'espérance puisque nous atteignons une région qui est accessible à l'homme.
2 octobre. — Pendant la nuit j'ai remarqué un bourdonnement dans le voisinage. Je croyais que c'était une chute qui se trouvait en aval, mais Apatou me dit que ce sont des mouches à miel.
Au lever Apatou prend sa hache et va couper l'arbre. Le nid étant tombe à terre, j'ai peur de me faire piquer en recueillant du miel; mais ne crains rien, me dit mon guide, les mouches sont parties.), En effet l’essaim affolé par la chute de l'arbre s'est élevé à une grande hauteur ou on le voit tournoyer.
La charpente du nid est composée d'une substance grise dont l'aspect et la consistance sont identiques à celles du papier buvard. Nous avons le regret de ne pas y trouver de cire, ce qui nous serait utile pour calfater notre canot, mais les alvéoles contiennent un mets exquis qui est très recherché des Indiens. Ceux-ci ne se contentent pas de savourer le miel, ils mangent également les larves blanches qui sont dans les alvéoles.
Hopou, voulant faire comme Couassi, mord à pleines dents dans un rayon ; mais nous le voyons faire aussitôt une grimace épouvantable parce qu'il s'est piqué à la langue; il n'a pas remarque que 1'Indien qui mange les larves a soin de les extraire délicatement avec le pouce et l'index et de les tuer avant de les introduire dans la bouche.
Quelques instants après le départ, j'aperçois une petite Ile recouverte de graminées. Ce petit pré me parait charmant parce que depuis le commencement du voyage nous n'avons pas vu un seul point de la rive qui ne fut envahi par des arbres ou au moins des arbrisseaux entremêlés de lianes. Une pelouse au milieu des forêts vierges de la Guyane est aussi rare qu'un arbre dans les steppes de la Russie et les pampas de la Patagonie.
Au moment ou je reposais mon regard sur cette riante verdure, je découvre un serpent très effilé ayant plus de deux mètres de longueur, remarquable par des taches jaunes et noires ( spilotes variabilis). Couassi m'ayant dit qu'il n'était pas venimeux, nous nous en approchons pour l'observer à notre aise. Il est en train d'avaler un rat dont la queue sortant de sa bouche fait des mouvements désespérés. Ce reptile qui se nourrit d'oiseaux, de batraciens et de petits mammifères, n'enroule pas sa proie pour la tuer comme les grandes couleuvres de la Guyane (eunectes murinus). Se jetant dessus avec la rapidité de l’éclair, il la saisit avec les dents et l'avale sans la tuer. La couleuvre arrête sa proie de la même manière, mais avant de l'ingurgiter elle ne manque jamais de la broyer entre ses anneaux constricteurs.
A neuf heures la rivière reprend /son aspect des jours précédents ; ce sont les mêmes arbres recourbes, les mêmes tonnelles qu'un poste qualifierait de pittoresques, mais que je trouve affreuses.
Au premier coup de hache donne par Apatou prouve une douleur vive sur la paupière; je viens d'être piqué par une méchante guêpe dont j'aperçois le nid au-dessus de ma tête. Apatou s'empresse découper l'arbre pour faire tomber le nid à la rivière.
Cette ruche a plus d'un mètre de hauteur, les rayons qui ne renferment jamais de miel sont occupés par des larves que Couassi s'empresse de dévorer avec de la cassave.
Cette guêpe, commune dans toute la Guyane, est très appréciée par les Roucouyennes qui l'appellent ocomo.
A trois heures nous sommes arrêtés par un gros tronc d'arbre que mes hommes épuisés mettent plus d'une heure à couper.
Pendant ce temps je vais m'asseoir sur la rive où, fatigué par une chaleur torride et mourant de faim, je regarde l'eau couler sans penser à rien. Je ne songe même pas à maudire les insectes de toute sorte qui me dévorent les jambes et la figure : la misère m'a rendu insensible.
Vers la fin de la journée nous retrouvons quelques roches granitiques au niveau desquelles la rivière n'est pas encombrée par la végétation. Le cours d'eau s'élargit un peu, mais est toujours intercepté par des troncs d'arbres.
En arrivant au campement mes hommes font du feu. Nous n'avons rien à faire bouillir. Nous n'aurons pour souper que les produits de la hache de Couassi. J'attends avec anxiété le moment où le Poisson mordra à l'amorce; je le payerais à poids d'or si je pouvais l'acheter, car en outre des fatigues physiques, je ne suis pas sans souffrir en voyant mes noirs qui ne cessent de bouder, de maugréer. Ces malheureux qui sont à bout de force sont profondément découragés. Dans la journée j'ai calmé un moment leurs récriminations en donnant un dollar à chacun pourboire un bon coup à notre arrivée au Para. Ce soir je n'ai d'autres consolations à leur donner que de partager avec eux le peu de tabac qui me reste. Je ne fume jamais sans offrir une cigarette à Apatou, qui parait très flatté de cette attention.
Quand donc arriverons-nous chez les Calayouas ? Voila quatre jours que mon guide dit demain (cobi).
Mes bagages sont en très mauvais état, car mes pirogues font beaucoup d'eau. Je passe la moitie du temps à les réparer avec de l'étoupe et de la terre glaise. C'est que toutes les ouvertures se rouvrent au moindre choc. Une partie de mes cartouches sont mouillées; la boite de mon théodolite est dans un état déplorable; je ne puis plus l'ouvrir et j'ai bien pour qu'elle n'éclate par suite du gonflement du bois.
D'ailleurs je ne pourrais faire d'observation astronomique puisque nous n'avons jamais le soleil à découvert.
Après une heure d'attente le pécheur ramène un poisson sur la rive ; on le fait vite bouillir et on le mange avec voracité. Les estomacs pleins, la barrigallena, comme disent les Espagnols, la gaieté reparaît dans le camp. Nous nous étendons dans nos hamacs et savourons notre dernière cigarette.
XII
Bagages avaries. — Petit saut. — Enfin nous atteignons la crique Kou. —Pirogues coulant bas. — Des sauveurs. — Une lettre.- Une riche collection. — Arrivée chez les Calayouas. — Besoin de repos aprês une marche vertigineuse. — Apatou malade. — Privation de sel de cuisine. — Le Yari. — Plaisir de revoir un lieu de combat. — Faut-il battre en retraite ? — En avant!...
2 octobre. — Partis à huit heures, nous sommes bientôt obligés de nous arrêter pour faire des réparations sérieuses nos canots. Par le plus grand des bonheurs, en descendant à terre Couassi reconnaît un nid de mouches à miel qui fournit de la cire. Cette espèce de mouche avait fait son nid dans un tronc d'arbre qui probablement avait été attaque par des termites.
Avec la cire qui nous sert pour calfater nos pirogues nous recueillons un miel noir qui a pourtant une saveur agréable. Nous remarquons avec satisfaction que ces insectes n'ont pas d'armes pour nous piquer.

|
A midi la rivière s'élargit au niveau de roches granitiques qui forment un petit rapide ; nous sommes dans une petite éclaircie où le soleil à pic apparaît dans toute sa splendeur. Je note que depuis mon retour à la Guyane c'est la première fois que je vois le ciel dégage de tous nuages; c'est la belle saison complètement établie, nous n'aurons plus la moindre pluie d'ici trois ou quatre mois.
A deux heures nous rencontrons une chute qui a quarante centimètres d'élévation. Hopou et Stuart,qui s'y engagent à toute vitesse, ont une chance extrême de ne pas déchirer leur pirogue contre les roches. Apatou, plus prudent, descend à l'eau et conduit mon embarcation à la main.
Si nous évitons ainsi le danger de briser l'embarcation, nous voyons l'eau qui court plus vite que le canot entrer à flots à l'arrière qui n'est ferme que par de l'argile.
Une demi-heure après nous débouchons dans la crique Kou, que Couassi prononce Ko-ou.
Cette crique est ici beaucoup plus large qu'à, son embouchure dans le Yari. C'est qu'elle n'a pm une profondeur de plus d'un mètre cinquante et que le courant est faible.
Couassi nous apprend qu'elle n'est pas loin de ses sources; en la remontant, à une heure de canotage, on la voit se diviser en plusieurs branches moins importantes que le Rouapir.
Malgré la faible profondeur des eaux nous avons peur
de submerger, ce qui nous ferait perdre nos bagages déjà profondément avariés.
Nous étions sur le point de nous arrêter pour aviser un autre système de navigation,
lorsqu'au tournant de la rivière j'aperçois des Indiens peints en rouge qui
crient de loin : « Major ! Apatou ! » Je reconnais le tamouchy Yelemeu
qu'à mon dernier voyage je suis allé visiter dans l'intérieur de la crique Courouapi.
C'est ce brave chef qui m'a fait faire de la cassave, et m'a fourni une pirogue
qui m'a permis de franchir toutes les chutes du Yari sans le moindre accident.
Je lui demande où il va.
« Oyapoko, » répond-il en montrant un papier.
Une lettre ici ? cela m'intrigue vivement; un autre voyageur serait-il venu dans ces régions ?
Mais je reconnais mon écriture; c'est une missive de l'année dernière par laquelle j'annonce au Ministère de l'instruction publique que je vais lancer mon canot à travers les chutes du Yari. Je me souviens qu'elle fut écrite au milieu de la fumée d'un bûcher sur lequel on brûlait un chef roucouyenne.
Envoie tes enfants porter la lettre, lui dis-je, et reste avec nous avec quelques peïtos (soldats); je t'ai apporte un fusil du pays des Parachichi (c'est ainsi qu'ils appellent les Français.). L'affaire convenue, j’écris au commissaire de l'Oyapock en lui recommandant de livrer au fils d'Yelemeu tant de couteaux, de sabres et de haches. J'insiste pour qu'on le traite bien puisque c'est la première fois que les Rocouyennes vont jusqu'au pays des blancs.
Nous nous séparons dans l'après-midi. Douze Roucouyennes
et le brave Couassi remontent vers l'Oyapock, tandis que je descends la Kou
avec Yelemeu et trois de ses enfants.
Les voyageurs pour l'Oyapock emportent une grande quantité d'arcs et de flèches,
des pagaras, des hamacs, des poteries, des ornements en plume,qui enrichiront
les collections du musée ethnographique de Paris. J'ai profite également de
cette occasion pour donner de mes nouvelles au monde civilise.
Le 15 octobre nous arrivons chez les Calayouas.
Je croyais trouver la une tribu d'Indiens distincte, mais je m'aperçois que
ce ne sont que des Oyampys qui ont eu quelques relations avec les Brésiliens
que les indigènes de la Guyane appellent Calayouas.
Ces sauvages ne procèdent pas autrement que les habitants de nos campagnes où
l'on appelle Parisien tout individu qui est allé à Paris.
Nous avons su depuis par le voyageur anglais B.Brown que les Indiens Wapisiana
qu'il a rencontrés dans le rio Cotinga, affluent du rio Branco, designent sous
le nom de Cariouas les soldats brésiliens de la petite forteresse de
San Joachim.
J'apprends de ces indigènes que la partie du Yari comprise entre les chutes n'est pas déserte. On y trouve des Oyampys refugiés sur le cours des petits affluents ou dans l'intérieur des terres. Je reste un jour et demi dans cette tribu pour donner un peu de repos à mes hommes dont les bras sont recouverts de vésicules produites par le suc brûlant des arbres du Rouapir. Ils sont si fatigues qu'ils ne quittent leurs hamacs que pour manger; Il est vrai que depuis quarante et un jours que nous avons laissé Saint-Georges nous n'avons eu que cinq jours de relâche, dont deux employes à construire des pirogues.
Apatou vient d'être pris d'une arthrite du coude à la suite des coups de hache répétés qu'il a donnes dans cette affreuse rivière.

|
Je fais sécher mes bagages et je les compte. Ce n'est pas sans ennui que je constate l'absence complète de set de cuisine. Une bouteille a été gaspillée, l'autre s'est égarée en descendant le Rouapir.
Nous partons le 7, escortés par une pirogue de Calayouas. Dans la soirée je suis pris d'un nouvel accès de fièvre.
Le 10 octobre nous débouchons dans le Yari.
Je ne retrouve pas sans émotion cette belle rivière que j'ai . parcourue depuis sa naissance jusqu'a son embouchure. J'éprouve le plaisir d'un soldat qui revoit son champ de bataille.
Il y aura un an, le 25 octobre, je passais devant l'embouchure de la crique Kou. J'étais à la veille d'une action décisive puisque j'allais affronter les chutes réputées infranchissables avec une escorte de deux hommes.
Ma maladie s'aggrave chaque jour, mes hommes sont fatigues et découragés. Je pourrais être indécis sur le parti à prendre.
En battant en retraite par le bas Yari je puis arriver au terme de mon voyage en dix jours, tandis que pour gagner les sources du Parou Il faut un voyage de plus de trois mois. Sans la moindre hésitation je me décide à poursuivre mon itinéraire.
A cinq heures du soir nous arrivons à une grande île de sable où l'an dernier, presque à la même époque, nous avons rencontre une bande de Roucouyennes de la tribu d'Yelemeu qui venait de faire des échanges dans l'Oyapock.
Les Indiens nous avaient affirmé qu'il y avait une épidémie de dysenterie dans l'Oyapock et des anthropophages dans le Yari.
Nous avons parcouru les deux routes sans trouver ces obstacles. Apatou en conclut que tous les Indiens sont des menteurs.
XIII
Culture du manioc. — Vie facile des Roucouyennes. — Trois malades dans une armée de quatre hommes. — Défection des convoyeurs.— Un lever de soleil. — Le dernier des Apourouis. — Le vrai nom des Roucouyennes est Ouctgana. — On en parle dans les vieux grimoires. — Gourmandise punie. — Petite guerre entre Bonis et Apourouis. — Une visite à feu Macuipi.— Sépulture d'un piay. — Législation du mariage chez les Ouayanas. — On épouse la mère pour épouser les filles. —Titres de noblesse et patrie sacrifiés à l’hyménée. — Après l'accouchement c'est l'homme qui se couche. — Asperges à l'arrivée d'un voyageur.
11 octobre. — A dix heures nous voyons un grand feu sur la rive droite. Ce sont des habitants du Courouapi qui préparent une plantation de manioc.
Suivant l'usage habituel ils ont fait l'abatis un mois avant la fin des pluies et ils y mettent le feu lorsque le bois est desséché.
Les Roucouyennes coupent les petits arbres avec le sabre et le gros avec la hache, mais, pour plus de facilité , ils n'abattent les arbres qu'à une certaine hauteur.
La plantation du manioc est des plus simples. Ils font avec un bâton un trou de huit à neuf centimètres dans la terre et ils y placent une bouture longue de trente centimètres qu'ils inclinent sous un angle de quarante-cinq degrés. Les boutures proviennent des tiges qu'ils coupent après avoir enlevé les racines. La plante est très vivace puisqu'une tige arrachée depuis un an et abandonnée sur le sol peut encore servir à la reproduction.
Tous les abatis se font sur des terres élevées, parce qu'une trop grande humidité ne manque jamais de faire pourrir les racines.
La plantation se fait vers le mois de décembre, au commencement de la saison des pluies; six mois après, les racines pourraient déjà servir à faire de la cassave, mais ce n'est généralement qu'au bout d'un an et demi qu'on commence l'exploitation. Elles peuvent encore grossir, mais la pulpe devient dure et prend une teinte rougeâtre, et la farine obtenue n'est plus que d'une qualité médiocre.
Les Indiens n'aiment pas à planter deux fois de suite du manioc dans le même terrain ; ils préfèrent abattre la forêt pour planter dans un terrain vierge.
Pourtant dans certains cas, lorsqu'ils manquent de haches, ils reviennent à une plantation qui était abandonnée depuis plusieurs années. Il suffit alors de couper la broussaille et d'y mettre le feu. Bien qu'on ait détruit toutes les plantes qui recouvraient le sol, on ne tarde pas à voir apparaître des tiges de manioc. Cette repoussée laisse des lacunes plus ou moins considérables que l'on comble en plantant quelques boutures.
Le manioc est la seule plante que les indigènes de la Guyane cultivent sur une grande échelle; c'est qu'elle suffit à presque tous leurs besoins, elle leur fournit le pain et l'alcool. Nous avons calculé avec Apatou qu'un travail d'une journée sur huit suffit largement pour l'alimentation d'une famille composée de deux ou trois femmes et cinq ou six enfants.
Nos heureux Roucouyennes ont le reste du temps à consacrer à la chasse, à la pêche, à la danse et à de longues siestes dans leurs hamacs. .
Vers midi nous arrivons à l'embouchure de la crique Couyary, habitée par des Indiens farouches (bravos) qui n'ont aucune relation avec leurs voisins.
Apatou ayant fléché deux gros coumarous demande à les faire bouillir pendant que je fais des observations.
Au moment où la fumée commence à s'élever, nous sommes assaillis par quelques guêpes qui piquent quelques-uns d'entre nous. Je reconnais les mouches dites sans raison de nos créoles de Cayenne; elles sont ainsi nommées à cause de leur trop grande susceptibilité. Elles piquent, dit-on, avant même qu'on songe à les attaquer.
Ici elles ont un motif d'agression : c'est que nous les incommodons en leur envoyant de la fumée. Apatou me dit que ces mouches sont toujours en compagnie d'une petite fourmi noire qui fait un grand nid allonge suspendu à une branche. Souvent elles s'associent un oiseau que les Bonis appellent tion-tion à cause de son cri et que nos créoles qualifient de cul jaune à cause de la couleur des plumes de la queue. Cet oiseau vit toujours en famille; nous n'avons vu qu'un nid de cassique isolé, et une fois nous en avons compté dix qui pendaient comme de grandes poires aux branches d'un seul arbre. Le tion-tion n'aime pas seulement la société des fourmis et des guêpes, il aime la société des hommes et très peu d'habitations de l'Amérique équatoriale qui n'aient un arbre couvert de nids de cassiques. S'il n'est pas près d'un village, au moins le trouve-t-on dans une île où les canots ont l'habitude de s'arrêter.
Ces oiseaux imitent la voix humaine et les cris de tous les animaux qu'ils fréquentent, avec la plus grande facilité. Ils prononcent plus distinctement que les perroquets. Ils disent le mot Apatou avec tant de netteté que mon patron croit qu'on l'appelle.
Nous les avons entendus imiter l'aboiement du chien, le chant du coq. Les Bonis voulant qualifier une femme bavarde, l'appellent tion-tion. L'épithète n'est pas juste, puisque chez ces oiseaux c'est la femme qui travaille et l'homme qui jacasse. La femme va chercher la pâture des enfants tandis que le mari garde la maison. Pourtant le soir le couple quitte le domicile conjugal pour aller dormir dans le voisinage, généralement au milieu des touffes de bambous. Ils confient la garde des nourrissons aux fourmis et à ces affreuses guêpes que je ne puis m'empêcher de maudire parce que ma main piquée gonfle et me fait mal.
Dans le Yapura comme en Guyane on trouve une autre espèce de cul jaune plus grosse, faisant des nids plus grands et sur des arbres plus élevés, que les Roucouyennes appellent coulimao.
Les plumes jaunes d'or qui parent son croupion sont très estimées des Indiens; elles leur servent faire de superbes bandeaux dans lesquels ils associent du rouge et du noir pour parer les chapeaux des jours de danse.
Apatou donne le conseil suivant aux personnes qui peuvent avoir affaire aux mouches sans raison. C'est de se jeter à terre et de faire le mort; en canot faut montrer le dos et cacher la tête entre les jambes sans remuer. On éprouve une douleur très vive si on fait un plongeon après la piqûre, et l'on recoit de nouvelles piqûres dés qu'on met le nez à la surface.
12 octobre. — J'ai passe une nuit effroyable. Je me reveille avec un mal affreux dans le dos. Que je serais heureux de m'arrêter ! mais il faut marcher, marcher toujours.
A neuf heures je grelotte et mes dents claquent; je suis pris d'un fort accès de fièvre et il faut que je reste assis sur mon petit banc pour ne pas effrayer les Indiens qui m'accompagnent.
Une heure après, le patron du deuxième canot se met à crier pour nous faire arrêter. Hopou est si malade qu'il est obligé de descendre à terre afin de se coucher. Apatou lui-même a la fièvre. Ainsi voila que sur quatre hommes qui constituent mon expédition trois sont obligés de se coucher en même temps. A peine nos hamacs sont-ils installés que les Calayouas qui nous accompagnent se mettent à prendre la fuite.
Yelemeu lui-même a bien envie de s'en aller. Je vois que ses enfants le supplient de partir; je n'ai qu'un moyen de le retenir, c'est de menacer de lui reprendre le fusil que j'avais apporté.
Vers une heure les trois malades, ayant pris chacun une dose d'ipéca, se trouvent un peu mieux, et chacun revient à son poste dans son canot. Le brave Hopou nous donne une preuve d'énergie en reprenant sa pagaye qu'il manoeuvre jusqu'à quatre heures du soir. Pour ma part je suis tellement fatigué que je ne puis me tenir sur mon banc. Je suis oblige de renoncer à la vérification de mon trace du Yari.
13 octobre. — Le lendemain Hopou est presque guéri, tandis que je reste malade. Cet état n'est pas sans me donner des inquiétudes. Plus je vais, plus je m'éloigne des ports de sortie.
Peut-être vais-je remonter le Yari jusqu'à ses sources, et, arrivé là-haut, je serai si faible, si profondément anémié que je ne pourrai atteindre le Parou ! Je serai oblige de revenir par le Yari qui est déjà connu.
Dans un moment de désespoir, je songe à abandonner bien vite cette marche ascendante pour me laisser aller au courant de l'eau qui me porterait rapidement vers l'Amazone.
Nous passons, dans la journée, devant la crique Courouapi, que nous avons remontée à deux jours de navigation à notre dernier voyage.
Yelemeu veut m'y entraîner, me disant que je serai fort bien reçu par ses peïtos.
Apatou insiste beaucoup pour que je fasse cette excursion sous prétexte qu'il trouvera d'excellent cachiri à boire, des chiens et des hamacs qu'il voudrait acheter pour les envoyer dans son pays. Mais déjà mes canots sont charges d'objets appartenant à mon patron; je lui défends absolument de ne plus rien acheter. Ce surcroît de bagages ralentit la marche des embarcations et provoque la dissension dans mon équipage.
Hopou et Stuart se plaignent amèrement de ce qu'Apatou, qui ne pagaye plus parce qu'il est malade, leur donne un surcroît de travail en leur faisant traîner ses bagages.
Nous campons sur une pointe exposée à un vent agréable venant du sud. Cette brise du soir semble calmer mon cerveau excite par la maladie. Je passe une nuit plus calme et le matin au réveil je suis tout surpris de me trouver en admiration devant cette nature que je maudissais la veille.
Tout en sommeillant je ne puis m'empêcher de regarder le soleil qui se lève derrière les grands arbres de la rive opposée. On ne voit encore que la moitié de son disque, mais déjà il projette une vive lumière qui en se décomposant sur les nuages donne les couleurs brillantes de l'arc-en-ciel. Cette lumière éclatante fait contraste avec la couleur sombre des grands arbres éclairés par derrière et projetant leurs grandes ombres noires dans les eaux calmes du Yari.
En faisant une promenade autour du camp, Yelemeu donne un coup de sabre dans un arbre, et nous voyons couler un suc blanc qui a tout l'aspect du lait. Mon compagnon en recueille dans une calebasse, et, y ajoutant de l'eau, il le boit avec avidité. Cet arbre n'est autre que le balata (mirnosops balata), qui forme une sorte de gutta-percha employée par tous les Indiens de l'Amérique équatoriale pour fixer les différentes parties d'une flèche. Cet arbre, qui certainement ne tardera pas à être exploits pour les besoins de la civilisation, n'existe pas seulement dans les affluents de l'Amazone, mais aussi dans l'Oyapock et le Maroni, où il est aussi commun que le Syringa dans le Yari. Sa graine est très savoureuse. Les Indiens la disputent aux singes qui en sont très friands, et son bois est employé à Surinam sous le nom de boteri pour faire des constructions.
Un peu plus loin on nous montre un arbre qui joue également un grand rôle dans l'existence de nos Indiens: c'est le mani (moronobea coccinea Aubl.) ; il est employé comme la poix des cordonniers pour consolider les fils des arcs et des flèches. Cette espèce de goudron (breo des Portugais) se recueille comme l’encens au pied des arbres.
Pour le séparer des impuretés qu'il renferme,les Indiens y mettent le feu après l'avoir placé dans une vieille marmite trouée au fond; le mani entrant en fusion s'égoutte dans un récipient place au-dessous qui renferme de l'eau.
L'homme ne mange pas la graine du mani, mais le cariacou (biche) en est très friand; c'est ce que nous avons pu constater en dépeçant un de ces gibiers.
14 octobre. — Nous marchons vite pour arriver de bonne heure à l'habitation du tamouchy Alicole, à l'embouchure de la crique Chimi-Chimi. Yelemeu me dit que ce chef que j'avais pris pour un Roucouyenne appartient à la tribu des Apourouis. C'est un des rares survivants d'une tribu qui habitait le bas Yari et que les anciens géographes indiquaient sous le nom de Piriou. J'apprends également que les Roucouyennes, que l'on appelle ainsi parce qu'ils se peignent avec le roucou, sont connus par les autres Indiens sous le nom de Ouayanas. Ce nom est très ancien puisque nous le trouvons mentionne par Thevet.
Ce voyageur rapporte qu'ayant eu l'occasion d'interroger un prisonnier qu'avaient fait les Indiens Tapouyas qui habitaient vers l'embouchure de l'Amazone,celui-ci lui parla de la province Ouayana comme d'un pays très riche, et lui dit que pour s'y rendre il fallait remonter la rivière de Kourou [5] .
 Pakira. — Dessin de R. Valette, d'après nature. |
Alicole qui vit depuis longtemps au milieu des Roucouyennes parle leur langue et a pris leurs habitudes. Tout ce qui pourrait le différencier de ces Indiens, c'est le mauvais accueil qu'il fait aux étrangers. Au premier voyage il n'a pas voulu nous donner de farine sous pretexte que son manioc n'était pas assez grand. Cette fois il nous fait perdre un jour pour nous fournir cinq galettes de cassave que j'ai payées d'avance au prix d'une hache. De plus je ne suis pas satisfait de lui parce qu'il n'a pas commande à ses femmes de faire du cachiri. Enfin j'ai une autre raison de mécontentement; c'est que m'étant levé pendant la nuit, j'ai trouve ce misérable, qui disait ne pas avoir de vivres, occupé à manger un pakira que ses femmes n'avaient mis sur le feu qu'au moment où nous étions partis nous toucher.
Le 15 au matin, n'ayant pas fermé l’oeil non seulement à cause des moustiques, mais à cause des hurlements de gros chiens que le tamouchy a fait lâcher pour nous intimider, je veux donner une lecon à ce chef inhospitalier. D'abord je refuse sa cassave et lui fais rendre la hache que je lui avais donnée en payement ; je le force ensuite à venir au milieu du village, où, en présence des rares peïtos qui lui sont restes fidèles, je lui enlève le bâton qu'il porte à la main.
Je remets ce signe du commandement ainsi que la hache à un jeune Roucouyenne qui m'avait rendu des services au dernier voyage. Je lui fais remettre aussi le bandeau fait d'écailles de caïman qui est l'emblème de la souveraineté.
Le nouveau tamouchy, voulant montrer sa fidélité au Parachichi, offre de m'accompagner jusqu'aux sources du Yari. II entraîne avec lui les hommes les plus vigoureux de la tribu et le vieux Chicaca qui au premier voyage nous a suivis jusqu'a la première chute du Yari. Ce vieil Indien, qui a passe quelques années de son enfance chez les blancs, change de tribu presque toutes les années. J'apprends qu'il s'est fixé chez Alicole parce que ce petit chef qui n'avait que très peu de peïtos lui a cédé sa plus vieille femme afin de l'attirer chez lui.
Pendant la route Apatou me fait le récit d'un petit drame qui s'est passé, il y a cinquante ans, chez les Apourouis.
Un Bonis nomme Coffi, aujourd'hui capitaine, va un jour chez les Apourouis avec son père le grandman Gongo[6] et un petit garçon nomme Alemé.
« Le soir, dit Apatou, Indiens qui danse Toule[7] boire beaucoup cachiri. Coffi dit à so papa : Toi, pouvé boire seulement petit morceau; gagné beaucoup Indiens qui pouvé faire bêtises avec nous..
« Petit moun allé coucher carbet où qui metté fusil grand man Gongo. Coffi qui pas dormi, entendé Indien qui veni doucement, doucement pour prendre fusil. Ly crié, Indien sauve. Petit capitaine dit à so camarade : Gader fusil, moi appeler papa.
Coffi dit à grand man : Indien veni pour voler fusil.
« Grand man Gongo dit : « Io ! io! pas vrai, Indiens la mo zamis, pas pouvez faire méchants.
Coffi qui couche dans so hamac entender Indien qui veni doucement, doucement. Lui couri dire à so papa : «indiens vouler prendre fusil, veni vite.
Au moment où Gongo s'abaisse pour saisir son arme, il reçoit une flèche qui lui traverse la joue.
Une lutte s'engage dans l'obscurité, mais enfin il se retire avec son fusil à pierre, laissant son sac de munitions entre les mains de l'ennemi.
Les Indiens, connaissant la manière d'appeler du chef nègre, se mettent parcourir les alentours du village en criant : Cofficon! (Coffi venez!) Alemécon! Le grand man apprend ainsi que les enfants n'ont pas été tués dans la bagarre, puisqu'il les entend héler par les Indiens.
Coffi et Alemé, blottis derrière un arbre, entendent également cet appel, mais ils ne répondent pas parce qu'ils s'aperçoivent du piége.
A la pointe du jour le petit capitaine distingue un sifflement léger qu'il reconnaît pour ne pas être celui d'un serpent.... Bientôt il entrevoit son père tout couvert de sang. Les trois nègres se mettent en route au plus vite pour traverser la chaîne de montagnes qui sépare leYari du Maroni. Les malheureux marchent trois jours sans d'autre nourriture que le coeur tendre du palmier ouapou (chou palmiste). Enfin ils arrivent près d'un village ouayana situé sur le sentier qui va du Yari au mont Lorquin.
Gongo s'étant introduit dans l'abatis pendant la nuit, dérobe quelques racines de manioc, mais n'a pas de feu pour les faire cuire. Ayant retire le plomb et la moitie de la charge de poudre, il sacrifie le reste pour enflammer une bourre de coton. Il retourne le lendemain à l'abatis, mais il est aperçu par un Indien qui, faisant semblant de ne pas le voir, se met à jouer un air de flûte. Ce signal fait accourir un grand nombre de Ouayanas et d'Apourouis qui sont à sa poursuite.
Gongo veut se sauver, mais il est trop tard; les Indiens le somment de se rendre.
Le grandman met en joue le tamouchy en disant qu'il le tuera s'il ne vent pas le laisser passer. Celui-ci se moque bien du chef nègre, croyant qu'il a brûle depuis longtemps son unique charge de poudre. Mais voila que le fusil part, et le tamouchy tombe à terre en criant : « Oke ! oke! » Gongo profite d'un mouvement de panique pour se sauver.
Après trois jours de marche, en suivant la crique Coulé-Coulé, il arrive à un village ouayana, où il est obligé de s'arrêter pour prendre des vivres et un canot.
Ayant cache les enfants dans les arcabas d'un gros cèdre, il entre résolument dans le village avec le fusil sur l'épaule. Arrive au carbet des hommes, une femme lui apporte un cololo (petit banc), un autre le touma (bouillon) où il trempe de la cassave. Lorsqu'il a fini de manger, le tamouchy Araouata vient s'asseoir à coté de lui pour causer.
« - Nepo amole pitani? » (Où sont vos enfants?)
Gongo répond : « A comine (Ils viennent derrière) ».
« - Nepo amoló peïto? » (Où sont vos soldats?)
« - Peïto oua eou (Je n'ai pas de soldats) », répond franchement le grand man en montrant son fusil.
Le tamouchy lui dit : « Eou mecro male totopockoua» (Je ne suis pas en guerre avec les nègres). « Eou(je) mecro (nègre) male (avec) totopock (guerre) oua (non) ».
A cette déclaration le grand man va chercher ses enfants et revient chez son hôte.
On lui donne des vivres, des hamacs et un canot, et trois jours après il rentre dans son pays, le village de Cotica.
Nous arrivons quelques heures après à l'habitation de Macuipi, avec qui j'ai fait connaissance à mon premier voyage.
Ayant appris sa mort, je m'empresse d'adresser des condoléances à sa veuve. Cette brave femme, nommee Souroui, se met à pleurer en chantant. Je distingue les paroles suivantes : Maria, eh, eh; sapa, eh,eh; ouioui, eh, eh; cachourou, eh, eh. (Maria, couteau; sapa, sabre; ouioui, hache ; cachourou, collier.)
Traduction libre « la pauvre vieille déplore la mort de son mari parce qu'elle ne pourra plus se procurer les objets indispensables à son ménage et à sa toilette. »
Yelemeu, qui m'a déclaré il y a quelques instants qu'il était très content d'être débarrassé de son voisin, pleure et chante en faisant chorus avec la veuve.
J'apprends que Macuipi, en sa qualité de piay, c'est-à-dire de médecin, n'a pas été brûlé comme le reste des mortels.
Conduit sur les lieux de la sépulture, je vois une petite hutte au milieu de laquelle se trouve un large trou ayant deux mètres de profondeur; au fond j'aperçois mon- ancien hôte couché dans un hamac où il semble dormir.
Le corps desséché, dur comme un parchemin, est complètement peint en rouge. La tête est parée de plumes aux couleurs les plus éclatantes, le front est ceint d'une couronne faite avec des écailles de caïman; c'est l'emblème de la souveraineté.
Au cou il porte une petite flûte en os et plusieurs sachets qui renferment des couleurs ; c'est le signe que Macuipi avait un talent particulier pour la peinture.
Je vois près de lui un grand vase, mais il est vide; les Roucouyennes ne donnent pas à manger à leurs morts. D'ailleurs le cadavre a sous la main un arc, des flèches et une massue qui pourront lui servir au besoin pour se défendre contre ses ennemis et pourvoir à sa nourriture.
Après cette visite nous allons nous reposer quelques
instants dans une butte ronde où sont accrochés un grand nombre
de hamacs , le nouveau tamouchy, fils aîné du défunt, nous apporte une calebasse
pleine d'excellent cachiri.
Je bois avec plaisir cette liqueur acide légèrement alcoolique qui m'avait d'abord
répugné.
Chacun vide trois ou quatre calebasses qui lui sont servies par le tamouchy.
En pays roucouyenne, aussi bien que chez les Oyampys, c'est le chef qui pressente
aux étrangers la coupe de l'amitié.
Ensuite le jeune tamouchy s'écrie : Oli toumaenepke (femmes, apportez le bouillon).
Le mot touma désigne généralement le suc exprimé du manioc bouilli avec du piment; mais je remarque au fond de la marmite une tête de pakira boucanée qui constitue un bon plat de résistance.
Les tendresses de Yelemeu à la vieille femme de Macuipi me paraissent singulières. Toutefois je ne tarde pas à saisir la clef de l'intrigue c'est que la vilaine Souroui a deux jolies filles qui deviendront les femmes de celui qui contractera une alliance avec la mère. Ces deux fillettes, capables d'exciter la jalousie du voyageur, qualifieront Yelemeu non point de papa, mais d'okiri, c'est-à-dire d'homme ou d'époux légitime.
En échange de ces avantages Yelemeu abandonnera son titre de tamouchy pour venir se joindre à la tribu de ses femmes. Le jeune fils de Macuipi, qui n'est pourtant qu'un enfant, aura le droit de commander le mari de sa mère comme un sujet. Il cessera de l'appeler tamouchy pour le qualifier de peïto.
Chez les Ouayanas , c'est l'homme qui suit la femme. Une condition sine qua non du mariage c'est que le jeune homme viendra s'établir dans la tribu de sa future.
En nous promenant dans le village nous remarquons une jeune femme qui a perdu la jambe à la suite d'une piqûre au talon que lui a faite un serpent à sonnettes. De même, que dans beaucoup d'autres piqûres par des animaux venimeux, elle a été prise d'une inflammation des vaisseaux lymphatiques suivie d'un phlegmon diffus, et bientôt de gangrène.
Les crotales circulent plus dans la saison des pluies que pendant la sécheresse. Je n'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer un seul. II faut que je m'adresse à mon compagnon Apatou pour avoir des renseignements sur la manière d'attaquer de cet animal.
Le serpent est enroulé; vous passez près de lui, il agite sa sonnette, et gare à vous ! puisqu'il peut vous atteindre à une distance de six mètres. Comme tous les serpents, au moment où il a l'air le plus apathique, il bondit et décoche son dard avec la vitesse de l'éclair.
C'est au commencement de la saison des pluies qu'on rencontre le plus de serpents; il faut dire qu'ils sont beaucoup plus communs autour des habitations que dans la forêt vierge.
J'arrive le lendemain chez une autre connaissance, le chef Namaoli. Il n'est pas au débarcadère, mais je trouve à sa place le piay Panakiki.
Celui-ci m'informe que le tamouchy ne peut pas sortir parce qu'il vient d'avoir un enfant.
Si tu pénètre dans sa hutte, me dit-il, tes chiens mourront bien vite.
Cela m'est égal puisque je n'ai pas de chiens.
Je trouve Namaoli couché dans son hamac, tandis que sa femme circule dans l'intérieur de la maison. Il a un air si sérieux que je pourrais le croire malade, mais il n'en est rien. Après l'accouchement, chez les Roucouyennes, c'est l'homme qui se couche tandis que la femme se promène.
Mon confrère Panakiki répète devant moi la prescription qu'il a déjà faite à son client. Il restera couché pendant une lune et ne mangera aucun poisson, aucun gibier tué avec la flèche. Il se contentera de cassave et de petits poissons pris avec une plante enivrante appellée nicou. S'il enfreint cette ordonnance, son enfant succombera ou bien deviendra vicieux.
Aussitôt après l'accouchement la femme prend un bain de vapeur de la manière suivante:
Elle s'étend dans un hamac au-dessous duquel on place un gros caillou rougi arrosé avec de l'eau.
La malade n'est pas astreinte à une nourriture spéciale. L'enfant, outre le lait maternel, boit de temps à autre un breuvage compose avec des bananes bien mûres et cuites, exprimé avec la main dans de l'eau chaude.
La section du cordon ombilical est pratiquée avec une sorte de coupe-papier fait avec du bambou.
Nous mettons huit jours pour atteindre la tribu de Yacouman où j'ai failli mourir au premier voyage.
A notre arrivée, nous voyons le chef se promener dans le village en faisant des aspersions. Il tient à la main un pinceau en plumes qu'il trempe dans une calebasse remplie d'un liquide blanc laiteux.
C'est le suc d'un tubercule appelé samboutou (choux caraïbe) râpé dans l'eau.
Yacouman, en faisant ses asperges qui paraissent avoir pour but de chasser le diable, a l'air solennel d'un prêtre bénissant la campagne le jour des Rogations.
Docteur J. CREVAUX.
(La suite à la prochaine livraison.)
DE CAYENNE AUX ANDES,
PAR M. JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE FRANCAISE.
1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INDDITS.
PREMIERE PARTIE. — EXPLORATION DE L'OYAPOCK ET DU PAROU.
XIV
Le marake. — Préparatifs de la fête. — Un chapeau monumental. — Ceinture en poil de couata. — Grelots. — Panache dans le dos. — Battant du tambour avec les pieds. — Le supplice des fourmis et des guêpes. — Un médecin qui se fait prier. — Les trois diables qui gardent les sources du Yari
Les Roucouyennes n'ayant plus de secrets pour nous ne
craignent pas de célébrer à leur aise une cérémonie appelée marake.
II s'agit d'un supplice impose à des enfants à l'age de huit à douze ans
et à des adultes qui sont candidats au mariage.
Un grand nombre d'étrangers ont été invités à cette cérémonie,
parmi lesquels je trouve mon confrère le vieux piay Panakiki.
On passe l'après-midi à ranger les costumes de danse et particulièrement des
chapeaux couverts de plumes qui sont d'un effet ravissant.
|
|
Les chapeaux des Roucouyennes sont de véritables monuments
qui n'atteignent pas moins d'un mètre cinquante centimètres. La carcasse du
chapeau, largement ouverte au sommet, n'a rien de commun avec aucune espèce
de coiffure connue. Elle est surmontée d'un arceau dirige d'avant en arrière
qui supporte une infinité de panaches rouges et bleus ornementes d'élytres de
grands scarabées aux reflets métalliques. La trame disparaît sous vingt bandeaux
ou couronnes imbriquées les unes au-dessus des autres, avec des couleurs rouge,
jaune,noir, vert, blanc et bleu.
A l'arrière tombe une espèce de plastron recouvert d'une mosaïque de plumes
qui représente un homme aux jambes et aux bras écartés comme les grenouilles.
I1 faut plus d'une année de travail pour confectionner
cette parure de danse. J'ai déjà dit que le port des plumes est l'apanage des
hommes ; je dois ajouter que ce sont eux seuls qui font ces ouvrages qui feraient
envie aux femmes élégantes du monde civilise.
Le tamouchy porte sur l'avant du chapeau un bandeau tressé en feuilles de palmier,
sur lequel sont appliquées des écailles de caïman ou de petits rectangles taillés
dans le bec du toucan. Ces écailles blanches et noires sont arrangées de manière
à représenter des arabesques.
|
|
Tous ces précieux ornements que nous avons rapportés à Paris et fait dessiner d'après nature sont renfermes dans de longs pagaras en feuilles de palmier, d'où les danseurs les sortent au fur et à mesure avec la plus grande délicatesse. Ils ont eu bien soin d'enlever préalablement la peinture de roucou dont ils étaient recouverts, de pour détacher leurs belles plumes.
Le chapeau n'est pas le seul vêtement de danse; les Roucouyennes
se recouvrent l'abdomen d'un grand nombre de ceintures qu'ils fixent avec un
cordon sur la ligne médiane.
Elles sont de deux sortes: les unes noires, en poil de couata; les autres blanches,
en coton. Elles sont disposées les unes à coté des autres de manière à brider
le ventre jusqu'à la base de la poitrine.
Quelques danseurs portent à la jambe droite une jarretière à laquelle sont suspendus des grelots qui font un bruit de castagnettes. Ce sont des graines ayant la forme d'un chapeau à deux cornes qui sont attachées parleur sommet à des ficelles pendant à la partie antérieure de la jarretière.
Elles sont produites par un arbre appelé couaI (thevetia neriifolia) qui est cultivé par tous les Indiens de l'Amérique équinoxiale. Quelques-uns portent dans le dos un ornement des plus grotesques ; c'est un poisson en bois avec des trous dans lesquels sont implantés de glands panachés en plumes qui retombent en imitant la queue d'un oiseau.
|
|
Les curieux s'assemblent pour examiner les chapeaux qui
sont placés sur de petites croix enfoncées en terre. Ceux qui s'approchent trop
près sont empoignés par les danseurs, qui leur serrent le mollet par deux ligatures
et y appliquent deux coups de verge.
La danse commence au toucher du soleil. Les hommes et les femmes font des évolutions.
à la lueur de grands feux en s'accompagnant de chants qui célèbrent leurs amours
et leurs exploits guerriers.
Les jeunes gens placés en rond autour d'un trou recouvert d’une grande écorce tapent tous en cadence avec la jambe droite sur cette espèce de caisse qu'ils raidissent avec le pied gauche, et à chaque mouvement ils tirent un son bref d'une trompette en bambou.
Au lever du soleil les danseurs quittent leurs costumes, et aussitôt commence le supplice du marake.
Le piay Panakiki fait saisir un des candidats au mariage par trois hommes; l'un tient les jambes, l'autre les bras, tandis que le troisième lui renverse fortement la tête en arrière. I1 lui applique alors sur la poitrine les dards d'une centaine de fourmis qui sont prises dans des treillis par le milieu du corps. Ces instruments de supplice ont des formes bizarres,ils représentent un quadrupède ou un oiseau fantastique.
Une même application est faite sur le front avec des
guêpes; tout le corps est ensuite piqué alternativement avec des fourmis et
des guêpes.
Le patient tombe infailliblement en syncope, Il faut qu'on le porte dans son
hamac comme un cadavre; on l'y amarre solidement avec des tresses qui pendent
de chaque coté et on fait un petit feu par-dessous.
Le supplice continue sans interruption.
Les malheureux patients sont apportes au fur et à mesure
dans un carbet. La douleur fait faire à chacun des mouvements désordonnés, et
les hamacs se balançant dans tous les sens déterminant des vibrations qui font
remuer la hutte au point de croire qu'elle va s'écrouler.Les jeune gens qui
ont reçu le marake doivent rester dans le hamac pendant quinze jours
et ne manger qu'un peu de cassave sèche et des petits poissons rôtis sur la
braise.
Quelque temps après cette cérémonie, mon collègue Panakiki reçoit la visite
de deux Indiens qui viennent d'un village situé en haut de la grande chute Macayele,
aux sources du Yari.
L'un d'eux, qui parait désolé, s'approche respectueusement
du vieux piay et lui offre une cigarette.
Après un moment d'hésitation, le piay accepte, et l'étranger parait très content.
Que signifie cette pantomime?
C'est un individu qui vient appeler le médecin en consultation.
Le piay ayant accepté la cigarette a pris l'engagement d'aller visiter le malade.
On lui promet en payement un joli petit peigne fait avec des épines d'aouara,
un petit hamac d'enfant et un manaró ou tamis pour passer la farine de
manioc. Mais il est bien entendu qu'il ne recevra ces honoraires que lorsque
le malade sera complètement guéri.
Je demande des renseignements aux nouveaux arrivés sur l'itinéraire qu'ils ont suivi; ils me disent qu'ils sont venus par terre, parce que le saut Macayele est gardé par trois diables : Caïcoui (tigre) yolock, Aimara yolock et Ticroké (blanc) yolock. Ce dernier, le diable blanc, est remarquable par une chevelure blanche qui lui tombe jusqu'à la ceinture en voilant complètement sa figure. Ces trois rois des eaux font chavirer les canots et dévorent les audacieux qui osent violer leur sanctuaire.
XV
Une lettre avant la bataille. — Au voleur! — Pas de guides ni de porteurs. — Adieu Vat! — Les Indiens se laissent entraîner. —Marche accélérée. — Soif insatiable. — Ligne de partage des eaux entre le Yari et le Parou. — Nous entrons dans une région nouvelle. — Etrange usage des chasseurs roucouyennes. — Dolmen élevés au diable. — Manière d’indiquer l'absence. — Grossiers personnages qualifiés de maipouri. — J'engage une lutte contre la maladie. —Battu. — Je reviens à la charge. —Vainqueur.
Je ne tarde pas à être pris de nouveaux accès de fièvre
qui détériorent profondément ma constitution.
Les Indiens me trouvent une physionomie si piteuse qu'ils refusent de m'accompagner
dans le Parou.
Yacouman ne veut pas me conduire male au prix d'un fusil.
Il objecte que je mourrai sûrement pendant la traversée
qui est très difficile.
« Nissa oua, ippoui tole (Aller pas, montagne beaucoup.) »
« Nissa, omaita natati (Aller, dis-je, en chemin mort) » C'est alors
que j'écris la lettre suivante « Les voyages d'exploration sont des guerres
livrées à la nature pour lui arracher ses secrets.
« Or, je suis à la veille d'une bataille décisive. »
« Battu, je serai forcé de revenir par le Yari que j'ai déjà parcouru; vainqueur,
j'effectuerai mon retour par une rivière nouvelle, le Parou, qui est un bel
affluent de gauche de l'Amazone. »
Mais la lutte se présente mal, les Indiens mes allies m'abandonnent précisément parce que je suis faible. Mon patron Apatou est malade; je n'ai que deux noirs vigoureux, mais incapables. Quant à moi, depuis dix jours je ne suis pas un seul instant dans un état normal: le matin je suis sous l'influence d'une excitation qui double mes forces physiques et ma volonté ; le reste du temps je frissonne, j'ai une soif intense ou je transpire. »
25 octobre. — Au reveil je m'apercois de la disparition d'une hache. Quel peut être l'auteur de ce larcin ? Sachant que les Indiens qui n'ont jamais eu de relations avec les blancs n'ont jamais touché à mes bagages, je n’hésite pas à accuser le vieux Chicaca qui a passé quelques années dans la basse Guyane. Je le fais saisir par deux de mes hommes et je le menace de le fusiller séance tenante s'il n'avoue pas sa faute. Cinq minutes après la hache est retrouvée et je presse les préparatifs du départ.
A huit heures du matin je m'engage dans le bois avec
mes trois hommes d'équipage. N'ayant pas de guide, je me dirige avec la boussole
et fais route vers l'ouest. La question capitale est de ne pas tomber malade
en chemin, car nous ne portons de vivres que pour quatre jours.
Mes hôtes me regardent partir en riant : c'est qu'ils sont persuadés que je
retournerai sur mes pas avant la fin de la journée.
A dix heures quarante-cinq, mes nègres trop charges demandent
à faire une halte près d'une petite crique nommée Yapotori.
Au moment de nous remettre en route Apatou signale des Indiens derrière
nous ;... c'est Yacouman lui-même avec deux de ses fils et quatre hommes qui
viennent se mettre à ma disposition.
Ils portent des catouris chargés de vivres ; nous sommes sauves ! L'arrivée
de guides et de porteurs stimule mon ardeur. Je marche d'un pas léger derrière
un jeune Indien qui rivalise de vitesse avec ses compagnons.
C'est un garçon de quinze ans, nomme Quanica,destine à remplacer son père, le
tamouchy Yacouman.
Je veux m'éloigner au plus vite du Yari, car je me sens sous le coup d'un prochain
accès de fièvre. J'éprouve une soif si vive que je ne puis m'empêcher de boire
aux nombreux ruisseaux que nous traversons.
Nous franchissons plusieurs montagnes sur lesquelles le baromètre indique sept cent vingt-sept millimètres, et à midi et demi, après trois heures et demie de marche effective, nous arrivons à un petit cours d'eau dirige vers l'ouest, affluent du Parou.
|
|
|
|
Mon coeur palpite en atteignant cette région nouvelle,
non seulement pour moi, mais pour tout le monde civilisé, puisque je suis certain
que cette rivière est vierge de toute exploration.
A midi et demi je remarque un fait singulier.
Je vois dix boucans disposés sur une ligne le long du sentier. Ce qui m'intrigue
c'est qu'on n'ait pas fait de feu dessous.
D'autre part, au lieu d'être charges de viande fumée, ils sont recouverts de
plusieurs couches de bois sec alternant avec des pierres. J'apprends que ces
autels,qui ne manquent pas d'analogie avec les tables de pierre élevées par
les druides, ont été faits par dix chasseurs d'un village voisin qui sont partis
Il y a quelques jours pour une grande chasse.
Chaque fois que les Roucouyennes vont flécher le couata, ils s'arrêtent à une
heure de marche de leurvillage pour dresser ces boucans. Leur but est de calmer
Yolock (le diable), qui peut les empêcher de tuer du gibier.
A une heure et demie nous atteignons un pati (village) compose de deux grands carbets qui ne sont occupés que par des femmes. Nous apprenons que les hommes sont allés danser chez d'autres Ouayanas du Yari. Demandant depuis combien de temps ils sont partis, une femme me montre huit raies blanches sur un poteau qui indiquent autant de jours. Cette manière d'indiquer l'absence des voyageurs est usitée par la plupart des indigènes de la Guyane.
En faisant une promenade dans le jardin j'aperçois un
gros ananas qui parait en pleine maturité.
Apatou l'ayant échangé contre deux aiguilles, j'en savoure le jus avec d'autant
plus de plaisir que je suis toujours atteint d'une soif insatiable.
M'étant couche sans souper, je ne puis m'endormir à cause d'une querelle entre
les hommes de mon équipage.
Cela m'agace d'autant plus que je crains la défection de mes guides qui sont effrayés par les gestes et les vociférations de ces noirs citadins dont la grossièreté fait rougir les sauvages.
Une jeune femme provoquée par l'un d'eux l'a qualifié de maypouri. Cette expression, qui littéralement signifie tapir, à dans la langue indienne un sens que nous ne pouvons exprimer. Elle est plus forte que le qualificatif de gros boeuf appliqué par une délicate jeune fille à un amoureux inconvenant.
Je n'ai pas dormi et je me trouve si fatigué que je puis à peine remuer, mais pourtant il faut sauter de son hamac et se mettre en route.
Ne pouvant pas manger, je bois un verre d'eau tandis que mes hommes déjeunent. Bientôt après j'éprouve des nausées et des frissons - qui sont les préludes d'un violent accès de fièvre.
A sept heures, mes hommes ont chargé leurs catouris; je me mets en marche d'un pas décidé, mais un quart d'heure après je sens mes jambes fléchir, et bientôt, trebuchant contre une racine, je tombe à terre sans avoir la force de me relever.
J'éprouve un froid glacial, et mon tube digestif dont les sphincters sont paralysés expulse l'eau par les deux extrémités comme un vrai tube de caoutchouc.
On me couche dans mon hamac et au bout d'une heure une chaleur ardente fait place au frisson. Alors un Indien va chercher de l'eau dans une spathe de palmier et l'on me fait des ablutions générales et des frictions avec du sable fin. Ce traitement énergique provoque la transpiration, et bientôt, me trouvant soulagé, je saute à terre et poursuis mon chemin.
XVI
Monarques cantonniers. — Manière de se chauffer pour éviter une surprise. — Osiers de la Guyane. — Etymologie de la crique Apaouani. — Les deux femmes du tamouchy ; Il faut rechercher les bonnes grâces de la vieille. — Chasse à l’aï — Il est ennuyeux d'être médecin pour voyager en Guyane. — Tuer et baptiser. — Apatou missionnaire évangélique.
Partis à midi, nous traversons à trois heures une montagne
appelée Yaouarapata,ce qui signifie village des tigres.
A trois heures nous rencontrons un Indien qui fait un sentier; c'est le tamouchy
d'un petit village voisin, qui nous fait bon accueil grâce à la recommandation
de notre guide.
Je croyais que les tamouchys ne se livraient à aucun exercice corporel; mais s'ils
ne travaillent pas à l'abatis et ne chassent que rarement, au moins sont-ils chargés
d'élaguer la piste qui va d'un village à un autre.
Ce rôle d'agent voyer est généralement une sinécure, car c'est la première fois
que je vois un sentier où l'on s'est donne la peine de couper les branches qui
entravaient la circulation.
27 octobre. — Ne m'étant levé qu'à six heures et demie,
je trouve mes Indiens réunis autour d'un grand feu. Accroupis comme des singes
autour du foyer, ils lui présentent tantôt le dos, tantôt le flanc, mais jamais
la face. Leur demandant la raison de cette manière étrange de se chauffer, Ils
disent qu'ils ont ainsi l'avantage de ne jamais se laisser surprendre par l'ennemi.
Yacouman s'occupe, en attendant le repas, à garnir la poignée d'un sabre d'abatis
avec une espèce d'osier très souple et très joli.
Il se sert des racines adventives d'une plante grimpante que les Galibis appellent
bamba, et qu'on cultive dans les serres du Jardin des Plantes de Paris
sous le nom de philodendron speciosum.
On trouve en Guyane un grand nombre d'espèces végétales que l'on pourrait
exploiter pour faire des objets de vannerie. Les pagaras que j'ai recueillis
dans les différentes tribus sont bien supérieurs comme élégance et surtout comme
solidité aux paniers fabriqués avec l'osier.
Partis à sept heures quarante-trois minutes, nous trouvons
à huit heures quarante-quatre minutes une petite crique appelée Coucitenné,
que nous pourrions descendre jusqu'au Parou si nous avions un canot notre
disposition.
Apatou tue un magnifique hocco qui était perché sur un arbre; Les Roucouyennes
appellent set oiseau o-oc, tandis que les indigènes de la Guyane anglaise
l'appellent powi et les Bonis pouishi. La rivière Apaouani,
que ces Indiens appellent également Powini, n'a pas d'autre étymologie
que le cri du hocco qui répond powi, powi, lorsque le chasseur
le hèle en produisant un bruit sourd avec le nez, la bouche tant fermée.
Vers onze heures, nous nous arrêtons quelques minutes pour chasser un alicolé (aï).
Ouanica, craignant de recevoir des excréments sur la tête, monte sur un arbre voisin. Il tient à la main une gaule à laquelle il a fixe une corde formant une anse. Passant la corde dans le cou de l'animal, Il fait quelques détours pour lui comprimer la gorge, et, lorsque l'animal est à demi asphyxié, Il lui suffit d'une légère traction pour l'entraîner. Le malheureux qui est assomme par la chute, est achevé à coups de bâton.
A douze heures quarante-cinq minutes, après quatre heures
de marche effective, nous atteignons un village qui compte une population de
quinze habitants. Suivant l'usage, le tamouchy, qui s'appelle Poumari, a deux
femmes, une vieille et une jeune. Apatou me conseille de ne jamais m'adresser
qu'à l'aînée des femmes.
C'est avec elle que le voyageur doit traiter pour obtenir de la cassave et du
cachiri, car c'est elle qui jouit de la plus grande autorité près de son mari.
Ce vieux chef regarde d'un oeil inquiet et peu bienveillant l'étranger qui offre
des aiguilles et des cashourous (colliers en verroterie) à la plus jeune
de ses épouses.
Comme j'ai eu l'occasion d'exercer la médecine sur une
jeune fille malade, mes compagnons qui ne connaissaient pas ma profession cessent
de m'appeler major pour me qualifier de piay.
Cette révélation est une cause d'ennui, parce que ces braves Indiens, naguère
si discrets, viennent m'accabler de demandes importunes. Poumari me dit :«
Piay [8] ice, amou Galina soueï ice eou. » (J'ai besoin d'un
piay, c'est-à-dire d'un remède pour tuer un autre Indien.) D'autre part, Yacouman
demande à ce que je lui mette de l'eau salée sur la tête sous prétexte d'acquérir
plus de prestige chez les Ouayanas du haut Yari. Au lieu d'être un simple tamouchy
qui commande à un village Il pourrait devenir yapotari, c' est à dire
chef de toute la contrée.
Apatou lui dit que ce n'est pas possible puisque nous n'avons plus de sel; mais
au retour de son voyage dans mon pays il rapportera de petites bouteilles avec
lesquelles il le baptisera, lui et tous les gens de sa tribu. Yacouman se montre
très égoïste en cette circonstance; Il recommande au fervent Apatou de n'apporter
que deux bouteilles, une pour lui et l'autre pour son héritier. Le prestige
disparaîtrait si tous ses peïtos avaient l'avantage d'être ses frères
en Jésus-Christ.
XVII
Nous atteignons la rivière de nos rêves. — Pam ! — Un bain dans une eau vierge. —Récapitulation d'une course au clocher. —Danse du pono. — Caneapo. — Indiens déguisés en juges faisant claquer le fouet.— Roches mamelonnées formant un barrage. —Bon accueil. — Histoire d'un couteau. — Il est avantageux d'accomplir ses engagements. — Toujours la discorde dans nos rangs. — Combat des hercules noirs. — Désobéissance. — Je sauve la vie d'un colibri. — Site pittoresque. — Le berceau et les aiguilles des Roucouyennes. — Petit commerce des indigènes. —On paye d'avance.
28 octobre. — J'apprends avec plaisir que nous ne sommes pas éloignés du Parou; c'est pour cela que mon guide me fait précéder de son fils et d'un peïto de Poumari qui partent avant le jour. Ne devant pas rencontrer d'embarcation au dégrad, ces jeunes gens traverseront la rivière à la nage pour prévenir le chef Canea de notre arrivée.
Partis à sept heures dix-huit minutes, nous atteignons la rive gauche du Parou à dix heures. Envoyant cette belle rivière, inconnue jusqu'ici depuis sa source jusqu'à son embouchure, j'éprouve une vive satisfaction et je fais décharger mes deux fusils en signe d'allégresse.
Aussitôt après je fais un plongeon dans les eaux limpides du Parou. Pourrais-je trouver au monde un plaisir plus grand que de prendre un bain dans cette eau que j'appellerai virginale, puisqu'elle n'a pas encore eu de contact avec les souillures de la civilisation ? Je suis si heureux d'atteindre le but de mon voyage que je ne fais pas cas d'un léger accès de fièvre qui m'a pris au réveil.
Au lieu de me reposer, je parcours mes cahiers de notes en cherchant à récapituler mon voyage.
Je calcule que nous avons employé quatorze heures et demie pour passer du Yari au Parou. Nous avons parcouru une distance d'environ quarante-trois kilomètres en ligne droite, mais ayant fait quelques détours pour gagner des villages, je ne dois pas estimer à plus de trente kilomètres la distance directe qui sépare les deux rivières.
Un fait à remarquer c'est que la chaîne de partage des eaux est plus rapprochée du Yari que du Parou; nous n' avons mis que trois heures et demie pour atteindre les sources du premier affluent qui se jette dans cette dernière rivière. D'autre part, le bassin du Parou est plus élevé que celui du Yari, puisque dans le Yari le baromètre indiquait en moyenne sept cent quarante millimètres, tandis qu'il marque sept cent trente sur le Parou.
Au total, voila soixante-quatre jours que nous avons quitte Saint-Georges, et sur ce nombre nous comptons cinquante-cinq jours de marche soit à pied soit en pirogue.
Deux pirogues envoyées par Canea viennent nous chercher, et après une demi-heure de navigation en descendant la rivière nous apercevons un petit village sur une colline qui a vingt mètres d'altitude. Au pied se trouvent de gros blocs granitiques aux formes arrondies qui barrent presque complètement le cours d'eau. C'est un endroit fort pittoresque où les Indiens flèchent des coumarous à leur passage dans les petits défiles qui séparent les roches.
C'est un jour de fête, Il s'agit de célébrer la mort d'un tamouchy qui a succombé il y a un mois [9].
Tous les hommes sont recouverts de longues lanières noires
en taouari qui partent du cou et d'une espèce de toque semblable à celle de
nos magistrats.
Un seul homme est debout, tenant à la main un fouet dont la corde à huit mètres
de long ; Il tourne sur lui-même en frappant la terre avec le pied droit, puis,
soulevant son fouet, Il penche le corps en arrière, et, d'un mouvement brusque,
projette la corde qui claque comme un coup de pistolet. A chacun son tour de
produire ces détonations. Cette danse s'appelle la danse du pono.
Les autres Indiens, assis sur leurs talons, applaudissent en criant He
!... he !...
Les Indiens du Parou; qui connaissaient tous les détails de mon premier voyage dans le Yari, ne manifestant aucune frayeur à mon arrivée. Je suis le bienvenu parce qu'ils savent que j'apporte des couteaux(maria), des haches (onioui), des sabres (saga), des hamecons , , . En fait d:instruments en fer ils n'ont qu'un seul couteau de boucher sans gaine que le tamouchy a passé dans sa ceinture de poil de couata. On lit sur la lame : Acier fondu, Paris. C'est un objet qui provient de la pacotille (que j'ai transportée dans le Yari à mon voyage de 1877: J'apprends que le tamouchy a obtenu ce couteau en échange d'un chien et d'un hamac qui avait demande plusieurs mois de travail.
Ces Indiens sont disposés à m'accompagner partout parce
qu'ils savent que je n'ai jamais manqué à mes engagements avec leurs compagnons
du Maroni et du Yari.
Ces braves gens sont si complaisants qu'ils viennent au-devant de mes besoins.
Un enfant me dit: Donne-moi un hameçon et j'irai te chercher beaucoup de petits
poissons. Une femme me promet autant de cassave que j'en voudrai si je lui donne
des perles bleues.
Un chef étranger nommé Alamoïke, qui se trouve là, par
hasard, ayant appris que je désirais connaître la fabrication du curare, veut
me l'enseigner au prix d'une hache et d'un couteau.
Tout irait à merveille sans une nouvelle querelle qui vient de s'élever entre
Apatou et Stuart et qui dégénère bientôt en une prise de corps. C'est un spectacle
effrayant que de voir ces deux athlètes couleur de bronze, aux corps sveltes,
aux muscles puissants, s'enlacer dans leurs bras, se dresser sur les pieds,
se courber en avant, en arrière, puis s'arrêter court.
La situation devient critique.... tandis que l'un comprime le bas-ventre de
son adversaire, l'autre lui presse la gorge avec tant de force que ses yeux
deviennent subitement rouges de feu. Il faut que j'intervienne le couteau à
la main pour terminer ce duel qui jette la terreur dans le camp des Ouayanas.
Ces troubles ne m'empêchent pas de faire mes observations quotidiennes. La hauteur du soleil à midi et à quatre heures me permet d'établir la position du lieu. Cancapo, c'est ainsi qu'on appelle le village en question, est par 0° 58' latitude nord et 57°6' longitude ouest de Paris.
Voulant explorer le Parou dans tout son parcours, j'engage
Yacouman à me conduire jusque chez les Indiens Trios qui sont établis vers les
sources.
D'autre part, Alamoïke, qui devait descendre plus bas, consent à retourner sur
ses pas pour me montrer la fabrication du curare, que les Ouayanas et les Trios
appellent urari (ourari).
Pour allé plus vite je veux laisser la moitie de mes bagages aux soins de Canea;
mais Hopou et Stuart, à qui j'ordonne de n'emporter absolument que les objets
et les vêtements les plus indispensables, se mettent à murmurer et à menacer
de ne pas partir. Je les calme en faisant l'inventaire de leurs sacs et leur
remettant deux fois la valeur de chaque objet.
30 octobre. —7 heures du matin. Je suis bien aise de me mettre en route, car je préfère les fatigues du canotage au séjour dans une habitation. Il faut marcher, marcher toujours pour empêcher ces misérables de s'entre-tuer. Le désœuvrement est non seulement la perte des armées, mais surtout des petits équipages qui servent aux voyages d'exploration.
Au moment de mettre le pied dans mon canot j'aperçois un oiseau-mouche qui vient tomber à mes pieds. L'ayant pris à la main, je vois qu'il est attaqué par deux fourmis manioc qui l'ont déjà dépouillé d'une partie de ses plumes. Je le débarrasse de ces cruels ennemis et lui donne la liberté.
Cette partie de la rivière est entrecoupée à chaque instant
par des roches granitiques; ce ne sont que la carcasse de petites collines qui
forment les rives.
La végétation de ces terres élevées, avec ses arbres robustes sans palmiers
aux feuilles déliées, sans lianes aux contorsions élégantes, ne manque pas de
charmer la vue.
A dix heures et demie nous apercevons un dégrade sur
la rive droite. C'est la tête d'un sentier de traverse qui conduit à l’habitation
d'Eoupara. On peut atteindre le village en dix minutes de marche, tandis
qu'il faut une lieue de canotage à, cause d'une courbe que fait la rivière.
Je voudrais bien Masser mes jambes en marchant un peu, mais je suis retenu dans
mon canot par l'obligation de faire un trace à la boussole.
Eoupara est bâti sur une petite colline en face d'un rapide appelé Kourokiri.
C'est un site avantageux; on voit de loin les canots qui montent, on jouit
du murmure des eaux, on prend des bains délicieux, et on flèche les bandes de
coumarous qui sillonnent les eaux courantes.
La femme aînée du tamouchy brûle d'envie de posséder
une petite bague d'argent semblable à celle qu'Apatou porte au doigt en guise
de réclame. Elle veut me payer avec de la cassave, mais nous en avons tant et
plus; après réflexion elle offre de me faire un joli petit hamac semblable à
celui qu'elle porte sur l'épaule gauche pour suspendre un gros bébé tout nu
qui se cache la tête derrière le dos de sa maman.
La jeune femme, qui était occupée à modeler un tapir avec de la cire noire,
veut avoir à tout prix les boutons de mon paletot; je lui en donne deux, à la
condition qu'elle me fera de petites statuettes en cire ou en argile que je
prendrai à mon retour. Avec une autre j'échange des aiguilles d'acier contre
des aiguilles faites d'une dent très effilée de poisson.
L'Indien ne connaît pas l'usage des cadeaux, et lorsque je donne un couteau, on me dit toujours :Etihe ? c'est à dire : Que veux-tu ? Leur petit commerce se fait par des échanges; l'acheteur doit toujours payer d'avance.
Les Bonis qui viennent faire du commerce en pays roucouyenne sont obliges de payer les hamacs qui ne leur seront livres que l’été suivant.
XVIII
Maison sur un arbre. — La chute des feuilles en été. — Véritable rivière des Amazones. — Description de ces femmes qui ont fait rêver nos grands-pères. —Autant de galons que d'enfants males. — Comment-on devient Amazone. — Un souper frugal dans ce pays légendaire. — Mangeur de termites. — Influence de la latitude et de l'altitude sur mon état sanitaire. — Le kinoro. —Un monolithe. —Les impressions de voyage d'un Indien dans le pays des blancs. — Ananas sauvages. — Sentier du Parou au Maroni. — Renseignements pour les chasseurs de coqs de roche. — Canot chaviré.
31 octobre. — Après deux heures de marche nous rencontrons l'embouchure de la crique Coucitenne que nous avons traversée en allant du Yari au Parou.
Un peu en amont je découvre un gros nid dans les branches d'un grand arbre qui est sur la lisière d'un abatis. En approchant je reconnais qu'il s'agit d'une véritable hutte avec un plancher et un toit en feuillage où un Indien, blotti comme un singe, se prépare à flécher les oiseaux qui viennent savourer les graines mures de cet arbre.
Vers quatre heures nous passons devant une petite montagne
appelée Manaou; ce serait un bel endroit pour camper, mais Il y a beaucoup
de moustiques.
Yacouman veut atteindre un petit village qui est éloigné de deux heures de canotage.
Je fais remarquer à Apatou qu'il y a beaucoup de bois sec sur les collines,
et Il me répond : Arbres là, pas pourri, quand pluie veni gagné feuilles.
En Guyane ce n'est que pendant l'été qu'on voit des arbres perdre leurs feuilles.
Nous arrivons au dégrad quelques minutes avant le toucher du soleil et Il faut encore faire deux kilomètres à pied pour atteindre le village qui est au milieu de la foret. Je suis étonné de ne pas voir un seul homme pour nous recevoir. Nous visitons deux, trois habitations, et nous n 'y rencontrons que des femmes.
Je demande à la plus vieille, c'est à dire à la moins
farouche : « Nepoamole okiri? (Où sont vos hommes?) — Okiriova» (homme
pas), répond-elle dans son langage laconique.
Je suis fort intrigué.
Ai-je donc enfin trouvé ces fameuses Amazones sur lesquelles
nos savants, de la Condamine en tête, ont discuté pendant des siècles ? Oui,
ce sont des femmes qu'Orellana a trouvées près du Trombette et sur lesquelles
un conquérant espagnol a brodé une histoire romanesque qui a fait qualifier
le grand fleuve de rio de las Amazonas.
Je ne doute pas qu' Orellana n'ait rencontré des tribus de femmes, mais
quelle imagination fantastique il a du déployer pour les comparer aux guerrières
chevaleresques des temps homériques. Je constate d'abord que les Amazones du
Parou n'ont pas l'usage de se couper un sein pour se livrer sans inconvénient
à l'exercice de l'arc.
Combien avez-vous eu d'enfants? » demandai-je à l’une
d'elles. Elle me répond en me montrant trois raies rouges sur le haut de la
cuisse.
Ces barres parallèles, qui ressemblent aux chevrons que portent nos vieux soldats
pour marquer leur temps de service, servent à indiquer le nombre d'okiri
(enfants males) que ces malheureuses ont engendrés.
Une de ces femmes me reconnaît pour m'avoir vu dans le
Yari ; elle était alors l'épouse d'un peïto de Yacouman, le nomme Couloun, qui
l'a renvoyée parce qu'elle ne pouvait pas s'accorder avec sa jeune femme.
Apatou en reconnaît une autre qui a été congédiée parce qu'elle parlait trop,
etc., etc.
Les Amazones légendaires n'étaient que des femmes répudiées.
Il est inutile de dire que je ne trouve pas de gibier chez ces pauvres créatures
qui, au lieu d'apprendre à flecher, ont passe leur jeunesse à nourrir des enfants
que leurs maris cruels ont arrachés au sein maternel.
Mon repas se compose de la moitié d'une banane cuite sous la cendre et de petits
coquillages que les malheureuses ont ramassés sur la rive.
Je déroge à l'habitude indienne de ne pas faire de cadeau, en offrant un couteau
et quelques aiguilles à ces pauvres créatures, et au lever du soleil je m'empresse
de quitter ce séjour qui n'est pas enchanteur.
J'ai perdu mes dernières illusions sur la légende des belles Amazones.
En retournant au dégrad je trouve le fils de Yacouman faisant un repas que je n'ai pas envie de partager. Assis devant un nid de termites qu'il vient de trouver, Il plonge une feuille de maripa au milieu des insectes affoles. Ceux-ci se cramponnent au bord de la feuille comme à une planche de salut, et l’Indien les croque à belles dents, laissant les têtes adhérentes par les mandibules.
ler novembre. — Je remarque que ma santé s'améliore chaque
jour; c'est que la chaleur est moins accablante parce que nous nous écartons
de l'équateur et que nous atteignons des régions plus élevées.
Nous rencontrons fréquemment des aras rouge de feu (kinoro) qui viennent
par bandes manger des baies qui se trouvent sur de hauts arbres bordant la rivière.
J'en tue deux d'un coup de fusil, et les Indiens en arrachent aussitôt les grandes
plumes qu'ils se passent dans les oreilles.
Nous ne marchons pas vite, car le courant est assez fort à cause de nombreuses roches qu'on rencontre chaque instant. Vers trois heures nous remarquons une roche granitique qui s'élève à trois mètres cinquante au-dessus du niveau de l'eau. Cette pierre, qui se trouve au milieu d'un rapide appelé Mocori, est considérée comme un monument élevé par un yolock qui fait chavirer les canots.
En amont, la rivière, devenant calme, fait des sinuosités
qui quadruplent son parcours.
Ici elle présente l'aspect du Maroni, de l'Oyapock et du Yari dans leur tours
supérieur. D'un cote, la rive, taillée à pic sur une hauteur de trois mètres,
est formée d'une argile blanche où l'on voit une infinité de trous que pratique
un poisson appelé ya-ya par les Roucouyennes et cuirassier par
nos créoles. De l'autre coté elle est basse, marécageuse, encombrée de moucou-moucou.
Les roches granitiques qui deviennent rares sont remplacées par des roches schisteuses.
Dans l'après-midi nous apercevons sur la rive un petit
caïman suspendu au bout d'un bâton. Il se débat en faisant une mine des plus
grotesques. Je fais approcher mon canot pour le voir de prés.
Le piége est compose d'un bois flexible enfonce dans terre à l'extrémité duquel
sont attachées deux ficelles.
L'une forme un noeud coulant et l'autre porte un bois effile aux deux bouts.
Notre caïman, allèché par un boyau entourant le bâton
pointu, est venu se glisser sous une petite tonnelle arrangée avec des feuilles
et a mordu dans l’appât qui lui était présenté. Cette traction sur la ficelle
a fait lâcher un morceau de bois qui était fixé comme un crochet à un arceau,
et Il a été enlevé du sol par le piège qui s'est redresse comme un arc distendu
avec force.
D'une part il est saisi par le cou au moyen du noeud coulant, et de l'autre
il a les deux mâchoires écartées par une espèce de bâillon qui s'est implanté
dans la bouche.
2 novembre.— à quatre heures nous rencontrons des roches schisteuses que les Ouayanas appellent panakiri tepou (roches des Hollandais), parce qu'elles sont alignées comme les soldats de Surinam qui sont venus jadis faire la guerre dans le Maroni.
Les Roucouyennes ont été frappés en voyant les soldats
blancs s'aligner sur une seule ligne, tandis qu'eux marchent toujours les uns
derrière les autres,c'est à dire à la file indienne.
Ils ont remarque deux autres particularités, c'est que les Hollandais marchaient
en long et en large sur la place d'un village, sans autre but que de remuer
les jambes. D'autre part, lorsqu'un tamouchy appelait un peïto, celui-ci courait
pour répondre au chef.
Les Indiens ne marchent jamais que pour se transporter d'un point à un autre;
et quant à courir, ils le font dans des circonstances si rares que je n'ai jamais
eu l'occasion de les voir aller autrement qu'au pas.
Le lendemain, à neuf heures, nous atteignons une habitation
où nous prenons quelques heures de repos.
Pendant que j'écris mes notes Apatou fait une excursion avec Ouanica, fils de
Yacouman. Je les vois revenir portant des catouris remplis d'ananas. Ils ont
trouve ces fruits en pleine maturité sur une grosse roche granitique au long
d'un sentier qui conduit au dégrad de l'Itany en passant par le mont Lorquin.
Apatou, qui connaît ce trajet, me dit qu'il faut douze jours pour aller du Parou à l'Itany, dont quatre jours pour atteindre le Yari, cinq pour aller du Yari au mont Lorquin, et trois de ce point à l’Itany. En estimant la journée moyenne à dix-huit kilomètres, cela ferait une distance, totale de deux cent vingt-cinq kilomètres avec les accidents de terrain et cent quarante à vol d'oiseau (direction nord-est).
Le voyageur qui traverse cette région pittoresque est
frappe par le cri d'oiseaux jaunes qui voltigent au nombre de cinq ou six d'un
arbre à l'autre comme des étourneaux en criant meou, meou.
Ces oiseaux sont connus des créoles sous le nom de coqs de roche, parce
qu'ils font leurs nids dans des excavations creusées dans le granit.
Les Ouayanas recherchent les meous pour faire des parures et aussi des échanges
avec les Oyampys qui les transportent dans le bas Oyapock. Le male se distingue
de la femelle par sa crête qui est plus développée. Les jeunes ont les plumes
jaune pale, tandis que les vieux ont une teinte jaune ardent presque rouge.
Un peu à l'est de l'Apaouani on traverse des collines
rocheuses que les Indiens appellent Ténénépata, dont la traduction est
: ténéné, montagne ; pata, village.
Il s'agit non pas d'un village dans la montagne comme je le croyais d'abord,
mais d'une réunion de montagnes dont le groupement est comparable à celui des
carbets qui constituent un village.
Je me remets en route à midi et demi, et bientôt nous
rencontrons une petite chute assez difficile à, franchir parce que l'eau, resserrée
entre des roches granitiques élevées, court avec une rapidité effrayante.
Une embarcation ayant été mise en travers reçoit par le cote une volute d'eau
qui la remplit et la fait submerger en un clin d'oeil. Heureusement que la rivière
est peu profonde; nous nous jetons à, l'eau et recueillons tous les bagages,
à l'exception d'objets insignifiants.
Nous sommes obliges de nous arrêter pour faire sécher les bagages. Grâce à un
soleil ardent et à la chaleur des pierres qui sont brillantes au milieu du jour,
notre cassave ne tarde pas à être aussi sèche que sortant du four, et nos cartouches,
qui ne sont pourtant pas métalliques, ne sont pas altérées. Nous avons bien
perdu un sac de plomb dans ce petit naufrage, mais cela nous importe peu puisque,
à défaut de munitions, Apatou peut subvenir à l'alimentation avec son arc et
ses flèches.
Les cent cartouches qui nous restent sont bien suffisantes pour un voyage de
trois mois, car nous ne tirons jamais que sur du gros gibier et au posé.
A cinq heures nous arrivons à un village de quarante personnes appelé Taliman, du nom du tamouchy.
XIX
Un Indien véritablement grand ; d'autres qui le paraissent. —trompé par un buste disproportionné. — Sans pitié pour l'orphelin.— Révélation achetée à bon compte. — Excursion botanique.— La plante de mes rêves, l'urari! — Cérémonial qui précède l'extraction de la précieuse racine. — J'ai les racines, la tige, les feuilles, les fleurs. — A la recherche de plantes accessoires du curare. — Plus sorcier qu'un piay. — La racine d'urari est amère et colore les doigts en jaune. — Détails de la fabrication de Purari ou curare. — Le curare se prépare à froid.— Addition de piment. — Expérience. — Les petites flèches empoisonnées sont décochées au moyen de l'arc. — Une révolte à propos du curare. —Ils sont punis par où ils ont pêché. —Un équipage timoré.
Le 1er novembre, vers dix heures, je vois la rivière se diviser en deux branches. La crique Ataouelé, qui tombe à gauche, a un débit qui est a peu près le quart de celui du Parou. Son cours est entre coupé par de grosses roches granitiques qui en gênent la navigation.
Enfin, dans l'après-midi, nous atteignons l'habitation
du tamouchy Alamoïke qui doit nous enseigner la fabrication de l'urari.
Le village n’est composé que de deux petites familles, de sorte que le tamouchy
Alamoïke n'a qu'un seul peïto à commander. Ce dernier est un jeune homme très
robuste qui ne mesure pas moins d'un mètre quatre-vingts centimètres. C'est
un véritable géant pour le pays, car la taille des Roucouyennes est en général
moins élevée que celle des Français. Ces Indiens vus de loin paraissent pourtant
très grands; cela tient sans doute à leur buste énorme qui fait contraste avec
leurs membres courts et grêles.
La femme d'Alamoïkie est de la tribu des Trios; elle me raconte qu'ayant perdu
ses parents quand elle était encore très jeune, elle a été recueillie par des
Roucouyennes en voyage.
Les habitants des sources du Parou, comme tous les Indiens
de la Guyane, ne font aucun cas des orphelins.
Ces malheureux, obligés de travailler à outrance, n'ont à manger que les restes
de la cuisine qu'ils partagent avec les chiens.
Dans la soirée je fais mes arrangements avec mon hôte qui doit me montrer le secret de la fabrication du poison des flèches. Suivant l'usage, je le paye d'avance avec une hache, et lui promets en outre une pièce de cinq francs qu'il portera au cou en guise de médaille.
Les Roucouyennes ne connaissent pas la fabrication du curare. Alamoïke n’en possède le secret que depuis mon premier voyage ; Il a pu en obtenir la révélation près d'un chef Trio, au prix d'un couteau d'un sou et d'une petite glace que lui a remise Apoïke que j'avais envoyé, l’an dernier, à la recherche du fameux poison.
5 novembre. — Nous partons de bon matin avec le tamouchy,
son peïto et Apatou. Nous descendons en canot au pied d'une petite colline située
sur la rive droite.
Après une course accélérée de deux heures, Alamoïke s'arrête devant une liane
de la grosseur d'un serpent boa qui forme une grande courbe en sortant de terre,
puis s'élève tout droit jusqu'à la cime d'un arbre de vingt-cinq à trente mètres
avec lequel elle confond ses feuilles. Je brûle d'impatience de posséder cette
plante qui est appelée urari par tous les Indiens de la Guyane.
Avant de commencer son opération, Alamoïke donne à chacun des spectateurs un grain de piment que nos créoles qualifient d'enragé, et qu'il faut mordre à belles dents. Ce n'est qu'après s'être assuré quo nous avions mâché et avalé la pilule que le piay se met à fouiller la terre avec un bâton pour dégager les racines.
Une seconde après il me présente un gros scorpion noir
qu'il tient par la queue en disant: Yolocic (diable), sans manifester
ni crainte ni horreur.
Se gardant de tuer cet animal qu'il considère comme un gardien du poison, Il
ajoute quelques mots au milieu desquels je saisis l'adjectif iroupa qui
signifie bon et que je crois pouvoir traduire par ces mots :Tout va
bien.
Le piay continue à fouiller et ne tarde pas à mettre à nu de longues racines
qui se dirigent horizontalement en rampant presque à fleur de terre.
Pendant ce temps je coupe des rejets recouverts de feuilles tendres qui poussent
du tronc et montent verticalement à une hauteur de plus d'un mètre.
Je suis déjà bien aise de posséder ces quelques feuilles, mais cela ne suffirait
pas pour une détermination botanique; Il faut avoir des feuilles complètement
développées et des fleurs.
Un enfant grimpe sur le gros arbre et de là passe sur
la liane le long de laquelle il descend après m'avoir jeté une poignée de fleurs.
Sans en perdre la moindre parcelle, je m'empresse de les ranger dans un cahier
tandis qu'Apatou coupe un morceau de la tige.
Alamoïke a ramassé une grande quantité de racines qu'il renferme dans deux catouris faits séance tenante avec des feuilles de palmier, et nous nous mettons en route.
Enfin nous sommes devant la, rivière, ou nous avons grand plaisir de nous désaltérer. Le piment que nous avons mâché nous a donne une soif intense.
Arrivés à l'habitation, Alamoïke met les deux catouris
à la rivière.
Je passe le restant de la journée et du soir à faire quelques observations astronomiques
et à causer de choses et d'autres avec mes hôtes qui sont fort aimables et dont
les récits et les réflexions, qui ne sont pas toujours à dédaigner, ajoutent
à mes connaissances sur le pays.
 |
Le lendemain nous faisons une nouvelle excursion à la recherche des plantes accessoires qui entrent dans la composition du poison. La première espèce recueillie, appelee potpeu, ne m'est pas inconnue; elle est très voisine d'un faux Jahorandi que j'ai rapporté du Bresil en 1874.
Etant certain que ce n'est pas une plante toxique, je
me mets à la mâcher devant Alamoïke, qui veut m'en empêcher en me criant : «
Natati, » ce qui signifie mourir.
« Natati oua, lui dis-je, piay eon. » (Traduction: n'y a pas de
danger, je suis sorcier aussi bien que toi.
Alamoïke, me voyant avaler impunément une plante qu'il
croyait toxique, n'a plus de secrets pour un collègue qu'il croit plus fort
que lui.
Il me fait cueillir moi-même toutes les plantes qu'il faut ajouter pour faire
le poison.
Nous recueillons ainsi quatre espèces de la famille des pipéritées, l'arapoucani,
l'aliméré, le potpeu et une autre dont j'ai oublie le nom.
Elles ont toutes une saveur piquante qui fait saliver.
Alamoïke ramasse également des feuilles d'un palmier appelé parasa.
Nous passons l'après-midi à racler les racines de l'urari
qui ont passe vingt-quatre heures dans l'eau.
Je remarque que l'écorce présente quelques plis annulaires qui rappellent un
peu certaines racines d'ipeca.
En me livrant à ce travail je ne tarde pas à avoir les mains jaunes comme si
j'avais touche de la teinture d'iode. Je goûte un peu de cette écorce, qui se
détache par petites plaques, et je remarque qu'elle a une saveur amère très
prononcée.
Ce n'est que le troisième jour que j'assiste, non pas
seulement comme témoin, mais comme aide préparateur, à la fabrication du poison.
L'opération se fait dans la hutte du tamouchy. Nous commençons à préparer des
ustensiles qui doivent servir à filtrer des liquides et à les recevoir.
Pour faire un entonnoir, on roule une feuille de palmier en cornet et on l'attache
avec de grandes épines. Cet instrument est placé à demeure, fixé sur une anse
formée par une baguette pliée.
Les récipients, appelés carana, se composent d'une feuille de palmier
pineau, repliée et relevée aux deux extrémités de manière à former une petite
auge.
Alamoïke prend quelques échantillons d'aracoupani, enlève les feuilles, qu'il
rejette, et se met à battre la tige et la racine avec un bâton. Il les plonge
quelques minutes dans un litre d'eau froide contenu dans un carana en les serrant
entre ses larges mains.
Il mouille et écrase de nouveau jusqu'a ce que les fibres déchirées n'aient
plus la saveur piquante qui caractérise les pipéritées.
Il opère identiquement de la même manière avec les racines des autres pipéritées.
Le potpeu entre dans une proportion beaucoup plus grande que les autres
espèces. La même eau sert à toutes ces préparations.
Pendant que mon collègue exprime le suc de ces plantes je suis occupé de mon cote à exprimer des feuilles de parasa dans un autre carana contenant un demi-litre d'eau. Le liquide exprimé, qui n'a pas de saveur particulière, mousse comme du savon. II contient sans doute une forte proportion de sels alcalins puisque les cendres de ce palmier servent à la préparation du sel de cuisine.
Nous arrivons au troisième temps de l'opération qui est
la plus importante. Il s'agit d'extraire le suc de l'urari. Alamoïke mouille
l'écorce avec le liquide alcalin provenant du parasa, et, en prenant
une grosse poignée, Il l'exprime de toutes ses forces.
Le suc, qui ressemble à du jus de tabac, est mélangé aussi de pipéritées et
filtre sur des feuilles qui ont été introduites dans le fond de l'entonnoir.
Le liquide, qui mesure à peu près un demi-litre, est recueilli dans une marmite
de terre et additionné d'une poignée de piment sec écrasé avec un pilon.
Alamoïke met le pot sur le feu et va se laver les mains
à la rivière. Etant resté dans la hutte pour garder la marmite, je suis bientôt
pris d'un éternuement qui me force d'abandonner mon poste. Deux enfants couchés
dans un hamac sont réveillés par les vapeurs de piment.
Cette action du piment sur l'appareil olfactif nous permet d'admettre un fait
qui nous avait paru d'abord invraisemblable. Au dire du capitaine Jean-Pierre,
les vieux Oyampys, voulant arrêter l'ennemi, entouraient leur village d'un cercle
de feu où ils jetaient des poignées de piment sec. Il est impossible de combattre
quand on est pris d'un fol éternuement.
Le pot est retiré du feu après dix minutes, bien avant le commencement de l’ébullition.
La femme du chef, étant entrée en ce moment, dit avec fierté en montrant sa
préparation: « Alimioto » (couata, viande) , c'est-à-dire
voilà un engin qui nous procurera une grande quantité de gibier.
Alamoïke coupe alors le stipe d'un maripa et se met à
tailler des flèches qu'il trempe dans l'urari et fait sécher au soleil. Il ajoute
de nouvelles couches au fur et à mesure de la dessiccation.
Pour que le suc adhère mieux, il a eu soin de faire sur la flèche de petites
incisions qui s'entrecroisent.
Un petit singe qui gambadait est frappé à l'épaule avec
une de ces flèches ; il se met à courir pendant une minute, puis, s'arrêtant,
je lui vois faire quelques grimaces; il cligne de l'oeil, et bientôt ses mains
paralysées lâchent prise, et il tombe à la renverse. Six minutes après la blessure
il est dans un état d'inertie très voisin de la mort; ses muscles ne répondent
plus aux piqûres d'une aiguille. Après sept minutes ce n'est plus qu'un cadavre.
Les dards empoisonnés ont la longueur et la forme d'une lame effilée de couteau;
la base est appliquée dans une taille faite à l'extrémité d'une flèche. On la
projette au moyen d'un arc ordinaire. Lorsque le gibier est atteint, le roseau
entraîné par son poids tombe à terre, tandis que la petite flèche reste dans
la plaie.
Pendant que je me livre à ces études, Stuart et Hopou deviennent chaque jour plus récalcitrants et refusent de m'accompagner jusqu'aux sources du Parou. Me voyant faire des provisions de curare, ils prétendent que j'ai l'intention de livrer la guerre aux Indiens Trios.
Stuart, qui est le plus fort et le plus méchant, m'a
refusé l'obéissance dans la journée, et dans la soirée il ose venir à moi pour
m'insulter devant le chef indien.
Je saisis mon fusil et le couche enjoue. Le bruit des batteries qui s'arment
agit sur l'agresseur comme coup de foudre ; sa loquacité furieuse fait place
au silence.
Je pars le lendemain avec Apatou; mes deux noirs révoltés
assistent au départ et se flattent de me forcer à battre en retraite faute d'équipage.
Je m'embarque avec Yacouman et Apatou dans une toute petite pirogue.
Une heure après j'aperçois un canot qui s'efforce de nous rejoindre; ce sont
nos déserteurs qui viennent faire leur soumission en pleurant comme des enfants.
Docteur J. CREVAUX
(La suite à une autre livraison.)
DE CAYENNE AUX ANDES,
PAR M. JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE FRANCAISE.
1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INDDITS.
PREMIERE PARTIE. — EXPLORATION DE L'OYAPOCK ET DU PAROU.
XX
Un Equipage timoré. — Caïman — De la proximité des sources du Tapanaltoni et du Parou. Deux rivières Parou. — Indiens amphibies. — Etymologie du mot Parou. — Roches moutonnées. — Saut du grand escalier.
8 novembre 1878 (sixième jour de navigation en remontant
le Parou). — A onze heures, nous trouvons la rivière entrecoupée par des roches
et des lies absolument identiques aux rapides et aux petites chutes du haut
Oyapock. A un détour un Indien me dit qu'il vient de sentir de la fumée. Nous
étant arrêtés pour scruter les alentours, nous percevons le timbre d'une voix
humaine. Hopou et Stuart, craignant un combat avec les Indiens Trios, veulent
redescendre au plus vite, mais Yacouman les rassure en disant qu'il vient de
reconnaître le langage ouayana.
Quelques instants après, nous débarquons dans une petite île rocheuse où six
Indiens, avec autant de femmes, s'occupent de la cuisson d'un petit caïman qu'ils
viennent de prendre.
Le chef de la bande m'informe qu'il revient d'une excursion
au pays des Trios; mais il n'a rencontré personne dans les villages qu'il a
visités. Une épidémie avant ravage le pays, les survivants ont quitte la rivière
pour se réfugier dans la foret. Il nous engage vivement à retourner sur nos
pas, parce que là-haut nous ne trouverons que la famine et peut-être la guerre.
En attendant le repas auquel nous invitent ces braves Indiens, j’écris quelques
notes, les pieds dans l'eau, l'ombre d'une grosse roche formant une véritable
grotte.
Ensuite, je masse mes jambes en parcourant les nombreuses
petites îles, qui offrent un aspect des plus pittoresques.
Dans un endroit reculé, je surprends une petite fille qui, comme l'autruche,
se cache le visage dans un trou, laissant son corps complètement à découvert.
A midi, je prends place autour de la marmite des Indiens, qui renferme un gros
morceau de caïman bouilli avec force piment. Apatou ne vent pas goûter à ce
mets, pourtant très estimé par les Roucouyennes.
J'éprouve aussi une certaine répugnance, que je ne tarde
pas à surmonter, en reconnaissant que cette chair blanche et tendre ne présente
pas un fumet trop prononcé.
La grosse espèce de caïman (jacares) qu'on trouve à l'embouchure des
fleuves de la Guyane et sur l'Amazone n'est pas comestible à cause d'une forte
odeur de musc.
Après dîner, j'interroge mes hôtes sur les Trios et les indigènes des régions voisines. Entre autres indications intéressantes pour la géographie, j'apprends que les nègres Youcas établis sur le Tapanahoni viennent faire des échanges jusqu'aux sources du Parou. II y a seulement trois jours de marche par terre pour passer du Tapanahoni à un point ou le Parou devient navigable. Les Indiens Trios, qui seraient moins nombreux que les Roucouyennes, occupent le tiers supérieur du Tapanahoni et les sources du Parou [10].
Une question qui m'intéresse vivement, c'est de connaître l'affluent de l'Amazone qui court à l'ouest du Parou. Les Roucouyennes, craignant que je ne pousse mes excursions jusque dans ces parages, même racontent que des histoires fantastiques. En marchant quatre jours vers le soleil couchant, on rencontre, disent-ils, des Indiens très méchants qu'il est impossible de surprendre, parce qu'ils passent la nuit plongés dans une rivière qu'ils appellent Parou, comme le cours d'eau que nous parcourons.
Cette légende à la plus grande analogie avec les renseignements
qui ont été fournis à Brown dans le haut Essequibo par les Indiens Tarouma.
Ils lui ont dit qu'il y avait vers les sources du Trombette des Indiens appelés
Touna-hyannas, qui se retiraient la nuit dans des étangs entourés de
palissades, ou ils dorment le corps plongé dans l'eau. Notons en passant que
touna signifie eau, non seulement chez les Tarouma, mais dans la langue
des Trios, des Roucouyennes, des Apalaï, des Carijonas. Les Caraïbes des Antilles
désignaient l'eau par le mot tone.
Le nom de la rivière Parou n'a pas de sens ; mais il est probable que c'est
un diminutif de parourou,qui signifie balisier.
En amont de la dernière chute le courant est faible, et les rives sont si basses que nous devons marcher jusqu'à cinq heures vingt minutes pour trouver un endroit propice au campement.
9 novembre. — Les rives ne tardent pas à s'élever et le lit présente un grand nombre de roches à découvert.
A dix heures, nous voyons la rivière entrecoupée par une infinité de blocs granitiques mamelonnés et de couleur grise qui, vus de loin, ont l'aspect d'un troupeau de moutons. Ils sont si rapproches que mon étroite pirogue a de la peine à trouver un passage.
A midi et demi, nous arrivons à une espèce de couloir au fond duquel on voit un grand escalier, une espèce d'estrade qui semble avoir été élevée parla main de l’homme. Les gradins sont à sec ; c'est que dans cette saison toute l'eau court en serpentant dans une rigole qui n'a pas plus de deux mètres de longueur.
XXI
La rivière des tombeaux. — Les imprécations d'une femme trio.— Malade abandonnée. — Huttes. — Manière d'arrêter la pluie.— Paragua. — Détails sur la composition des flèches. — La tête de la grosse perdrix est amère. — Le nicou. — Le langage des Trios a beaucoup de rapport avec le ouayana. — Sobrieté de costume. — Coiffure des hommes et des femmes.
Vers quatre heures, nous arrivons à un village situe
sur un petit affluent de droite appelé Aracoupina.
Toutes les maisons sont désertes et au milieu on remarque un enfoncement dans
la terre : ce sont les sépultures d'un grand nombre d'Indiens.
Apatou est parti en éclaireur avec Yacouman pour tacher
de trouver quelques habitants dans les alentours; ils reviennent bientôt suivis
d'un couple d'Indiens.
La femme refuse mes présents, et, me montrant trois fosses fraîchement comblées
, prononce d'un air sombre les paroles suivantes :Panakiri ouani oua, blancs
besoin pas. Ala pikininialele, là enfants morts. Nono poti, terre
trou. Echimeu ouaca, vite pars. Cassava mia oua, cassave manger
pas.
A ces mots, elle se retire farouche et disparaît dans le bois avec l'Indien
qui l'accompagnait.
Nous passons la nuit dans ces lieux sinistres, et le lendemain nous continuons à remonter le Parou.
Bientôt nous trouvons le cours de cette rivière si difficile
à la navigation, même avec une embarcation minuscule, que je me décide à ne
pas aller plus loin.
Le succès de ma mission est assuré ; je n'ai plus qu’à effectuer mon retour
en relevant le tracé de la rivière à la boussole, et en prenant des hauteurs
de soleil dans les points principaux.
Apatou ne veut pas quitter ces régions sans laisser une trace de notre passage. Il me demande d'inscrire mes initiales sur un gros arbre qui se trouve sur une pointe, à la rive gauche de la crique Aracoupina.
En redescendant, nous avons bien soin de regarde de tous cotés, pour découvrir des habitations. Nous apercevons deux villages, mais ils sont complètement abandonnés, et au milieu des maisons, qui pour la plupart sont brûlées, se trouvent des fosses récemment comblées.
Prés d'une de ces habitations, je vois une pauvre femme
malade qui n'a plus de vivres. La malheureuse a été abandonnée par ses compagnons,
fuyant la maladie.
Le premier mouvement de cette femme est de m'insulter, mais la faim et l'instinct
de conservation portent conseil: elle n' hésite plus à prendre passage dans
un de mes canots pour gagner un village Roucouyenne où je lui ferai donner l’hospitalité.
Cette femme me dit que le chef du village appelé Pacani et le piay Toutey, qui
jouissaient d'une grande réputation parmi les Trios, ont été les premières victimes
de cette épidémie, que je suppose être la variole.
Les maisons trios sont moins confortables que celles des Oyampis et des Ouayanas. Non seulement elles n'ont pas d'étage, mais quelques-unes d'entre elles ne sont couvertes que d'un coté; ce sont de simples abris qui ne sont guère plus perfectionnés que les ajoupas que l’on fait en voyage.
11 novembre. — à six heures du matin, le temps est couvert
et la température ne dépasse pas vingt-deux degrés. Je grelotte comme si j'avais
la fièvre.
J’éprouve un vif plaisir à me chauffer près du feu qui fait bouillir un petit
caïman et une grande perdrix que les Ouayanas appellent sosorro, à
cause du bruit qu'elle fait en s'envolant.
II a tombé une averse pendant la nuit. Pour empêcher la pluie, Apatou recommande à Stuart de ne plus laver l'intérieur de la marmite. Cet usage singulier, pratiqué par les nègres marrons de la Guyane, a sans doute été emprunte aux Indiens. En effet, l'Anglais Brown, voyageant dans le Mazaroni, demanda un jour à ses canotiers pourquoi ils ne lavaient pas la marmite qui devait servir à cuire du riz. Ils répondirent que s'ils plongeaient leur pot dans l'eau, la pluie qui commençait à tomber redoublerait d'intensité.
Nous entendons prés du camp un oiseau qui fait paragua....
paragua!... C'est le paragua, que les Ouayanas appellent araqua et
considèrent comme l'oiseau de la pluie.
Ouanica cherche à le tromper en imitant son chant, mais Il s'envole au moment
où le chasseur tend son arc pour lui décocher une.
Disons en passant que les flèches qui servent pour la chasse en l’air portent
des plumes près de la grosse extrémité, tandis que celles qui sont employées
pour la chasse dans l'eau n'ont pas de garniture.
Nous avons vu que ces dernières portent souvent un crochet fait avec un éclat de radius de couata; celles qui sont destinées à la chasse des oiseaux et des singes sont terminées par un bois dur, armé de piquants tournés en arrière, de telle sorte qu'ils ne sortent pas de la plaie sous l'action de la pesanteur.
Les plumes employées pour les flèches proviennent des ailes du hocco, de la maraye, du couioui, de l'ara et du pia.
Pour la chasse des petits oiseaux, les Indiens de la Guyane terminent leurs flèches par une masse assez lourde taillée dans un os ou dans une graine d'aouara. Les hommes s'occupent seuls de la fabrication des arcs et des flèches.
La cuisine est faite : on sort le petit caïman de la marmite et on le dresse sur une spathe de palmier qui constitue un plat très commode. La perdrix est placée dans une écuelle en terre, fabriquée par une femme roucouyenne. Je veux prendre un peu de bouillon, mais je le trouve d'une amertume affreuse; c'est que Stuart, qui ne connaît pas la cuisine des bois, a négligé de rejeter la tête de l'oiseau. Le caïman n'est pas meilleur, parce que nous n'avons plus de piment pour l'assaisonner. Nous sommes arrivés à nous passer de sel depuis plus d'un mois, mais la privation du piment nous parait insupportable.
Pendant que j'observe le soleil, à midi, Apatou va faire une excursion et trouve une liane plus grosse que la cuisse, que les Roucouyennes appellent Salisali (Robinia nicou Aublet). Elle est si lourde qu'elle a écrasé l'arbre sur lequel elle s'enlaçait. En sectionnant la tige noire, nous voyons couler un suc semblable à de l'eau de source, qu'Apatou me fait déguster. Quoique provenant d'une plante toxique, elle est absolument inoffensive. Les Indiens, lorsqu'ils traversent des montagnes, en boivent la sève, qui est plus fraîche que l'eau des claires fontaines. On ne doit boire que le premier jet du liquide, car ensuite il s'écoule un suc blanc laiteux qui a des propriétés toxiques.
Yacouman fait une grande provision de la tige du nicou, qui pourra nous être très utile pour prendre du poisson. . La plante, desséchée, est presque aussi active qu'à l'état frais; on peut la conserver et s'en servir pendant une année.
Les cheveux des femmes tombent à l’abandon sur les épaules,
tandis que ceux des hommes sont reunis en une grande mèche qui tombe dans le
dos. Ils sont retenus dans une espèce de cornet formé d'une liane enroulée en
spirale.
Chez les Trios, ce sont donc les hommes qui portent la queue, tandis que chez
les Galibis ce sont les femmes.
XXII
A la recherche des fruits de I'urari. — Un hercule indien. — Abatage d'un arbre dans le grand bois. —Je m'étais trompé. — Le cri de la maraye. — Manière de l'appeler. — L'autorité d'un tamouchy. —Manière de reconnaître le meilleur gouvernement. — Princesse héritière. — Privilèges des jeunes tamouchys. —Du rôle de la femme chez les Indiens. — A chacun ses attributions.—Dévoré par les chiques_ — L'Indien ne pardonne pas.— Albinos. — Fleurs animées. — Exemple de loyauté. — Industrie des Indiens. — Fabrication des colliers ouiébé et shérishéri.
Nous arrivons à neuf heures chez Alamoïke, qui, pendant
mon absence, a récolté des racines d' urari.
Je pourrais me contenter de mes indications sur 1'urani; je possède les éléments
d'une description de la plante, puisque j'ai recueilli les racines, la tige,
les feuilles et les fleurs; mais je voudrais avoir les fruits.
Alamoïke et son peïto, désireux d'avoir quelques hameçons, consentent à venir
à la recherche de nouvelles plantes d'urari.
Nous trouvons une de ces lianes à une petite distance
de l'habitation, mais elle s'élève si haut, que même avec ma lorgnette je ne
puis distinguer les fruits. Il n'y a qu'un moyen de bien voir notre plante,
c'est d'abattre le gros arbre sur lequel elle s'appuie.
Celui-ci a au moins quarante mètres de haut sur un mètre de diamètre. La tâche
sera difficile, mais le vigoureux Indien se charge de l'abattre, et, la hache
la main, Il se met aussitôt à l’oeuvre.
Cet homme rouge de feu, aux muscles énormes, la chevelure épaisse flottant sur
les épaules, ressemble aux géants de la Fable forgeant les foudres de Jupiter.
Enfin nous entendons un petit craquement qui est suivi d'un grondement épouvantable. Je me prépare saisir ma proie, mais voila que l'arbre reste suspendu, béquillé pour ainsi dire par un robuste cèdre qui ne s'est pas laissé entraîner dans la chute. Il faut abattre celui-ci, puis un autre. Deux heures s'écoulent avant que noire liane soit à terre. Je grimpe au milieu du fouillis que forment des plantes parasitaires entremêlées avec l’urari à des branches de plusieurs arbres. Je m'aperçois que les Indiens m'avaient induit en erreur. Les fleurs et les petits fruits que nous trouvons ne ressemblent pas à ceux qui nous avaient été présentés. Nous reconnaissons un strychnos, tandis que l'autre plante était étrangère à cette famille.
Malgré les instances d'Apatou pressé par la faim
et encore plus par les moustiques qui nous dévorent, je ne me retire qu'après
avoir suivi ma liane depuis les feuilles jusqu'à la racine.
Au retour de cette heureuse excursion nous entendons un oiseau. C'est une excellence
maraye qui nous fournirait notre déjeuner.
L'oiseau ayant disparu dans les branches d'un arbre élevé, un Indien se met
à siffler comme un serpent en colère. Le gibier affole voltige au-dessus de
la tête d'Apatou, qui pourrait le tuer au moment où il plane mais qui attend
qu'il se repose pour l'abattre à coup sûr.
14 novembre. — En arrivant à Talimapo (village de Taliman),
je m'aperçois de la disparition d'une hache que je suppose avoir été dérobée
par Alamoïke.
Apatou en informe le vieux tamouchy Taliman. Celui-ci me dit « Ne crains rien,
tu auras ta hache demain. »
Il donne des ordres, et une Légère pirogue montée par deux jeunes Indiens se
met en route pendant la nuit.
Avant le départ, ces jeunes gens se font faire des scarifications
sur les deux bras. On serre le biceps en haut et en has et on taille légèrement
la peau avec une lame de bambou ayant la forme d'un coupe-papier.
Les coupures qui se font suivant l'axe du bras sont très rapprochées les unes
des autres. Ils prétendent que cette opération leur donnera plus de force pour
pagayer.
Ils ne partent jamais pour une grande chasse sans se
tirer un peu de sang des bras, ce qui les empêche, disent-ils, de trembler en
tirant l'arc.
De même, avant de faire un voyage par terre ils ne manquent jamais de se faire
des incisions au niveau des mollets.
Les Roucouyennes ne se tatouent généralement pas, mais
les Trios se font quelques marques noires à la partie interne du bras, au niveau
du biceps.
A propos du tatouage, Apatou me donne des détails très intéressants sur les
cicatrices en relief que lui et tous les gens de sa tribu portent sur toutes
les parties du corps.
J'avais signalé la teinte plus foncée des cicatrices. Cela tient à un détail d'opération qu'on m'avait caché. Apres l'incision on saupoudre la plaie avec du charbon en poudre impalpable, et on frotte pendant longtemps avec une tendre pousse de bananier. C'est à l'introduction du charbon dans le tissu cellulaire qu'il faut attribuer la belle couleur noire que présentent les tatouages en relief de tous les nègres marrons de la Guyane [11].
Taliman parait jouir d'une grande autorité. Yacouman,
qui est le chef le plus important du Yary, fait le plus grand éloge de ce petit
potentat.
Sene oua inele peïto capsac? Ne vois-tu pas, me dit-il, que ses soldats
sont tous gras ? Les qualités d'un chef ne sont pas seulement dans la guerre,
Il peut les montrer en temps de paix en donnant des ordres intelligents pour
la pêche, la chasse et la culture du manioc.
Taliman n'est pas le fils d'un tamouchy; autrement dit,
ce n'est pas un prince héritier ; Il a obtenu le diadème d'écailles de caïman
en épousant la fille du chef.
Vous voyez que les femmes ne sont pas seulement considérées la, comme des bêtes
de somme, puisqu'elles héritent de la couronne, sinon pour elles, du moins pour
un peïto de leur choix.
Le défunt avait pourtant laissé des enfants males plus âgés que sa fille, mais,
ne les ayant pas juges capables de commander, il a donne la couronne à un de
ses sujets en même temps que la main d'un enfant préféré.
Son fils Couloun, étant oblige d'obéir à son beau-frère en qualité de simple
peïto, a préféré quitter la tribu pour s'établir dans le Yary, où nous l'avons
rencontré.
Les tamouchys héritiers, Ouanica est de ce nombre, ont certains privilèges sur les autres enfants. Lorsqu'ils mangent, ils ont le droit de s'asseoir sur un cololo comme le chef régnant, tandis que les sujets sont accroupis sur leurs talons. D'autre part, ils se distinguent des peïtos par les honneurs qu'on leur rend dans les tribus qu'ils traversent. La veille du départ, la jeune femme du chef du village prend le soin de peindre le beau Ouanica des pieds à la tête avec du roucou. Comme nous rencontrons des habitations presque tous les jours, il est continuellement peinturluré de frais.
Les voyageurs américains prétendent à tort que les hommes n'ont d'autres occupations que la pêche et la chasse, tandis que la femme fait tous les travaux.
L'homme a le soin des arbres, coupe l'abatis, plante le manioc, les bananes, etc. Lorsque la famille se rend à l'abatis, ce sont les hommes qui pagayent; les femmes n'interviennent qu'autant que ces derniers ne sont pas en nombre suffisant arrachent le manioc ensemble; mais c'est toujours l'homme qui coupe les bananes, grimpe sur les arbres pour cueillir les papay, les graines de comou et de ouapou. Les femmes ramassent les fruits et les portent à la maison; quand les hommes reviennent de la chasse, ils apportent leur gibier jusqu'a la lisière de la forêt, on les femmes vont le pendre pour traverser le village. Les femmes font la cassave, le cachiri, enfin s'occupent de tous les détails de la cuisine et tissent les hamacs. En voyage, les femmes portent le catouri comme les hommes, mais il est beaucoup moins chargé; Il ne renferme généralement que la marmite et un hamac. Les hommes travaillent seuls à la construction des maisons.
Le rôle de chacun est si bien défini que le voyageur est certain de ne rien obtenir s'il commande aux hommes un travail qui est l'attribut des femmes.
J'aurais besoin moi-même d'un badigeonnage au roucou, car je me sens dévoré par une infinité d'insectes que j'ai ramassés en faisant une excursion botanique; je fais enduire mes pieds d'huile de capapa au moment du coucher.
Je pensais dormir comme un bienheureux, sachant que cette huile amère à la propriété de tuer les chiques et les tiques, mais voila que pendant la nuit j'éprouve des démangeaisons insupportables. Les chiques empoisonnées font dans la peau de mes orteils des ravages diaboliques.
14 novembre. [12]— Je n'ai pas fermé l’oeil et au réveil
Je vois sur l'extrémité des orteils de petites vésicules remplies d'eau. Une jeune femme se met à l’oeuvre avec un os taillé en pointe et retire onze cadavres de cette affreuse puce pénétrante que les Roucouyennes appellent chique.
L'opérateur m'offre les premiers parasites qu'elle retire
pour les mettre sous ma dent. Je ne puis me résoudre à l'usage des Ouayanas,
qui croquent leurs chiques au fur et à mesure de l'extraction.
Je demande à un Indien: Pourquoi manges-tu tes chiques? » Il me répond : « Parce
qu'elles m'ont dévoré les pieds. » Dans la matinée nous partons devant un petit
affluent de gauche que les Ouayanas ne remontent jamais, à cause des singuliers
habitants qui habiteraient prés des sources.
Yacouman raconte sur la foi du piay qu'on y rencontre des Indiens aux cheveux blonds qui dorment le jour et marchent toute la nuit.
Nous rencontrons à chaque pas des bandes de kinoros
(ara Conga) qui mangent des graines. Les oiseaux en repos sur la haute cime
des arbres simulent de belles fleurs d'un rouge flamboyant.
Nous en tuons cinq ou six tous les jours, c'est à dire autant qu'il en faut
pour notre alimentation.
Je remarque que mes cuisiniers rejettent à la rivière les becs d'ara : c'est qu'ils prétendent que les chiens qui les mangeraient pourraient s'empoisonner.
15 novembre. —Nous avons campé sur une île ravissante,
où nous sommes réveillés par le bruit d'un canot qui descend la rivière. Ce
sont les jeunes peïtos de Taliman qui ont marche toute la nuit pour nous apporter
la hache qui était restée à l'habitation ou nous avions étudié l’urari. Je récompense
ces braves gens en leur donnant un petit couteau; je fais également un cadeau
à leur tamouchy : c'est un collier composé de petits grelots qu'il désirait
vivement.
Je les charge également de remettre au grand tamouchy du haut Parou une feuille
de papier sur laquelle j'ai signalé cet acte de probité.
Les voyageurs qui suivront mon itinéraire trouveront cette pièce dans le fond d'un petit pagara où il sera conservé comme un fétiche.
16 novembre. — Nous dormons à l'habitation de Tacalé, où sont les objets que j'ai payer d'avance, c'est-à-dire un petit hamac de nourrice, des animaux en tire, un tapira en terre cuite et de petites courges enfilées en collier sur lesquelles des femmes ont dessiné des hommes, des diables et des animaux. La jeune femme qui me présente le petit hamac fort bien tissé me dit : Amole oli amolita shiri. Traduction : Tu le donneras à ta femme.
Nous assistons à la fabrication de colliers composés
de petits cylindres juxtaposés que les Roucouyennes appellent tairou, et
que nos créoles connaissent sous le nom de ouabe.
Ils emploient la coque d'une graine portée par une liane (Omphalea diandra)
qui s'élève jusqu' à la cime des grands arbres. L'amande, très savoureuse,
donne une huile légèrement aromatique employée par les Bonis en cuisine pour
faire rôtir les coumarous, et en parfumerie pour lustrer leurs cheveux crépus.
L'Indien casse l'enveloppe avec les dents, et, saisissant un éclat de la main gauche, Il le perfore au moyen d'une dent d'aymara ou de sakane (grands poissons) fixée à l'extrémité d'un petit bâton qu'il roule vivement sur la cuisse droite. Les morceaux perforés sont enfilés et polis à la main avec des débris de poteries pulvérisés et mouillés.
Le ouabé que les nègres font dans la basse Guyane à Kourou
et à Iracoubo est plus fin que celui des Roucouyennes. C'est qu'on se sert d'instruments
perfectionnés; on perfore la graine avec une vrille mise en mouvement au moyen
d'un archet. Les Trios font des colliers absolument semblables et les appellent
avourou. Ils emploient une graine ayant la coque beaucoup plus épaisse.
Les Roucouyennes font également devant nous une espèce de collier appelé ouayary,
que nos créoles désignent sous le nom de shéri-shéri. Ce sont des
graines coniques que l'on enfile en les appuyant base contre base. Leur fabrication
est plus simple que celle du ouabe; on casse en deux une petite graine ovalaire
appelée ouayary; la grosse extrémité est rejetée tandis que l'autre est
appliques dans une cavité creusée à l'extrémité d'un petit bâton. La base du
cône est usée par le frottement sur une pierre plate.
XXIII
Ma femme. — Mariage précoce. — Hommes à queue. — Couteau servant de mouchoir. — Pêche miraculeuse. — Effets du nicou. — Apatou malade imaginaire. — Géophages. — Le couioui. —Vampires. — Une prison dans le grand bois. — Un coup de tête d'Apatou. — Sentier entre le Yary et le Parou — Scènes de barbarie. — Une lacune dans le grand bois. — Prairies et forets de l’Amérique du Sud. — Tortues. — Recherche des oeufs d'iguane.— Fabrication de la ficelle. — Danse du toulé. — Manière d'offrir un présent. —
17 novembre. — Je trouve dans mon hamac une fillette
de cinq à six ans qui m'appelle okiri.
Ce joli bébé, à qui j'avais fait des caresses en remontant le Parou, est
destiné à devenir ma femme.
J'avais dit au père : « Quel bel enfant! je voudrais bien l'avoir. »
On a réfléchi pendant mon absence, et la pauvre petite, que les Ouayanas ont
déjà qualifiée de parachichi oli, l’épouse du Français, est toute prête
à voyager avec moi.
Le vieux Tacalé ne m'impose qu'une condition: il faudra que je revienne dans
la tribu, ou je lui succéderai comme tamouchy.
18 novembre. — Nous arrivons à deux heures Caneapo ; c'est ainsi que 1’on désigne l'habitation du tamouchy Ganea. voyant que nous- apportons du nicou, nous propose une grande pêche pour le lendemain matin.
Pendant que mes hommes se reposent et que je fais des études de moeurs, les peïtos se mettent à écraser la liane enivrante sur les belles roches qui sont en face du village.
Au lever du soleil, on jette une grande quantité de nicou
en amont du petit saut ; des coumarous affolés courent avec la rapidité de la
flèche et bondissent en faisant jaillir l'eau comme des pierres qu'on jette
obliquement pour faire des ricochets.
Ces mouvements désordonnés sont bientôt suivis d'un état de paralysie; le poisson
vacille un peu, puisse renverse sur le dos. Armes de bâtons, nous courrons entre
les roches, tantôt à la nage, tantôt ayant de l'eau jusqu'au cou, et nous ramassons
les coumarous, qui ne tarderaient pas à reprendre leurs sens engourdis.
Apatou n'assiste pas à cette pêche sous prétexte de malaise; mais, en l'examinant
au retour, je m'aperçois qu'il n'a pas la moindre fièvre; sa maladie n'affecte
que le moral.
En attendant la cuisson du poisson, je vois plusieurs
Indiens manger de la terre.
Tons les Roucouyennes sont géophages. On trouve dans charge maison, sur le boucan
où l'on fume la viande, des boules d'argile qui se dessèchent à la fumée, et
qu'on mange en poudre.
Dans la journée, à une heure toujours éloignée des repas, Ils prennent une de
ces boules, enlèvent la couche qui est noircie par la fumée, et raclent l'intérieur
avec un couteau. Ils obtiennent une poudre impalpable dont Ils avalent cinq
ou six grammes en deux prises.
Il m'est impossible de recruter des hommes pour m'accompagner dans la descente du Parou. Les Indiens font tout ce qui leur est possible pour me détourner de mes projets; ils disent que nous trouverons des monstres fantastiques, des chutes insurmontables.
Nous partons quand même le 18 au matin. Mais, deux heures après, nous faisons une petite reconnaissance à l'embouchure d'une crique à la recherche de quelque gibier. Nous ne tardons pas à voir un couioui (Penelope leacolophia), qui s'éloigne d'abord, mais qu'Apatou fait retourner en criant couioui. Cet oiseau, qui est de la grosseur d'une poule, a le corps noir, la tête blanche et les ailes tachetées de Blanc. Quoique très voisin de la maraye, c'est un gibier moins estimé; on le rencontre souvent dans les terrains marécageux avoisinant l'embouchure des petits tours d'eau, parce qu'il y trouve des graines de palmier ouapou (assaï).
Dans le Parou, comme dans les autres rivières de la Guyane,
le voyageur rencontre souvent des bandes de petites chauves-souris qui s'envolent
en tourbillonnant d'un arbre à l'autre. Cette espèce est inoffensive. Ces oiseaux
dormant sous un tronc d'arbre incliné dans la rivière, auquel elles sont suspendues
par les pattes. Il y a une espèce de vampire un peu plus grosse qui se tient
dans les maisons et qui fait des morsures à l'homme et aux animaux. Dans la
plupart des cas il s'attaque au gros orteil; Il mord de préférence entre les
deux sourcils et au bout du nez. Ces plaies, très légères, guérissent généralement
sans laisser de cicatrices et n'ont qu'un inconvénient, c'est de saigner assez
abondamment dans un pays ou l'on a déjà trop de tendance à l'anémie. Les boeufs,
les chevaux et les chiens succombent quelquefois d'épuisement à la suite de
piqûres répétées produites par les vampires.
Un fait curieux est que cet animal, qui attaque toujours pendant la nuit, ne
réveille jamais sa victime.
Ce n’est que le lendemain matin qu'on s'aperçoit de la blessure, non pas par
la douleur qu'elle provoque, mais par une assez grande quantité de sang qu'on
trouve dans son lit ou dans son hamac.
Vers deux heures nous atteignons une habitation ou je
retrouve deux personnages de connaissance.
C'est ce couple d'assassins fugitifs de l'Amazone que nous avons rencontres
l'an dernier dans les eaux du Yary, Ces misérables, ayant trompé leurs voisins,
sont obligés de vivre dans l'isolement le plus complet. Leur liberté est plus
dure que les verrous de la geôle; âgés et malades, Ils sont destinés à mourir
de faim au milieu de la forêt qui menace d'envahir leur habitation.
Je défends à mes noirs d'avoir aucune relation avec ces malfaiteurs; la vieille femme au nez de vautour, aux yeux de hibou, serait bien capable de nous faire subir le sort de son premier mari, c'est à dire de nous empoisonner avec un breuvage de sorcière.
19 novembre. — Apatou ayant enfreint ma consigne pour acheter un hamac, je lui fais quelques reproches sur sa conduite. S'étant fâché, il me dit : « Toi pas content, moi parti. » Je ne réponds pas à cette impertinence.
Bientôt nous arrivons à une chute ou il faut passer bagages
et canots par terre. Apatou ramasse sa pacotille qu'il charge sur un petit canot
et demande à me serrer la main en signe d'adieu. Je veux lui payer, séance tenante,
cinq cents francs que je lui dois; mais il refuse, disant que je n'ai pas besoin
de le payer puisque je ne suis pas content de ses services.
Une demi-heure après, au moment où je croyais mon patron déjà bien loin, je
le vois passer avec une lourde charge sur le dos. Il n'a pas tarde à redescendre
et s'est mis au travail sans dire mot.
Nous passons vers dix heures devant la tête d'un sentier
suivi par les Indiens qui vont du Parou au Yary. Il faut deux jours et demi
pour atteindre le village d'Akiepi, et de là un jour de canotage en descendant
la crique Apaqua, qui débouche dans le Yary, un peu en aval du village
de Macouipi.
Si l’on ne veut pas se servir de canot, il faut quatre jours et demi de marche
pour aller à cette habitation.
Des Indiens que nous trouvons campés au débarcadère consentent à nous accompagner jusqu'a leur petit village appelé Paleouman. En route, ils nous racontent une histoire qui s'est passée l'an dernier dans ces parages:
Le tamouchy Akiepi, n'ayant pas planté de manioc en quantité
suffisante, alla s'installer chez Macouipi, qui lui fournit de la cassave et
du cachiri pendant toute la mauvaise saison. Revenu chez lui, il ne se donna
pas la peine de faire un abatis, trouvant plus commode d'aller mendier ou voler
le manioc de ses voisins.
Ce paresseux, très rusé, ne se servait pas de sabre d'abatis pour couper les
tiges de manioc : Il les arrachait de manière à faire croire que les dégât avaient
été produits par des agoutis.
Macouipi, qui se laisse prendre au piège, passe des journées à chercher avec
des chiens le gibier qui détruit sa plantation; enfin ce chef habile ne tarde
pas à découvrir une piste qui conduit de son abatis au village d'Akiepi. Il
part dans la nuit avec deux de ses fils et un peïto et arrive au jour l'habitation
du voleur; Il n'y trouve que des femmes et des enfants, qui lui disent que leur
tamouchy est allé pêcher avec du nicou dans la crique Apaqua.
Macouipi part aussitôt à la poursuite de son voisin.
Arrive près de la rivière, Il aperçoit les deux enfants d'Akiepi occupés à boucaner
du poisson. Ces jeunes gens, complices de leur père, reçoivent à l'improviste
une grêle de flèches sous lesquelles ils succombent.
Macouipi et ses soldats emportent au loin les cadavres et se cachent près du
boucan en attendant le retour d'Akiepi. Celui-ci ne revenant pas, Macouipi descend
le long de la rivière Apaqua. Bientôt Il aperçoit son ennemi dans une petite
pirogue et lui décoche une flèche, mais celui-ci plonge à la rivière et prend
la fuite.
Macouipi, qui s'est jeté à l'eau, veut lui donner un coup de sabre en nageant,
mais l'instrument lui tombe des mains. Akiepi se retourne, s'élance sur son
adversaire qu'il prend par la gorge. Une lutte terrible s'engage au milieu de
la rivière et les deux combattants vont s'entraîner au fond de l'eau, lorsqu'une
flèche lancée de la rive frappe Akiepi dans le cou.
Les femmes et les enfants de ce malheureux, qui a payé trop cher ses larcins,
sont venus se réfugier à l'habitation d'Araqua.
20 novembre. — Le matin je rencontre une lacune dans l'immense forêt qui recouvre les quatre cinquièmes de l'Amérique du Sud. Il y a deux zones bien distinctes dans cette partie du continent américain: ici le grand bois sans horizon, là-bas des prairies sans un arbre, sans un arbuste où la vue se perd sur une masse de graminées.
La richesse de 1'Uruguay, de la République Argentine et de la Patagonie est dans les prairies qui alimentent des milliers de boeufs et de chevaux; l'avenir du Venezuela, de la Guyane et du Brésil n'est pas dans l'exploitation de l'or et des pierres précieuses, mais dans celle des forêts. Quand la soif de l'or sera apaisée dans la Guyane française, on s'occupera des bois précieux et de construction qui tombent de vétusté sur les bords du Maroni, de l'Oyapock et de tous les affluents de l'Amazone.
Cette savane, qui a plusieurs kilomètres d'étendue, me
rappelle l'aspect d'un champ de blé mur. L'herbe est si sèche prend feu à la
moindre étincelle.
En la traversant avec Apatou, nous faisons lever quelques serpents et tuons
un cariacou, c'est-à-dire une petite biche qui broutait l'herbe. Nous
relevons dans le lointain de jolies montagnes qui paraissent é1evees de cent
cinquante à deux cents mètres au-dessus de la rivière. Mon compagnon me fait
remarquer que l'une d'elles, avec son sommet arrondi recouvert d'arbres touffus
au feuillage sombre, à l'aspect d'une tête de nègre.
Le courant est faible et l'eau n'a pas plus d'un mètre de profondeur, bien que
la rivière n'ait pas deux cents mètres de largeur. Cette navigation qui dure
dix heures par jour est des plus monotones; nous n'avons d'autre distraction
que de flécher de petites tortues, qui sont très communes dans cette rivière,
tandis que nous n'en avons pas trouve une seule dans le Yary.
D'autre part, nous, rencontrons beaucoup de bancs de sable, où mes hommes ne
manquent jamais de s'arrêter.
On distingue les traces de pattes terminées par cinq
doigts effiles, et au milieu de la piste une traînée produite par le frottement
d'une queue. ça et la on voit de petits monticules semblables à ceux que produisent
les taupes dans nos prairies. Nous devons trouver des oeufs d'iguane dans ces
parages. Un Indien, à genoux près d'un monticule, remue le sable avec un bâton.
Rencontrant une galerie qui se dirige horizontalement, il la poursuit jusqu'à
ce qu'il arrive sur les oeufs, et il en recueille une vingtaine. C'est au commencement
de la saison sèche, au moment où les eaux se retirent, que commence la ponte.
A cette époque ils renferment quelquefois de petits iguanes,mais ce n'est pas
une raison pour les rejeter; l'Indien trouve l'embryon plus délicat que
le jaune de l'oeuf.
J'ai une folle passion pour les oeufs d'iguane boucanes; je les trouve beaucoup
plus savoureux que les oeufs de poule.
Le 22, nous prenons un jour de repos dans une habitation appelée yaripo, où j'enrôle des hommes pour nous guider pendant quelques jours.
Entre autres occupations je répare mon unique pantalon,
qui présente de sérieuses avaries. Manquant de fil, un Indien m'en fait séance
tenante. Voici sa manière procéder: Deux Indiens coupent chacun une longue feuille.
Ils les entrecroisent et se mettent à faire un mouvement de va-et-vient en tirant
avec force chacun de leur cote, et bientôt la matière charnue ces feuilles a
été enlevée et il ne reste plus que les fibres textiles. J'ai du fil.
Pour faire la ficelle, l'Indien met trois fils de longueur
égale sur son genou, et, les fixant solidement avec la main gauche, Il les enroule
en glissant la main sur la cuisse, derrière en avant, puis d'avant en arrière.
Avec une seule de ces manoeuvres, il opère le cordelage sur une longueur de
douze centimètres.
En répétant ces mouvements, il arrive à faire des cordes fixes ayant plus de
trente mètres de longueur, qu'il enroule en pelotes.
La fabrication des fils de coton destines à la confection
des hamacs est réservée aux femmes.
Leurs bobines sont composées d'un bâtonnet dur passé dans une couronne sculptée
dans un os de tapir ; elles portent à l'extrémité un crochet taillé dans le
bois.
J'assiste à une fête appelée toulé: Vers quatre heures du soir, vingt hommes alignés sur un seul rang débouchent sur la place du village.
Ils n'ont plus leurs grands chapeaux, mais de petites couronnes en plumes (pomaris), et ils portent en haut de chaque bras, en guise d'épaulettes, deux queues d'aras rouges (kinoro ouatiki), d'un bel effet.
Le chef de bande, qui est à droite, tient à la bouche une grosse flûte de bambou d'où il tire des sons graves et tristes en se balançant sur la jambe droite. Les autres, portant chacun une flûte, également de bambou, mais plus petite, répondent sur un ton plus élevé. Arrivés au milieu du village, ils forment un cercle et se mettent à tourner en jouant toujours le même air et en frappant légèrement le sol en cadence avec le pied droit.
C'est une roue vivante qui reste en mouvement toute la
nuit, en sifflant, et m'agace les nerfs à ne pouvoir fermer l’œil. L'axe de
cette machine diabolique est forme par un grand pot de cachiri ou les danseurs
assouvissent leur soif.
Les danseurs, presque tous étrangers à la tribu, se proposant de récompenser
les femmes qui leur ont verse des flots de cachiri pendant toute la nuit, montrent,
l'un un catouri (hotte), l'autre un manaré (tamis),un troisième
une cuiller (anicato) pour remuer la bouillie. Les femmes brûlent d'envie
de posséder ces objets qui sont tout neufs et artistement travaillés.
Le possesseur du catouri s'assied au milieu de
la place avec un bâton qu'il cache derrière son dos. Une jeune fille s'approche
pour saisir l'objet, mais elle reçoit un grand coup sur les doigts, aux rires
et applaudissements de l'assistance.
Une seconde, plus habile, se dérobe aux coups et enlève le beau catouri.
Cette distribution de cadeaux et de coups de bâton dure plus d'une heure.
Les femmes répondent à la générosité des convives en apportant trois grandes
jarres remplies d'un Cachiri qui est encore meilleur que celui de la veille;
on boit tant et plus.
Disons en passant que la mort des femmes n'est suivie d'aucune espèce de fête.
Docteur J. CREVAUX.
(La suite à la prochaine livraison.).
DE CAYENNE AUX ANDES,
PAR M. JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE FRANCAISE.
1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INDDITS.
PREMIERE PARTIE. — EXPLORATION DE L'OYAPOCK ET DU PAROU.
XXIV
Manière de grimper: — La Vie future. — But de la crémation. — Les piays ne vont pas au ciel. — Manière d'indiquer les distances. — L'art .de compter chez les Roucouyennes. — La consultation d'un piay. — Les vétérinaires sont inutiles, puisque les bêtes ont leurs médecins. — Fumigation au tabac, exorcisme, ventouses, diète, honoraires conditionnels. — Un cas désespéré. — Sortilège. — Les Apalaï. — Le voyageur oblige de supplicier ceux qui voient un blanc pour la première fois. — Bonsoir. — L'oiseau fantôme. — On s'asphyxie pour éviter-les moustiques. — Promenade nocturne. — Une recrutement dune escorte. — Peintures sur bois.— Crânes de singes servant a faire des cuillers. — Manière simple d'éviter une bande de pécaris. — Un vieux récalcitrant oblige d'être aimable. — Un nouveau caractère qui distingue l'Indien des autres races. — Je deviens imprimeur. — Voleur intimidé.
23 novembre (douzième jour de marche en descendant Parou).
— Nous rencontrons un grand affluent de gauche appelé Citaré, dont le débit
est le tiers du Parou. Pendant que je fais une reconnaissance à l’embouchure,
Apatou tue un couati, qui reste suspendu par la queue; un Indien s'empresse
d'aller le chercher.
Pour cela, il se passe les pieds dans un lien fait avec des feuilles de palmier
et monte avec la vélocité d'un macaque. Arrivé aux branches gage ses jambes
et se promène à son aise; puis, après avoir décroché le gibier, il se met à
descendre, toujours avec son lieu qui l'empêche de glisser.
Le 23, nous passons à cote d'un village abandonné où
un piay a été enterré.
« Honis lipoc oua (ne parlez pas) », nous dit Yelemeu, «
Iteke piay tale yépé (le piay Iteke est là). »
Il se met à pagayer si doucement qu'on n'entend pas le
clapotement de l'eau; c'est à peine s'il respire pour éviter de faire du bruit.
Nous avons un moment de frayeur ; croyant qu'il y a un grand danger. Ce n'est
que deux heures après, et lorsque nous sommes bien loin, que le patron me donne
des explications .
Si nous avions en la témérité de descendre à terre à cet endroit, nous aurions
rencontre le caicuipiay (le tigre piay), qui garde son frère.
Après la mort, l'esprit des bons et des mauvais s'éleve vers le ciel, qu'ils
appellent Kapoun. Les premiers vont haut, très haut, bien au-dessus des
nuages. ils trouvent la de jolies femmes ; on dans toutes les nuits, on boit
du cachiri, on chasse, et on ne travaille pas à l'abatis.
Les méchants s'arrêtent au-dessous des nuages, où ils courent toujours,
- sans espoir d'arriver plus haut.
Si l’on brule le corps aussitôt après la mort, c'est
pour que l'ame s'envole avec la fumée.
Les piays, qui ne sont jamais livrés à la crémation, gardent l'ame attachée
au corps. L'esprit et la matière restent dans la fosse, oh ils sont visites
par les piays, et par des bêtes et des hommes qui viennent les consulter.
24 novembre. — Nous dormons à l'habitation de Puimro. C'est le dernier village des Roucouyennes; nous allons pénétrer dans une nouvelle tribu d' Indiens,les Apalaï.
Je rencontre un piay nomme Apipa, qui à la réputation
d'avoir beaucoup voyagé ; je profite de cette occasion pour lui demander
des renseignements sur la route qui nous reste à faire. Voici textuellement
les indications qu'il me fournit.
Il lève le bras droit et fait, un demi-cercle dirigé de l'est à l'ouest, et,
se frappant la poitrine, il dit : Mou-mou.... itouta tinickse (dans le
bois dormir).
Répétant le même geste, il ajoute : moëneu (demain), mou-mou.... Apalai
patipo tinickse, (dormir habitation Apalaï); moëneu.... Beymao tinickse,
etc., etc.
Prenant des notes au fur et à de ce récit qui dure une heure, sans interruption,
je vois que nous sommes bien éloignés du terme de notre voyage, puisque mon
collègue s'est frappé plus de quarante fois la poitrine de la main gauche.
Les Roucouyennes ne savent exprimer que trois nombres : aouini, un ;
sakene, deux; hélé-uaï, trois; après, ils montrent les doigts
des mains et les orteils, et, lorsque le chiffre dépasse vingt, ils disent colepsi,
qui est un diminutif de beaucoup, ou colé,colé, beaucoup, beaucoup.
Au coucher du soleil, mon collègue se prépare à donner une consultation.
On établit, dans un coin du carbet, une petite cage en
feuilles de palmier, où le piay pénètre en rampant.
Le malade qui reste en dehors s'assied sur un cololo, au milieu des spectateurs.
Apres un moment de silence, nous entendons un bruit de
frottement; c'est le piay qui frappe avec les mains les feuilles de ouapou.
Ensuite, soufflant avec force, il fait : hi..., en imitant le cri du tigre;
après, il siffle comme le macaque, chante comme le hocco, la maraye et toutes
les bêtes du grand bois.
C'est une invocation à tons ses collègues les piays animaux : caicouchi piay
(sorcier tigre), mecou piay(sorcier macaque), matapi piay (sorcier
serpent) ,achitaü piay (espèce de pacou), qui doivent l'aider de leurs
conseils ; ce sont eux qui lui indiqueront des remèdes pour guérir son malade.
Pour que ceux-ci viennent sans crainte, on a eu soin d'éteindre tous les feux
du village. Le silence est profond; c'est le moment solennel de la consultation
entre le sorcier des hommes et les sorciers des bêtes.
Apres, on fait un peu de musique, le piay chante :Carvilanayo!
Carvilanayo! et s'accompagne en frappant les pieds sur une planchette.
On fait alors entrer le malade, qui tremble de frayeur. Le piay fume la fumée
d'une cigarette qu'on lui passe tout allumée et la projette avec force en soufflant
comme un cachalot sur la partie malade.
Après, il fait ventouse et souffle avec violence pour chasser le mal qu'il vient
d'aspirer.
Cette scène diabolique dure plus de deux heures ; elle se termine par une prescription que l'on peut résumer en un mot : diète, diète. il ne mangera pas de pakiri, de hocco, de gros poisson, ne boira pas de cachiri, etc.
Mon collègue recevra en payement un hamac, mais a une condition, c'est que le malade se rétablira complètement.
Nous assistons à une autre consultation qui n'est pas
moins intéressante : il s'agit d'un malade qui est dans une situation absolument
désespérée.
Le piay fait les mêmes gestes, les mêmes invocations, mais i1 termine la scène
d'une manière dramatique.
Il se fait passer un petit arc et une flèche minuscule, puis, sortant de sa
cabane d'un air triomphant, il montre le dard tout ensanglante.
Soueï yépé! couchynatati! » (Je l'ai fléché, succombera rapidement.)Ces
gens simples croient que tous leurs maux viennent de sortilèges, c'est-à-dire
de piays qui ont été jetés par quelque sorcier. Quand on ne petit enlever la
maladie, on se venge en envoyant un mauvais sort à une personne de la tribu
voisine.
26 novembre. — Nous arrivons à deux heures à un petit village apalaï, commandé par un jeune tamouchy appelé Tioui. Ces Indiens ont les mêmes caractère physiques que les Roucouyennes, et leur langue est si peu différente, que nous comprenons un grand nombre de mots.
Ils ont un usage assez singulier que nous n'avons pas
trouvé chez les Ouayanas..Quelques instants après mon arrivée, on m'apporte
un treillis en feuilles de palmier où sont fixées par le milieu du corps de
grosses fourmis noires aux piques douloureuses. Tous les gens de la tribu, sans
distinction de sexe ni d'Age, se présentent à moi pou se faire piquer sur la
figure, les reins, les cuisses … etc.
Quelquefois je suis indulgent dans l'exécution ; on me dit : « Encore ! encore
! » Tous les gens ne sont satisfaits que lorsque la peau est parsemée de petites
élevures semblables à celles qu'on produira il en donnant le fouet avec des
orties.
Vers huit heures, le tamouchy nous dit : « Tinikné yepé, » c'est-à-dire : « Allons nous coucher. » On nous présente à chacun un flambeau (ouéyou), compose simplement d'une longue attelle en bois résineux. On l'allume, et, chacun portant son hamac, nous nous engageons dans le petit sentier qui traverse l'abatis.
Arrives dans la forêt, nous entendons le chant d'un oiseau qui donne distinctement les cinq notes suivantes:
Une panique s'empare de mon escorte, les flambeaux s'éteignent, hommes et femmes se sauvent dans l'obscurité de la nuit. Nous sommes obligés de retourner au village, et ce n'est que longtemps après que nous allons nous coucher.
Quel est donc l'oiseau qui fait tant de peur aux Indiens de la Guyane? On connaît son chant, mais personne ne l'a jamais vu. Il y a lieu de croire que c'est une espèce de chouette. I1 m'est impossible de m'endormir: la chaleur m'étouffe; je me décide à sortir. Mais c'est une opération très compliquée. D'abord il me faut rallumer mon flambeau, si je ne veux pas m'exposer, après m'être avancé le corps courbe sous les hamacs, à me casser les jambes en marchant sur les traverses clairsemées qui forment le plancher. J'ai beaucoup de peine descendre par une petite échelle composée de deux perches, sur lesquelles on à fixe quelques barres transversales au moyen de lianes.
 |
Mon flambeau s'éteint au moment où j'arrive au bas de
l'escalier, et il me faut faire le tour de la hutte, la recherche de la porte,
qui n'est autre qu'un treillis en feuilles de palmier qu'on soulève doucement
pour le reformer aussitôt, afin d'empêcher les moustiques de pénétrer.
Mais quel bonheur de se trouver en dehors de cet étouffoir ! Ma poitrine se
gonfle, c'est avec volupté que mes poumons aspirent l’air frais de la nuit.
Que vois-je au clair de la lune sur des, bâtons disposés en croix comme un gibet ? C'est un mannequin empaillé de maïs représentant un guerrier prêt à décocher une flèche.
Le lendemain, ayant demande ce que signifiait cette image,
on me répondit : « Yolock »
J'achète ce diable inoffensif au prix d'un hamac, avec l'intention de le
rapporter en France.
Nous ne tarderons pas à gagner les grandes chutes, il
nous faut des guides à tout prix. Au moment où j'engage Tioui à m'accompagner
chez les Calayouas, je vois arriver un jeune Indien nomme Olori (Iguane qui
sait quelques mots de portugais).
Comme il me dit qu'il a visité les blancs, je tache, de l'engager à nous accompagner.
Manquant d'objets d'échange, je lui offre mon paletot et de petites pièces d'or
pour faire des colliers et des pendants d'oreilles.
On réfléchit la nuit, et le lendemain mes hôtes acceptent
mes présents : c'est qu'ils sont décidés à faire le grand voyage. Je paye aussitôt,
seulement je demande à garder mon paletot jusqu'en bas de la rivière. Mes hôtes
n'y consentent qu'à la condition que je leur donnerai d'avance les quelques
boutons qui restent à mon vêtement.
Nous nous mettons en route avec un renfort de trois. Olori s'embarque dans ma
légère pirogue avec Apatou.
Nous rencontrons des habitations presque tous les jours;
j'ai l'occasion de causer avec les indigènes et de recueillir des objets ethnographiques.
Entre autres choses, j'achète des peintures sur bois analogues à celle que j'ai
trouvée chez Macouipi au premier voyage, et des cuillers qui ne manquent pas
d'originalité. Elles sont faites d'un occiput de couata qui est adapté avec
une ficelle à un manche en .bois. Ces instruments sont si commodes, que nous
les employons pour notre usage personnel.
29 novembre. Une demi-heure après le départ, nous courons à terre à la poursuite d'une bande de pécaris qui vient de traverser la rivière.
Olori, voulant les faire retourner, imite l'aboiement du chien. La troupe fait volte-face et s'avance sur nous. Apatou et moi nous nous empressons de grimper sur des arbres, Mais 1'Indien reste à terre avec un sang-froid qui m'étonne. il se place derrière un petit arbre recourbe jusqu'au sol, et, couvert par cet arceau qu'il maintient du pied droit, il décoche ses flèches aux premiers arrivants. La bande ne tarde pas à reprendre sa course, mais se ravise et revient une seconde fois : l'Indien fait de nouvelles victimes.
Vers neuf heures, nous apercevons une petite savane sur la rive droite; cette lacune dans la forêt n'a pas d'autre raison que la pauvreté du sol, qui est incapable d'alimenter des arbres. Un peu en aval, nous rencontrons un petit saut formé par des roches schisteuses, entremêlées de quelques roches granitiques ; sur les rives, on remarque de petites montagnes mamelonnées recouvertes d'une végétation puissante.
Le 1er décembre (vingtième jour en descendant), nous voyons une crique assez importante appelee Tapou-Kourou, qui signifie textuellement rivière des roches (tapou, roches ; kourou, rivière). Deux petites montagnes s'élèvent près de son embouchure.
Nous arrivons dans l'après-midi à Malaripo, petit village
situé au milieu des bois, à deux kilomètres de la rive droite.
J'y passe deux jours pour faire des provisions de cassave. Malari est un gredin
qui nous refuse des vivres sous prétexte que son manioc n'est pas mûr, et cherche
à détourner mon équipage. L'ayant surpris pendant la nuit à faire une orgie
de cachiri et à gaspiller la cassave que ses femmes m'ont préparée dans la journée,
je le fais saisir et le force à rester tout le temps assis au pied de mon hamac.
Le vieux rusé, se sentant pris, déploie une grande activité, et en l'espace
de deux jours j'ai soixante-dix galettes de cassave, que je fais sécher au soleil
et emballer dans des catouris bien formés.
Je profile de mes loisirs pour faire une collection de
dessins que les Apalaï crayonnent eux-mêmes sur mon album. En les regardant
à l'oeuvre, je remarque que les Indiens, comme les Roucouyennes et les Oyampys,
ont les plis de la peau beaucoup plus saillants que chez les races blanche et
noire. Les plis du genou ressemblent à une peau d'orange.
Je voudrais représenter exactement ces détails, qui m'intéressent au point de
vue anthropologique, mais je trouve la difficulté insurmontable. Il me vient
toutefois une idée : je fais barbouiller un Indien avec du roucou des pieds
la tête, et, au moyen d'un papier mince que j'applique avec la main, j'obtiens
tous les détails de structure. Le roucou agit comme de l'encre d'imprimerie.
Avec un peu d'exercice je recueille les détails anatomiques de toutes les parties
du corps, et particulièrement des pieds, des mains, du genou et des coudes.
Il est à noter que la peau de l'enfant à la mamelle présente des plis aussi
accentués que ceux d'un banc à l'age adulte.
La peau d'un jeune homme vue à l'oeil nu semble grossie trois fois à la loupe.
Je remarque un fait bien étrange. Toutes les femmes du village, qui sont au nombre de sept ou huit, toussent et crachent d'une manière abominable comme des phtisiques, tandis que les hommes sont bien portants.
En retournant au dégrad, Stuart dit qu'on à volé son
sabre d'abatis. Le voleur ne saurait être que le jeune Olori, qui a passé quelque
temps chez les blancs.
Sachant qu'un acte de violence de ma part provoquerait la désertion des Indiens,
je me contente de faire venir Olori et de le regarder en face jusqu'à lui faire
baisser les yeux. Après cette inspection silencieuse, je le charge lui-même
de faire des recherches sur l'objet volé. Dix minutes après, il revient et dit
avoir trouve le sabre dans la rivière, où il serait tombé par accident.
Tout va bien, en route !
XXV
Salsepareille. — harem. — Mariages consanguins. — Mademoiselle Soleil. — La cigarette de l’hospitalité. Myriade— Mapirené. — Je renforce mon escorte. – J'empêche Apatou de prendre un bain. — La belle chute de Toulé. — Déveine. —Roches qui ressemblent à de la houille. —Dans un abîme le dos tourné . — La Confiance étouffe la peur. — Apalaï tirant à la cible. — Gens maladroit voués au célibat. — Toujours des chutes; — la rivière s'engouffre. — Descente vertigineuse. — Indien piqué par une raie.
Le 5 décembre, nous passons devant un ancien village jadis occupe par des Roucouyennes qui ramassaient de la salsepareille pour l’échanger contre des couteaux et des colliers que leur fournissaient les Apalaï. Ces derniers transportaient cette plante médicinale dans le bas de la rivière pour la vendre aux Calayouas. Les collines qui longent la rive droite sont riches en salsepareille.
Nous arrivons de bonne heure à une habitation également
située dans la forêt et qui est occupée par un gros Indien appelé Azaouri. Cet
homme parait d'une force colossale.
Dans l'habitation je remarque quatre jolies femmes, qui me donnent chacune une
mèche de leurs jolis cheveux noire pour ma collection anthropologique.
Leur ayant demandé ou sont leurs maris, elles montrent toutes du doigt le tamouchy Azaouri. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que la plus belle de toutes, appelée Popoula (soleil), qualifie Azaouri tantôt de papa, tantôt d'okiri. Les unions entre parents au premier degré ne sont pas très rares chez tous les Indiens des Guyanes. Mes compagnons de voyage ont mis sur leur canot un gros catouri d'encens, qu'ils ont l'intention de porter jusqu'en bas du fleuve pour l'échanger contre un couteau. Je l'achète séance tenante, non pas avec l'intention de le rapporter, mais pour m'en servir en voyage. Cette matière est très précieuse: on l'emploie pour allumer le feu et s'éclairer. Je lui trouve une autre application: en me couchant je me paye le luxe de me faire enfumer avec cette résine, partout ailleurs exclusivement destinée à l'adoration du Dieu des Manes.
Les Apalaï comme les Roucouyennes désignent l'encens sous le nom : d'aroua. Cette substance se trouve en quantité généralement considérable au pied des arbres. Apatou a trouvé dans la crique Maroni un morceau d'encens si gros, que deux hommes vigoureux ont eu de la peine à le charger sur leur canot. L'arbre à encens (Icica guianensis Aubl.) est quelquefois employé pour faire des pirogues; mais, s'il est facile à travailler, il n'est que d'une qualité médiocre.
Les nègres marrons de la Guyane appellent l'encens moni (argent), sans doute parce qu'il leur sert pour acheter auprès des blancs les objets dont ils ont besoin.
6 décembre. Azaouri nous accompagne avec sa jeune fille, qu'il surveille avec un double intérêt.
A midi, nous arrivons un dégrad qui conduit à l'habitation
d'un vieux chef nommé Eritiman, situé à deux kilomètres dans le bois.
Je voudrais bien éviter cette excursion ; car il fait une chaleur torride, mais
il faut m'exécuter devant l'autorité de la belle Popoula qui désire faire escale.
Les Apalaï ont une manière particulière de complimenter
leurs hôtes. Chacun sépare autant de cigarettes qu'il arrive d'étrangers et
vient les offrir après les avoir allumées. Je suis obligé de tirer quelques
bouffées à chacune des longues cigarettes qui me sont successivement présentées.
Elles sont composées d'une feuille de taouari entourant une feuille de
tabac qui est de bonne odeur bien qu'il n'ait subi aucune préparation.
Cette pratique pourrait avoir, de graves inconvénients au point de vue de la
transmission de certaines maladies.
En route à deux heures : nous voyons la rivière parsemée de nombreuses îles qui indiquent l'approche des chutes. Nous passons la nuit sur de belles roches où nous sommes tourmentés par des nuées de moustiques qui me font changer vingt fois de place pendant la nuit.
7 décembre. — La rivière se divise en un grand nombre de branches : nous nous engageons à gauche, à travers des îles et des roches sans nombre qui forment un dédale, où il est très malaisé de tracer la route à la boussole.
Nous rencontrons des barrages si difficiles à franchir,
que maintes fois nous sommes obliges de rétrograder et de faire des détours
considérables.
En comprenant les Iles, la largeur totale du cours d'eau ne mesure pas moins
de trois kilomètres.
Enfin, vers deux heures,nous arrivons au dégrad d'un petit village qui se trouve à deux kilomètres de la rive. Il est commandé par le tamouchy Mapireme, dont le nom désigne un tigre noir très redouté qui n'existe pour être que dans l'imagination fantastique des indigènes.
Pendant que mon hôte fait sa toilette pour me recevoir, je m'assieds dans une hutte ou je trouve une hache de pierre que je m'empresse d'échanger contre une aiguille.
Tiuirit me dit ne pas connaître les sauts du Parou. Il sera donc urgent d'engager quelques Indiens de ce village qui doivent avoir l’habitude de les traverser en allant flécher les pacous. Mapire me consent à m'accompagner avec deux Canots au prix d'un fusil et de quelques pièces d'or dont il fait moins de cas que d'un collier en verroterie.
Les Apalaï considèrent le passage des chutes comme une
entreprise très périlleuse; aussi les femmes et les enfants viennent-ils nous
accompagner jusqu'au dégrad. Au moment de la séparation, je dote un peu d'entrain
à mon escorte en brûlant quelques cartouches.
Vers midi, nous quittons le labyrinthe des îles pour atteindre la grande rivière,
qui ne tarde pas à se diviser de nouveau en une myriade d'îles entre lesquelles
l'eau tombe en formant des rapides et de petites cascades.
Les canots abandonnés se briseraient infailliblement sur les roches, si on ne
les retenait avec une corde fixée à l'arrière. Le vigoureux Apatou ne peut résister
à la force du courant, et, ne voulant pas lâcher prise, il est sur le point
de tomber dans la chute, lorsque j'accours et le retiens par la jambe.
Stuart et Hopou, moins prudents, lancent leur pirogue au milieu des chutes avec
une audace effrayante.
Ils sont d'autant plus hardis qu'ils connaissent moins le danger.
9 décembre. — Nous arrivons à une chute majestueuse,
disposée en longs gradins, que les indigènes appellent Toulé. Elle mesure
dix mètres de hauteur sur une longueur de trois cent cinquante mètres. On est
obligé de décharger les bagages pour les transportera une distance de quatre
cents mètres et on hale les canots sur des roches.
Etant obligé d'employer tout mon équipage au transport de chaque
embarcation, Il nous faut quatre heures pour franchir l'obstacle.
Le transbordement ne se fait pas sans accidents: je casse mon meilleur Chronomètre,
des poteries recouvertes de dessins, et deux de mes hommes se blessent en tombant
sur les roches.
Au pied de la chute on rembarque dans les pirogues, et nous filons avec une rapidité vertigineuse entre des roches noires luisantes, qui ressemblent à des amas de charbons de terre. C'est de l’hématite, c’est-à-dire un minerai de fer presque pur que nous avons déjà trouvé dans le Yary.
Ensuite la rivière se bifurque en mille branches, et grâce à nos guides nous trouvons une habitation dans une île où nous passons la nuit.
Le 10, nous n'avons pas un moment de repos; partout des
roches granitiques et schisteuses qui forment des chutes de cinquante centimètres
à un mètre très dangereuses à franchir.
Ma petite pirogue bondit dans l'eau comme un cheval fougueux, et nous passons
comme l'éclair devant les roches, que nous effleurons sans jamais les heurter.
Olori, toujours prêt à se sauver à la nage, se lève chaque instant de son banc.
Assieds-toi! lui crie le patron.
Tout à coup les lames sont si fortes que l'eau embarque de tous côtés. Cocouita!
cocouita! » (pagaye ! Pagaye !) dit Apatou, et nous arrivons sans accident
au pied de la chute.
Quand le passage est plus difficile, Apatou fait virer le canot, qui marche aussi bien de l'arrière que de l'avant, et, donnant un vigoureux coup de pagaye, nous lance à travers les roches que nous passons raser.
Les évolutions sont si rapides, que je n'ai pas le temps de me retourner; je franchis l'obstacle en lui tournant le dos avec mon cahier sur les genoux et la boussole à la main. J'ai une telle confiance dans mon patron de canot, que je ne vois aucun danger dans cette descente vertigineuse.
Nous passons la nuit à l'habitation d'Eralé, où j'assiste
à un exercice de cible par des jeunes gens qui ont subi dernièrement le supplice
du maraké.
Il faut que, ayant le dos tourné, ils envoient des boulettes de cassave
vers un morceau de bois sur lequel on a tracé une circonférence. Ceux qui n'atteignent
pas le but trois fois de suite sont soumis à de nouvelles piqûres des fourmis
et des guêpes.
Les Apalaï, comme les Roucouyennes, ne doivent pas se marier sans avoir subi
ces épreuves, autrement ils seraient exposés à n'engendrer que des enfants chétifs
et malingres.
Le 11, dans la matinée, nous perdons la pirogue chargée de cassave. Apprenant qu'il y à un village à une faible distance en aval, je pars en avant pour faire préparer des vivres.
Le soir, nous avons de la peine à manger du poisson sans matière féculente, mais Apatou se souvient qu'il à mis à fermenter des morceaux de cassave pour faire du cachiri. Cette affreuse pâte, qui est recouverte de moisissures, est bouillie sur le feu et savourée avec délices.
Le 12, nous franchissons les sauts Tapiocaoua et
Taoka. Au dernier, la rivière rétrécie s'élargit subitement en formant
un entonnoir.
Pendant tout le reste du jour, ce ne sont que des chutes, rien que des chutes,
ou nous cascadons sans un instant de repos, et, pour comble d'ennui, le soir
pas de cassave !
Le 13 décembre, au départ; nous avons une surprise désagréable.
La rivière s'engouffre dans des canaux n'ayant pas plus de deux mètres de largeur,
et elle s'y précipite avec une violence qui fait peur.
Il n'y a pas à songer à s'engager dans ce défile, où notre canot se briserait
contre les grandes roches noires de coup des à jour qui constituent un riche
minerai de fer.
Nous devons haler le canot par terre sur un terrain tellement accidenté, qu'il nous faut deux heures pour parcourir une distance de vingt mètres à l'aide de traverses qu'on établit sur son parcours.
Apatou, las de cette manoeuvre, prend le parti de descendre
dans le courant.
Nous embarquons avec les bagages et nous partons.
Caïqué! Caïque [13]
! dit le patron, et nous effleurons les obstacles sans jamais les heurter.
En un quart d'heure nous parcourons une distance de quatre kilomètres.
Cinq minutes d'arrêt seulement pour souffler, et puis bravement en route! A
onze heures et demie, la rivière s'élargit, mais elle est si peu profonde, que
nous sommes obligés de descendre et de nous mettre à pied pour pousser le canot
la main.
Nous n'avons pas fait cent mètres que notre compagnon
Olori jette un cri perçant. Que lui arrivé ? On s'empresse autour de lui. Il
vient d'être piqué par une raie sur laquelle il à mis le pied.
Toute la jambe s'engourdit, et Olori éprouve par intervalle des crampes excessivement
douloureuses.
L'ayant couché dans le canot, nous continuons la marche à pied.
Nous nous hâtons de sortir de ce mauvais pas, car la
privation de cassave nous est très pénible. Bien que nous ayons du poisson à
discrétion, il semble à en croire noire estomac, que nous mourons de faim.
Apatou me recommande, pour éviter les raies, de suivre en marchant dans le lit
du canot, l'agitation de l'eau les faisant fuir à droite et à gauche.
La raie se tient sur le fond, où elle est souvent couverte de sable ou de limon.
Quand elle se sauve, elle brouille l'eau, de sorte qu'on est quelques instants
avant de l'apercevoir. Apres son départ, la place du gîte est indiquée par ne
dépression ovalaire.
Apatou tue d’un coup de bâton une grosse raie, qui, renversée sur le dos, met
bas une vingtaine de petits ayant cinq à six centimètres de longueur.
Les Indiens ne redoutent pas les grosses raies, parce qua leurs dards émoussés
sont généralement incapables de piquer. Les crochets de ce poisson sont souvent
employés pour faire des pointes de flèches destinées à la chasse du couata.
N'ayant rien à manger, nous ne pouvons nous arrêter pour étudier ces poissons plus à l'aise. Nous marchons, marchons toujours pour atteindre une belle montagne appelée Couyapoko, que nous apercevons depuis le matin.
XXVI
Naufrage d'un canot. — La rivière s'engouffre entre les roches. — En reconnaissance. — Vertigo. — Chute dans un précipice. — Canal pittoresque. — Une victime. — Deux canots perdus dans un jour. — Construction de pirogues en écorce. — Sécheresse extrême; pas assez d'eau pour une pirogue. — La dernière chute du Parou. — Signification du mot Panama.
Enfin, à trois heures, nous arrivons à un petit village
commandé par le tamouchy Apéré.
Le lendemain, je fais faire de la cassave et j'enrôle des hommes pour nous conduire
jusque dans le bas de la rivière; mais nous ne pouvons nous mettre en route,
car les autres canots n'arrivent pas.
Le 16, nous allions partir au-devant d'eux, lorsque nous
entendons un coup de fusil. C'est Hopou et Stuart qui signalent leur arrivée.
Ce retard à en pour cause la naufrage du grand canot. Tous les bagages sont
allés au fond de l'eau, et l'embarcation à moitie brisée à du subir de grandes
réparations pour pouvoir continuer.
La navigation du 17 ne présente aucune difficulté, mais le lendemain les chutes recommencent et nous n'avançons que très lentement.
Le 20, dans la matinée, nous passons devant une montagne
taillée à pic appelée Maracanaï, qui est tout à fait semblable à celles
que nous avons trouvées dans le Yary vers la même hauteur. C'est un grés blanc
(pierre de sable) taillé à pie sur une hauteur prodigieuse.
Le courant nous emporte rapidement en passant devant cette montagne, mais nous
ne tardons pas être arrêtés par de grandes roches schisteuses, aux formes bizarres,
derrière lesquelles on aperçoit une montagne déchiquetée appelée Taouaracapa.
Voila que subitement l'eau vient à disparaître au milieu des roches :
Il faut arrêter: les canots et chercher un passage.
Etant parti en éclaireur avec Apatou et quelques Indiens
nous voyons que la rivière est absolument impraticable sur un parcours d'environ
quinze cents mètres.
Cette reconnaissance est des plus fatigantes j'ai bientôt la plante des pieds
déchirée en sautant pieds nus sur des roches granitiques. A un moment nous sommes
arrêtés par une grande fente au fond de laquelle l’eau tourbillonne en faisant
un bruit effroyable.
L'Indien qui m'accompagne franchit l'obstacle d'un pas léger. Pour ma part j'hésite un moment à sauter, étant, à vrai dire, un peu sujet au vertige. Comme je n'ai pas pris assez d’élan je glisse en arrivant sur la rive opposée et je vais disparaître dans l'abîme, quand j'ai la chance de saisir une pierre à laquelle je me cramponne avec la rage d'un noyé; l'Indien retourne sur ses pas et, me donnant la main, me retire du précipice, ou je n'aurais pas tardé à me laisser choir.
Je retourne à nos pirogues, clopin-clopant, et j'ai le temps de guérir mes contusions en attendant que l’équipage fasse un chemin dans la forêt pour passer les canots.
Le 21, après-midi, nos six pirogues traînées à force de bras sont au bas de la chute, nous embarquons les bagages et nous continuons à descendre.
Une demi-heure après, nous retrouvons un nouveau saut qui n'a pas moins de quatre mètres de hauteur; Il faut décharger les bagages, haler les canots par terre, ce qui demande deux heures d'un travail pénible sous une pluie torrentielle qui commence à tomber.
Bientôt la rivière se rétrécit et court en ligne droite vers le sud-est. Nous ne mettons pas une demi-heure pour parcourir une distance de plus de quatre kilomètres dans ce canal, dont les rives sont formées d'un grés blanc, qui s'élève à pic sur la rive gauche, tandis qu'a droite il est ronge par l'eau qui l’a déchiqueté enformant les dessins les plus bizarres.
Je ne puis résister au désir de m'arrêter un instant pour faire le croquis de ces roches, qui ont tantôt l'aspect d'une ruine, tantôt la forme d'un animal fantastique.
Le vieux Mapireme, qui a fait naufrage dans la journée, est tellement épuisé par cette navigation insensée, demande à ne pas aller plus loin. Nous l'abandonnons, après avoir répare son canot qui s'est fendu sur les roches.
Le 23, nous nous engageons à travers des collines que les indigènes désignent sous le nom de Moraïca et de Tacaïpou. La rivière, traversant des quartzites analogues à ceux qui constituent la Pancada du Yary, fait des bonds effrayants entre des murailles coupées à pic. On décharge tous les bagages et on descend les canots en les retenant depuis la rive avec de grandes lianes en guise de cordes. Une fois l'amarre casse et le canot se brise contre les roches.
Pour comble de disgrâce, pendant la nuit, un de nos canots mal attaché s'en va à la dérive, et il nous est impossible de le retrouver.
Apatou, portant les bagages à travers les roches situées
prés de la rive gauche, a vu sur une roche granitique une gravure ayant environ
soixante centimètres de longueur sur un demi centimètre de profondeur.
Ly semble moun (homme) ou Bien grenouille, dit mon patron, qui m'a informe trop
tard pour que j'aie pu prendre l'empreinte de cette image.
N'ayant plus que deux embarcations, dont l'une est avariée, nous sommes obliges de construire deux pirogues avec l’écorce du courbaril. Le tégument de cet arbre, qui est très épais, ne se détache qu'à la condition de faire du feu autour lorsqu'on a commencé à le soulever.
Le 24 décembre (trente huitième jour de canotage), la rivière, qui mesure sept à huit cents mètres de largeur,se dirige vers l'est presque en ligne droite sur une distance de plus de dix kilomètres. Il y à si peu d'eau que nous sommes non seulement obligés de marcher dans le lit, mais souvent de déplacer des roches pour permettre le passage de notre minuscule embarcation. Le lit de la rivière est parsemé de pierres qui paraissent cassées comme des paves destinés à l'empierrement d'une chaussée (roches schisteuses).
Après ce long trajet, nous arrivons à une chute à pic ayant vingt mètres d'élévation et qui ressemble aux chutes du Désespoir et de la Pancada dans le Yary.
Elle est désignée par les indigènes sous le nom de Panama, ce qui signifie papillon dans la langue des Apalaï et des Roucouyennes.
XXVII
Le crayon de nos pères. — Noël. — Nous approchons de la civilisation. — Il faut en être privé pour apprécier ses douceurs. —Chasse au tapir. — Accident terrible. — Résignation. — Pécaris.— Pont pittoresque à Xingu. — Dîner chez Lucullus. —A travers une rivière en fureur. — Arrivée au grand fleuve. — Pas de vapeurs ni in même de canots. — Nous trouvons une mauvaise barque. — Des gens qui ont peur de se noyer. — Deux grandes journées pour aller du Parou au Yary. — Je complète le tracé de cette rivière. — Retour au Para.
Pendant que mon équipage transporte les bagages et fait glisser les canots sur la rive droite, je fabrique un crayon avec ma dernière balle.
Sachant que Panama est la dernière chute du Parou, nous pagayons au plus vite pour tacher d'atteindre les avant-postes de la civilisation. Mais le soir arrivé et il faut suspendre mon hamac à un arbre fortement incliné sur la rivière.
Au milieu de la nuit, un grain nous surprend sans abri
et je ne puis fermer l'oeil.
Pendant les mouvements désordonnés que j'exécute, la corde de mon hamac casse
et je tombe à l'eau.
Je m'en tire comme je puis, mais il me faut attendre le jour, fort peu à mon
aise, en faisant sécher mes vêtements auprès du feu.
Tout cela se passe la nuit de Noël. On pense malgré soi,
avec envie, aux joies du « réveillon » dont on ne se soucierait peut-être
pas si l’on en pouvait prendre sa part.
Mais ici c'est vraiment trop peu de « réveillon » et, n'ayant rien à déjeuner,
nous nous embarquons au lever du soleil. Encore un petit coup de collier, et
nous atteindrons le terme du voyage. Nos yeux exercés scrutent les rives avec
une anxiété fébrile. A huit heures, nous apercevons une colonne de fumée qui
monte tout droit vers un ciel calme et sans nuage. Nos coeurs palpitent à l'approche
de la civilisation ...
Quel bonheur pour un voyageur d'arriver au but après avoir rempli et dépassé son programme sans le moindre accident, sans avoir perdu un seul homme! Si j'ai laissé beaucoup de bagages en route, au moins je rapporte mes instruments et mes cahiers de notes où j'ai pu relever tout mon itinéraire sans la moindre lacune.
Mes hommes pagayent vite, et nous atteignons bientôt le campement que nous avons aperçu. Je trouve la un nègre et un vieil Indien occupés à faire boucaner un pirarucu qu'ils ont pris la veille. Ces pauvres gens nous offrent une cigarette et nous convient à leur frugal déjeuner. Ils parlent le portugais; combien je suis heureux de m'entretenir avec des gens qui parlent un langage qui se rapporte au mien ! Je leur demande des nouvelles de l'Europe, du Brésil, mais ils ne savent rien des choses politiques; Ils se contentent de me montrer un papier qui enveloppait du sel. C'est une grande satisfaction de trouver cet aliment qui nous fait défaut depuis des mois,mais je suis bien plus heureux encore de parcourir un débris de journal.
Depuis plus de cent quarante jours je n'ai 1u que dans le livre de la nature; c'était superbe, ravissant, mais sauvage.... J'ai besoin de civilisation. Je lis et relis le papier imprimé qui m'apprend la mort d'un compatriote, Thiers, dont la gloire s'est étendue jusqu'aux dernières limites des pays explorés.
A neuf heures, en route … !
Au moment ou nous traversons la rivière pour éviter un banc de sable, nous apercevons
un tapir qui bondit comme un cheval fougueux à travers les eaux peu profondes
du Parou. Je le frappe à l'épaule d'un coup de fusil chargé de gros plomb, puisque
ma dernière balle me sert de crayon.
« Cocouita! cocouita! (pagaye !pagaye !) dit le patron Apatou aux deux
Indiens qui se trouvent devant moi.
Nous arrivons près de la rive au moment où le tapir,
sortant des eaux, fait un bond pour s'enfuir dans la forêt. Je m'étais dressé
et j'avais l'arme en joue depuis une seconde, lorsque Apatou me dit : Tire !...tire
!... »
Olori, qui était devant moi, pousse un cri de douleur: Natati!... natati
eou! » (Traduction : Je suis tué !). Mon pantalon est couvert de sang. Le
malheureux a la main gauche fracassée sur la poignée de sa pagaye qu'il tenait
devant le canon du fusil. Entraîné par la fureur de la chasse, il s'est levé
pour pagayer avec plus de force, et sa main s'est trouvée devant la bouche du
canon au moment où je faisais feu.
Pendant que les pêcheurs de piracucu achèvent
le tapir à coups de fusil, je m'occupe de mon blessé, qui est tombé en syncope
et que les Indiens croient mort.
Je décharge les bagages, que je confie au grand canot, et nous marchons vite
pour atteindre une habitation.
Le sang s'arrête par la compression et le blessé se ranime.
Je le tiens couché sur mes genoux pendant que je continue,
non sans peine, à relever la suite de mon cours d'eau.
Il nous faut quatre heures pour atteindre un petit village habité par quelques
noirs et des Indiens à moitié cilvilisés.
Olori est si faible qu'on est obligé de le porter dans un hamac suspendu à une perche. Plusieurs doigts sont mutilés; je voudrais les enlever séance tenante, mais il refuse toute opération. Je fais tailler une planchette sur laquelle j’immobilise l'avant-bras avec ma chemise dont je fais des bandes.
Olori ne m'en veut pas ; i1 me dit :
« Ce n'est pas ta faute; mon camarade m'avait dit : Prends garde au
fusil ! J'aurais du l’écouter. Je ne pourrai plus flécher, donne-moi le fusil
qui m'a fait mal, avec beaucoup de plomb et de la poudre. »
Le malheureux est d'autant plus résigné qu'il voit dans cet accident une punition
du vol qu'il avait commis ; Il a remarqué que la main frappée est précisément
celle avec laquelle il avait dérobé le sabre de Stuart.
Pendant que je finis un pansement, une bande de pécaris
traverse la rivière, tout le village s'embarque, j'entends des coups de feu
répétés.
Les canots reviennent chargés de ces gros gibiers qui fourniraient de la viande
pour plus d'une semaine au petit village et à mon équipage.
Dans la soirée, le grand canot revient aussi avec la moitié du tapir; l'autre
moitié à été donnée à ceux qui l'ont achevé.
Que sont devenues les autres pirogues ? En entendant des coups de fusil suivis
de Cris plaintifs : Natati!... natati! ils ont cru que les Galayouas
nous avaient livré combat et ils ont aussitôt pris la fuite.
Nous partons le 27 au matin, après avoir assuré le sort de ma victime.
Le bas Parou a les rives moins élevées que le Yary au
même niveau. Il est entrecoupé de nombreuses îles marécageuses, sur l'une desquelles
nous nous arrêtons quelques heures en attendant la marée descendante.
Apatou reconnaît des syringa, c'est-à-dire des arbres à caoutchouc semblables
à ceux qu'on exploite dans le Yary.
Dans l'après-midi, nous nous engageons dans un long canal très droit (parana)
qui aboutit à un débarcadère où une goélette fait un chargement de castañas.
Nous laissons les bagages dans le canot et nous nous
dirigeons vers une habitation située à quelques centaines de mètres du dégrad.
Nous remarquons au milieu des palmiers un petit pont de lianes entremêlées qui
sont d'un effet ravissant.
Nous étant arrêtes un instant pour contempler cette nature
admirable à laquelle nous allons faire nos adieux, nous voyons venir au-devant
de nous un vieillard à barbe blanche dont la figure ne nous est pas inconnue.
C'est un juif du Maroc que nous avons vu à Gurupa au dernier voyage.
Ce brave homme nous offre du café en attendant la préparation du dîner; nous
éprouvons un plaisir infini à savourer cette précieuse liqueur, dont nous sommes
privés depuis plusieurs mois.
J'apprends que le sitio qui était jadis occupe par une tribu d'Indiens porte le nom de Xingu, comme la rivière qui débouche un peu en amont de Gurupa.
28 décembre. — Le grand canot continue sa marche descendante,
tandis que nous revenons sur nos pas pour ne point perdre la suite de notre
trace à la boussole ; nous n'avons pas la moindre lacune dans le relevé du Parou;
encore quelques heures de travail,et nous aurons la carte de cette belle rivière,
qui est absolument inconnue des géographes.
Ne pouvant naviguer tout le temps à cause de la marée, nous nous arrêtons quelques
heures pour faire bouillir une grande marmite de café. L'abondance est revenue
subitement dans notre camp. Nous avons du sel, du biscuit, du tafia (cachassa),
du sucre. Nous faisons un déjeuner exquis. Ensuite on s'étend dans les hamacs
en attendant le reflux.
Nous commençons à dormir lorsque Apatou signale une décroissance de l'eau. Vite aux canots et en route!
Vers trois heures, nous apercevons dans le lointain une petite savane sur la rive gauche; on distingue bientôt une maison, et puis des boeufs dans une prairie. Il faut traverser la rivière pour nous rendre à cette habitation; mais voila que le vent se déchaîne subitement, des vagues se lèvent, nous embarquons de l'eau à couler has. Nous revenons à la rive pour bien arrimer les bagages, et puis nous mettons le cap droit au travers de la lame ; nous montons, nous descendons avec le morceau de bois rond qui nous sort d'embarcation. Je crains de chavirer, en pensant à mes objets de collection, et surtout à mes cahiers.
Dans la crainte de quelque accident, je porte mes cahiers sur ma poitrine, sous ma chemise boutonnée.
Enfin nous arrivons derrière une pointe où nous sommes à couvert du vent; encore quelques coups de pagaye et nous sautons sur la rive. Quelle n'est pas notre surprise de nous trouver en présence du jeune Rabeilo, le fils du Brésilien qui nous a donne l'hospitalité à Gurupa ! Son habitation est située sur un petit affluent appelé Ourouma, parce que les Indiens qui occupaient ces parages y trouvaient l'osier avec lequel ils confectionnent leurs pagaras.
Je ne sais ce qu'est devenu le grand canot ; nous l'attendons
en vain toute la soirée, et le lendemain matin, ne voyant rien venir, je pars
de bonne heure à sa recherche. Supposant qu'il s'est arrêté à l'embouchure de
la rivière, nous descendons en suivant la rive gauche.
Deux heures après, nous doublons la dernière pointe du Parou, et nous entrons
dans les eaux du grand fleuve de l'Amazone, que nous voyons pour la seconde
fois. Nous sommes devant une habitation où j'aperçois mes hommes occupés à faire
la cuisine.
Voila cinquante jours que nous avons quitte le pays des
Trios, et nous comptons quarante et un jours de navigation en descendant le
Parou.
J'ai fini mon second voyage en Guyane, mais il me reste un travail à compléter;
au premier voyage j'étais si fatigué, si malade, que je n'avais pas terminé
le trace du Yary. J'avais la partie la plus intéressante de la rivière, sillonnée
par des vapeurs. On m'avait affirmé que ce tracé avait été exécuté, mais, renseignements
pris, le Yary était sans carte depuis les sources jusqu'à l'embouchure.
Je sais que deux vapeurs remontent le bas Yary le premier de chaque mois. Si nous voulons en profiter, nous n'avons pas de temps à perdre, car je n'ai que deux jours pour passer du Parou dans le Yary.
Il n'y a pas à songer à faire la route à pied, les terres
basses des bords de l'Amazone étant entrecoupées par une infinité de cours d’eau.
Il faut naviguer, mais nos pirogues sans quilles ne peuvent résister aux vagues
de l'Amazone, qui est un véritable océan d'eau douce.
Les bons canots sont en voyage; Il ne reste qu'une vieille embarcation qui fait
de l'eau comme un panier. J'engage le patron à me conduire au Yary, mais il
refuse, prétextant, avec assez de raison, le mauvais état de sa barque. Je hausse
les épaules, et, sans tenir compte de ses objections, je réponds d'un ton qui
n'admet pas de réplique :
« Qu'on calfate cette barque tout de suite, tant bien que mal : Il faut partir
ce soir à la marée descendante. »
Je règle mes compte avec les Indiens Apalaï qui m'ont accompagne jusqu 'ici ; étant très content de leurs services, je les paye largement et je les charge d’une caisse de sabres et de haches pour Olori et pour les Indiens qui se sont sauvés dans la crainte d'une bataille.
Chose étrange ! Apatou, qui s'est montré d'une bravoure
à toute épreuve dans les chutes, semble avoir peur de la large surface de l'Amazone.
Ce n'est qu'après un moment d'une lutte intérieure qu'il vient prendre son poste
dans mon embarcation. Les noirs de Surinam, qui ont vu son hésitation, sont
pris d'une véritable panique :
« Nous ne partirons pas! non, nous ne partirons pas !
- Puisque vous ne voulez pas venir, dis-je à ces hommes, eh bien, nous partons
sans vous. »
Je leur fais les trois sommations légales et nous levons l'ancre.
Le canot, entraîné par le courant, commençait à descendre,
lorsque mes noirs se décident à venir.
Nous donnons quelques coups de pagaye pour rejoindre la rive, et ils embarquent
en silence.
Vers onze heures, quelques lumières nous annoncent que
nous approchons du village d'Almeirim.
« J'ai un frère qui est malade par là, me dit le patron, permettez-moi
d'aller le visiter. »
Je ne demande pas mieux que de descendre à terre ; je vais visiter le malade
et, en même temps, je me procure du sucre, du café et de la cachasse.
Mes noirs de Surinam, ayant pris un grand verre de café
additionne d'une forte dose de cachasse, se mettent à pagayer avec beaucoup
d'entrain.
Nous marchons jour et nuit, ne nous arrêtant que pendant la marée montante.
Nous dormons dans le canot, entassés sous un pamacari tressé en feuilles
de palmier qui recouvre l'arrière de l'embarcation.
Enfin, le 31 décembre, à deux heures, nous entrons dans le Yary.C'est un jour de fête. Les femmes sont vêtues de blanc : on se prépare à aller danser au son du tamtam.
Nous ne voulons pas retenir ces braves gens et nous les
laissons partir pour passer la soirée chez des voisins. J'engage mes hommes
à donner encore quelques coups de pagaye afin d'atteindre l'habitation de M.
Torres, qui m'accueille comme au premier voyage. Cet excellent homme vit en
paix avec une gentille femme et de jolis petits enfants qui me reconnaissent.
Le soir, on nous fait grande fête, nous buvons du vin.
Le vapeur Yary n'arrive que le 2 janvier. Il remonte
la rivière jusqu'au point on nous, avons abandonné notre travail. Comme nous
marchions jour et "nuit, il a bien fallu me résigner à quelques lacunes
en montant, mais je les comble au retour.
Le bas de la rivière se peuple rapidement. Le vapeur s'arrête plus de vingt
fois pour recevoir des chargements de caoutchouc et de castañas.
Enfin, nous; nous dirigeons vers l'embouchure de l'Amazone, en faisant environ trente escales dans les îles qui forment le delta du grand fleuve. Nous mettons cinq jours pour faire un trajet que les vapeurs directs parcourent en trente heures. Nous arrivons au Para le 9 janvier 1879.
Docteur J. CREVAUX.
(La suite a la prochaine livraison.)
[1] Apatou, interrogé sur les propriétés lumineuses du fulgor laternaria qu'il a reconnu au Muséum de Paris, dit que lui et les gens de sa tribu ne lui ont jamais vu donner la moindre clarté.
[2] En examinant le Muséum de Paris, nous avons reconnu que le gros hurleur que les Bonis appellent baboun est le mycetes seniculus, tandis que le petit qu'ils qualifient de cuacou est le myceles ursinus.
[3] La longueur du pas moyen n'égale pas soixante-dix centimetres. J'ai du exagérer ce chiffre pour compenser les pas mal accentués qui ne sont pas indiques par le podometre.
[4] Cette plante, qui forme de beaux massifs, est représentée page 55
[5] Seizième siècle, manuscrits de la Bibliothèque nationale.
[6] Congo était en fils du fameux chef bonis dont nous avons raconté les aventures.
[7] Toulé, grande fête pour célébrer l'anniversaire de la mort d'un homme
[8] Nous lisons dans Bouyer : Le mot piay, que l’on donne actuellement en Guyane à tous les remèdes de commères, désignait jadis les médecins–prêtres -jongleurs des Indiens. Des débitants le nom a passé à la marchandise.
Celle opinion n’est pas exacte : les Indiens de l’intérieur n'ont qu'un seul mot pour désigner remède et médecin. Cette simplification de langage ne doit pas paraître extraordinaire à un Français qui qualifie de médecine le remède donne par le médecin.
[9] - II y a deux fêtes en l'honneur des morts : la première est lePono, et la deuxième le Toulè, que nous avons décrit.
[10]- En 1843, Schomburg a trouvé un village d'Indiens Trios établi près des sources du fleuve Corentyne, mais les voyageurs qui ont parcouru depuis ces régions ne les ont pas rencontres.
[11] Apatou, ayant passe un hiver rigoureux en France, a souffert quelquefois de ces cicatrices qui se gonflaient au moment de la recrudescence du froid. Le même phénomène se produit chaque fois qu'il a la fièvre.
[12]Le Ministère de l’Instruction publique sous le patronage duquel le docteur Crevaux a accompli ses missions dans l'Amérique du Sud, ayant remis à la Société de Géographie les cahiers & observations et les notes du voyageur ; la Société a fait exécuter, d'après ces documents, un tracé détaillé des fleuves que M. Crevaux a été le premier à parcourir. Elle a confié ce travail aussi considérable que délicat à M. J. Hansen, qui s'en est acquitté fort habilement.
Les fleuves dont le dessin est ainsi exécuté sont : l’Oyapock (frontière de la Guyane française et de la Guyane brésilienne), deux feuilles à 1,225000e; le Rouapir, affluent du Yary, par le kou (Guyane brésilienne), une feuille à 1/200000 e; le Yary, a son confluent avec l’Amazone (Guyane brésilienne), deux feuilles1/225 000 e ; le Parou (Guyane brésilienne), huit feuilles à 1/125 000 e; l’Ica (Brésil), dix feuilles à 1/200000 e; le Yapura (Brésil), douze feuilles à 1/225 000 e.
La Société de Géographie va faire graver et publier ces dessins, dont les cartes que nous donnons ici sont des reproductions soigneusement exécutées.
[13] Il est probable que le nom des îles Caïque découvertes par Christophe Colomb à son premier voyage n'a pas d'autre origine que le mot caïque, qui est en usage chez les Roucouyennes. Peut-être des Indiens accostant le navire amiral criaient-ils : Caiqué, caïqué!