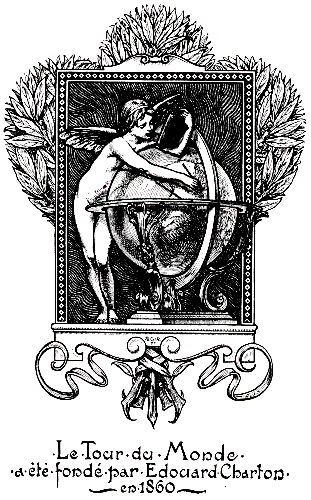
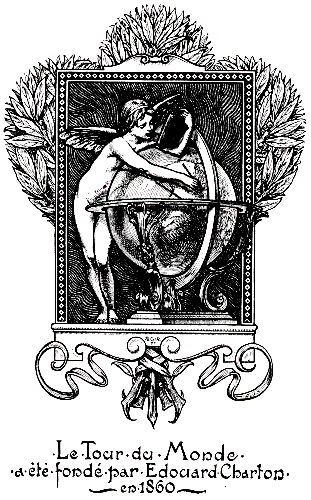
L'ISTHME DE PANAMA ET LE CANAL INTEROCÉANIQUE
PAR M. RAYMOND BEL.
Colon et le chemin de fer de Panama. - Panama. - La Société nouvelle du Canal et l'état présent des travaux.
Je viens d'avoir la bonne fortune, pendant un séjour de quelques semaines à Panama, de parcourir les chantiers en activité du Canal interocéanique, de circuler en barque à mon gré sur la partie achevée, navigable pour de grands navires, de descendre dans la tranchée formidable de la Culebra, de suivre le tracé du canal aux endroits où il est à peine dessiné; ma surprise a été tellement grande, l'impression que j'en ai ressentie si vive, que je serais heureux si je pouvais les rendre assez fidèlement sinon, pour les faire partager complètement, du moins pour éveiller l'intérêt.
II m'a été donné de voir l’œuvre accomplie, de mesurer l'effort restant à faire, d'entrevoir sur place l'importance colossale de cette voie navigable. Et tout ce qui existe sur place, tout ce qui se fait, tout ce qui reste à faire encore est si différent, si éloigné de ce que l'on s'imaginait généralement en France, que je pense accomplir un devoir de conscience en dépeignant ce que j'ai vu.
Présenté en touriste et en ami au haut personnel directeur de la Société nouvelle du Canal de Panama, j'ai trouvé auprès de ces messieurs l'accueil le plus aimable, un empressement gracieux, une courtoisie parfaite; j'ai vu là de vrais Français dévoués à leur couvre, animés de la foi en leurs travaux, pleins de l'espérance d'apporter à leur patrie le seul baume capable de lui faire oublier et son échec moral et la perte de tant de millions, en lui donnant le profit et la gloire du percement de l'Isthme américain. Qu'ils reçoivent ici l'expression de mes remerciements et de ma gratitude.
En débarquant à Colon j'avais, comme l'immense majorité des Français, la conviction que j'allais assister au spectacle navrant qu'offrent les ruines d'une couvre abandonnée; je m'attendais à voir ce qui fut une partie du canal transformé en un immense fossé encombré d'arbustes, de vase, de talus éboulés, à moitié comblé, disparaissant sous les racines des palétuviers; je cherchais dans la plaine marécageuse les locomotives, les machines à creuser, les dragues, renversées, recouvertes de lianes, gisant mutilées, dévorées lentement, pour ainsi dire, par cette terre qu'elles devaient entailler formidablement; de loin je regardais la Culebra, l'arête dorsale de l'isthme sur laquelle vinrent se briser toutes les ardeurs premières, et, pénétré d'avance de la puissance de sa masse, je ne doutais pas de ressentir à sa vue une ironie profonde pour ceux qui avaient cru pouvoir se mesurer avec elle; je croyais trouver des ruines partout où, il y avingt ans, vingt mille hommes travaillaient.
C'est en cet état d'esprit que je prenais place dans mon compartiment de chemin de fer pour me rendre à Panama, quelques heures après que le paquebot qui me portait fut entré dans le port de Colon.
Colon est sans intérêt; simple port de transit, il ne comprend que quelques maisons où sont installés des hôtels - des auberges plutôt-- des boutiques d'objets de première nécessité, où logent les employés du Rail-road et les hommes de toute race employés au déchargement des navires ; quelques habitations plus confortables appartiennent aux agents consulaires et aux agents des Compagnies de navigation française, anglaise et américaine ayant un service régulier. De vastes appontements et voies ferrées bordent la côte, et l'animation des quais est grande à l'heure du travail, car le transit par le Panama Rail-road est considérable et le va-et-vient des trains de marchandises entre les quais et la gare est incessant. La ville de Colon, appelée aussi Aspinwall, du nom d'un financier qu'enrichit la construction du chemin de fer, date du commencement du siècle.
Pendant la période espagnole le transit de Panama à la côte de l'Atlantique aboutissait à Puerto-Bello, qui fut abandonné à cause de son climat malsain; et les navires vinrent charger à l'embouchure du Rio Chagres; ce port était lui-même si malsain que les Européens transportèrent leurs comptoirs dans la petite ile de Manzanilla, entre Chagres et Puerto-Bello ; la ville qui se forma rapidement reçut le nom de Colon, en l'honneur du navigateur qui découvrit la baie, en 1502. Bâtie sur un fond vaseux, dans la boue retenue par les racines des palétuviers, des mangliers et des cocotiers, cette ville est elle-même malsaine, mais les Européens y résistent mieux qu'autrefois, les conditions d'existence s'étant beaucoup améliorées avec la possibilité de recevoir d'Europe ou des États-Unis des vivres variés, des médicaments, les lois de l'hygiène étant mieux connues et observées. L'avenir de Colon est à jamais assuré depuis que le Canal interocéanique y aboutit. Le triste aspect des maisons, des rues, la pauvreté et la saleté de la population indigène sont si peu engageants pour le voyageur qu'il ne séjourne pas à Colon, mais à Panama, lorsqu'il a plusieurs jours à attendre le paquebot sur lequel il poursuivra son voyage.
Avant l'établissement de la voie ferrée, une simple route muletière réunissait les deux côtes en passant parle bourg de Matachin. Il fallait plusieurs jours pour la parcourir et le prix était fort élevé; aujourd'hui, en trois heures, on est commodément transporté de Colon à Panama.
La voie ferrée fut ouverte en 1855, après quinze années d'études dues à l'Américain Bidde, à une époque où les premières locomotives commençaient à peine à rouler sur les voies ferrées européennes. Les travaux de terrassement, l'endiguage des quelques torrents, la percée de ces forêts marécageuses sous une température chaude et humide, coûtèrent beaucoup de vies humaines et de millions : 500 000 francs par kilomètre, cinq fois le prix du kilomètre aux États-Unis. Mais l'importance de cette voie de communication est telle que ce capital devint immédiatement productif d'intérêts élevés; grâce au monopole des transports qu'on lui concéda sur un espace do 150 kilomètres à droite et à gauche, la Compagnie put établir et maintenir des tarifs exorbitants. La Ligne est, depuis les premiers travaux du canal, entre les mains de la Compagnie, de Panama qui a acquis 93% des actions, mais l'administration et l'exploitation sont restées américaines.
Dans le compartiment je retrouve mes compagnons de paquebot; presque tous vont s'embarquer à Panama sur les courriers chiliens qui desservent la côte de l'Amérique du Sud; ils causent entre eux sans porter attention à la route qui leur est certainement familière.
Pour moi, tout est nouveau; cette brousse inextricable, dense, impénétrable, faite de palétuviers, de mangliers, de bananiers, de palmiers, barre la vue à droite et à gauche; les hautes herbes, les lianes, les plantes grasses enlacent les branches des arbres, se mêlent, s'entremêlent, au point de former un tout compact dans lequel il est impossible de pénétrer sans être armé d'un bachot; quelques rares sentiers perdus font communiquer
les petits villages indiens établis de loin en loin; de temps en temps on traverse des marais où seuls croissent les palétuviers. Nous passons devant un grand nombre de stations sans nous y arrêter : ce sont des stations établies au moment où les travaux du canal étaient en pleine activité pour desservir les points principaux d'habitation des ouvriers ou de dépôt de matériel. La voie suit le cours du Chagres, puis le coupe et le recoupe plusieurs fois à mesure que l'on gagne le seuil de la Culebra, le point culminant de l'isthme; de place en place, au voisinage des stations dont l'entourage est défriché, s'élèvent de grands hangars, les uns clos, les autres n'ayant que la toiture, qui abritent du matériel de l'ancienne Compagnie, wagons de terrassement, locomotives, rails, grues, excavateurs; tout ce matériel paraît en bon état et utilisable. Nulle part je ne vois de matériel abandonné dans la brousse, comme on l'a tant dit.
La chaleur est lourde, 35° environ ; nous nous arrêtons à Matachin pour faire de l'eau et nous atteignons la Culebra ; là les chantiers sont en activité ; à un circuit de la voie nous apercevons les entailles supérieures dans le flanc de la montagne; des trains de 10 à 45 wagons pleins de terre de déblai passent le long de la voie du Panama Rail-road ; c'est tout ce que nous voyons, car la coupure de la montagne est déjà profonde et les machines sont aux étages supérieurs. Le chemin de fer redescend maintenant vers le versant du Pacifique, il traverse le tracé du canal, qu'il laisse à sa droite. Depuis la Culebra le terrain est ondulé, le défrichement est fait sur de grands espaces et la vue se repose sur des paysages lointains, tel le village de Paraiso, dont la plupart des habitations, propriété de la Compagnie du Canal, sont fermées. Ce sont de petites maisons en bois surélevées d'un mètre au-dessus du sol, avec véranda et balcon circulaire, ou de grands hangars fermés. Les premières étaient louées aux ingénieurs ou aux contremaîtres, les autres servaient aux travailleurs jamaïcains.
Rien de plus curieux que la population de ces maigres villages. C'est une race en formation dont il sera impossible, dans quelques années, de retrouver les éléments premiers : race faite du croisement des Indiens, des Africains, des Chinois et, pour une faible part, des Européens. Les Indiens eux-mêmes ont depuis quatre siècles subi l'influence des croisements avec les Espagnols et les Africains et, si - hors de l'isthme - sur les hauts plateaux du Costa-Rica, quelques peuplades se sont gardées pures de sang étranger, on peut affirmer que colles qui sont restées dans l'isthme ont absorbé l'élément venu du dehors. Depuis plus de vingt ans l'élément chinois est venu s'y ajouter. Au passage du train les femmes et les enfants nous regardent curieusement; les femmes sont vêtues d'une chemise et d'un jupon ; celles-ci ont les cheveux lisses de l'Indienne, tressés en longues nattes ; celles-là les cheveux crépus de l'Africaine; les unes ont la peau jaunâtre et le fades aplati de la Chinoise; les autres sont du plus beau noir. A proximité des gares- simples baraquements de planches de petites boutiques offrent leurs étalages bariolés, poissons séchés, boîtes de conserves, bananes, batterie de cuisine, étoffes à bon marché; toutes ces boutiques sont tenues par les Chinois et sur la porte grouillent les enfants, nus comme des vers et offrant de l'un à l'autre les caractères des trois races. Sur toute la côte occidentale de l'Amérique du Sud les trois grandes races qui peuplent la terre se sont croisées depuis un demi-siècle, mais nulle part autant que dans l'isthme de Panama. La race nouvelle a tous les stigmates de l’infériorité physique et intellectuelle ; combien d'années faudra-t-il encore pour qu'elle progresse? D'ailleurs l'ouverture du canal donnera peu à peu, vraisemblablement, la prépondérance à la race blanche, qui éliminera tous les autres éléments.
A trois heures, nous arrivons à Panama. C'est déjà une ville historique. En 1518, Pedrarias de Avila fonda une ville pour en faire la capitale de l'isthme, il l'appela Panama et l'établit à l'embouchure d'une petite rivière nommée Algarrobo. Cette ville eut le monopole du commerce de l'isthme. Sa richesse attira en 1670 le flibustier Morgan, " l'Exterminateur ", qui, à la tête de onze cents hommes, traversa l'isthme et détruisit la ville, dont il ne reste plus aujourd'hui que les ruines informes de deux églises.
La ville actuelle est bàtie à une dizaine de kilomètres plus à l'Ouest, au pied du mont Ancon, mont isolé, haut de 170 mètres et près de l'embouchure du rio Grande. De solides murailles, épaisses de 3 mètres, bordent la ville du côté de la mer ; quelques rues sont bien entretenues aux alentours de la cathédrale et de la place centrale, mais, hors du centre, où sont le Grand Hôtel Central, les bureaux de la Compagnie, les bureaux des compagnies de navigation et des magasins importants, ce ne sont que des faubourgs dont les rues ne sont l'objet d'aucun entretien, dont les maisons toutes en bois sont immondes. Là grouillent pêle-mêle les races les plus diverses et les plus croisées ; les Chinois, les Africains, les Indiens, les Métis, ou Lidanos se coudoient les Européens ou les Américains du Nord ; les Chinois y accaparent peu à peu la richesse publique en ajoutant l'usure au commerce d'épicerie et de thé.. La raison d'être de Panama vient de sa position comme lieu de passage à l'étranglement du continent ; aussi son histoire offre-t-elle des alternatives de progrès rapide et de décadence. Ainsi Panama fut prospère quand elle commandait le trafic du Pérou et du Chili, puis la perte du monopole la dépeupla presque entièrement ; la ruée des mineurs vers la Californie en fit de nouveau une ville active et populeuse jusqu'à l'ouverture des chemins de fer transcontinentaux des Etats-Unis, qui détourna le cours des voyageurs et des marchandises. Les travaux de percement du canal, alors que les rôles de la Compagnie comprenaient plus de 20 000 ouvriers, relevèrent la ville; le déclin est venu pour la troisième fois. Du reste, elle sera toujours un des nœuds de vibration dans les lignes commerciales du monde, grâce à la voie ferrée qui traverse l'isthme et aux paquebots qui, de l'Océanie, de l'Amérique du Nord et du Sud, convergent vers son port. Les grands navires jetaient l'ancre à l'abri des îles Perico et Naos, à trois milles de terre; aujourd'hui ils viennent opérer leur chargement et déchargement au bel appontement de la Boca, construit par le Panama Railroad à l'ouverture du canal, à l'embouchure du rie Grande. La ville offre quelques ressources, mais la vie matérielle y est chère et les denrées y sont peu variées; on n'y trouve que du boeuf et du porc; le gibier est rare sur le marché, quoique abondant dans le pays, parce que les indigènes sont paresseux et nonchalants. Rares aussi sont les légumes; seul le poisson abonde ; mais si on veut le manger frais il faut qu'il soit cuit au sortir de l'eau; les indigènes le font saler et sécher et ainsi préparé il forme la base de leur nourriture. Heureusement pour le voyageur européen, habitué à moins de frugalité, les conserves alimentaires les plus variées figurent dans les menus quotidiens de l’hôtel Central, le plus confortable de Panama.
A Panama, comme dans tout l'isthme, on ne doit pas songer à battre la campagne hors des routes et des sentiers battus; là où la broussaille n'existe pas, dans des plaines en partie défrichées, l'eau des pluies stagne sous l'herbe dure et serrée. 11 faut bien se garder d'y pénétrer, autant pour s'épargner les piqûres de moustiques qui inoculent la fièvre que les morsures de serpents, presque toujours mortelles. En quelques heures on a parcouru la ville et on resterait ensuite confiné dans sa chambre, ne sachant où se reposer, si l'on n'avait pas la ressource précieuse d'aller respirer un peu de fraîcheur au déclin de la journée dans le beau parc de l'hôpital français de Panama. Grâce à l'amabilité du directeur de la Compagnie, l'accès du pare m'est gracieusement offert et j'y trouve une sorte de paradis terrestre. Au pied du mont Ancon, sur une terrasse légèrement vallonnée et dominant la ville de Panama, s'étend l'hôpital de la Compagnie du Canal; la situation est admirablement choisie; de là l’œil embrasse le golfe, les îles éparses, le rivage qui ne finit pas, la ville à vos pieds. Dans la plaine uniformément vert sombre on suit au passage l es trains allant et venant de la gare aux quais, jetant dans le calme de l'air l'appel des sifflets et le tintement des cloches qui arrivent à peine jusqu'ici. Tout ce plateau est transformé en jardin ; une belle route carrossable le parcourt en tout sens et fait le tour complet du mont Ancon, traversant à la suite de l'hôpital une ferme où la Compagnie puise les aliments indispensables aux malades, lait, légumes et viande ; toute la végétation tropicale est ici domestiquée pour ainsi dire à force de soins et permet à la rose de France de s'épanouir auprès d'elle. Le contraste est joli; il offre quelque chose de déjà vu, c'est le souvenir des jardins des riches villas niçoises qui repasse devant les yeux, mais avec plus de grandeur, plus de force, plus d'ampleur. Sous les branches des aréquiers, des mangliers, des palmiers, devant un parterre de roses, s'élèvent les salles de l'hôpital; construites en bois, sur piliers en briques, hautes de plafond, elles offrent au malade le confortable si précieux dans ces pays tropicaux, une fraîcheur relative, le spectacle merveilleux de la nature. Chaque bâtiment comprend deux étages, des lits sont en place toujours prêts, la pharmacie est approvisionnée, la cuisine allumée; la cornette blanche de nos sueurs de Saint-Vincent de Paul s'aperçoit à la fenêtre, disparaît pour reparaître un peu plus loin. Je suis bien certain, chaque fois que je vais m'asseoir à l'ombre d'un gros manglier, que l'une des sueurs viendra me demander de mes nouvelles et parler quelques minutes dé la France - si loin de nous, toujours si aimée de ses enfants exilés. En ce moment, l'hôpital, qui peut recevoir mille malades, est presque désert, mais il fut une époque où chaque lit était occupé et où six médecins et de nombreuses sueurs soignaient les pauvres fiévreux. Aujourd'hui, la Compagnie n'a conservé qu'un médecin et cinq sueurs. Je garderai un précieux souvenir des bonnes heures de repos passées là, du sourire accueillant de la sueur Thérèse, du parfum des roses qui embaumaient l'atmosphère. Je ne manquais pas d'y monter chaque fois que je venais d'une excursion sur le canal ou à la Culebra.
Avant d'aller visiter les chantiers de la Culebra, j'étudiai avec un intérêt croissant l'historique. du canal, les plans anciens, les progrès nouveaux, les travaux exécutés jusqu'en 1887, enfin l’œuvre accomplie jusqu'à maintenant par la Société nouvelle.
Cette étude est plus qu'intéressante, elle est captivante? La grandeur de l’œuvre, son triste passé, l'avenir qui lui est réservé, l'influence qu'elle aura sur le mouvement commercial des peuples, sur le développement des côtes des deux Amériques baignées par le Pacifique, tout attire et retient l'attention. Et cette recherche de cabinet n'est rien auprès de l'intérêt qui se dévoile à mesure que l'on suit sur le terrain le canal lui-même, tant dans le parcours achevé que dans ce qui reste à faire; là l'émotion est réelle. Quand, du haut de la tranchée colossale de la Culebra, le regard embrasse les chantiers en activité, on ne peut s'empêcher de songer à la curée de millions qui se fit sur cette terre, au profit de quelques-uns et au détriment de toute la France, aux fautes commises, aux sept mille hommes de toutes couleurs qui sont morts là comme si la terre se vengeait du viol qu'on lui infligeait; mais on songe aussi que ce canal, qui ne peut plus ne pas être achevé, va l'être hélas! peut-être par une autre nation que la France. On voudrait espérer que les travaux accomplis, que la richesse future, n'appartiendront pas à d'autres, que nous n'abandonnerons pas pour quelques millions une couvre aussi grandiose et aussi pleine de promesses pour l'avenir...
Dès que les Espagnols furent chassés de l'Amérique, l'ambition s'empara des esprits. Prévoyant l'élan prodigieux que donnerait à l'essor des jeunes républiques le percement de l'isthme de Panama, Bolivar, en 1825, fit procéder à la levée du plan de l'isthme en vue de l'étude d'un projet de canal interocéanique. A partir de cette époque les projets les plus divers se sont succédé et parmi les plus importants ceux de Garella en 1813 et de Lull en 1875, qui préconisaient un canal à écluses.
En 1879, MM. Wyse et Reclus présentèrent leur projet de canal à niveau; il fut accueilli et confié à Ferdinand de Lesseps, qui personnifiait dans l'opinion publique le succès de l'entreprise de Suez. D'après le plan adopté, le canal devait avoir une longueur de 73 kilomètres, suivre les vallées du Chagres du côté de l'Atlantique et du rio Grande sur le versant du Pacifique, traverser le faîte soit sous la montagne de la Culebra par un tunnel de 39 mètres de hauteur et de 6 kilomètres de longueur, soit par une tranchée formidable à ciel ouvert, profonde de cent mètres.
Le gouvernement colombien avait fixé la date d'ouverture du canal au 31 janvier 1893 et la Compagnie promettait de ne pas dépasser l'année 1888 ; on sait l'échec retentissant de l'entreprise et le désastre qui s'ensuivit. Le rapport de liquidation fit connaître que sur 1 milliard et demi de francs, 443 millions seulement avaient été dépensés directement pour les travaux du canal!
Quelques années plus tard, en 1890, la Société nouvelle de Panama, fondée afin d'étudier la solution la meilleure pour l'achèvement du canal, se constitua modestement au capital de 65 millions et ce mit courageusement à l’œuvre.
Son premier soin fut de remettre en état l'immense matériel abandonné sur place, de répartir sous de nombreux hangars, à l'abri des intempéries, celui qui ne lui était pas immédiatement nécessaire, et d'effectuer quelques travaux urgents de dérivation et de drainage pour empêcher certaines partie du canal déjà creusé de se combler. Puis elle attaqua directement la Culebra en mettant 4 000 hommes sur les chantiers. Depuis dix ans elle travaille loin du bruit des discussions, sans réclame, ménageant ses ressources, opposant une résistance calme aux essais d'intimidation, aux tentatives intéressées des Américains du Nord, qui guettent leur proie. Si cette couvre de la Société nouvelle n'est pas connue en France, elle l'est aux États-Unis et les Français devraient se dire que, si les Américains mènent tant de bruit, font des offres d'achat, c'est que le percement du canal est maintenant un travail assuré, prochain, aisé, dont les résultats financiers seront considérables et dont la possession assurera une puissance universelle formidable à la nation qui saura se l'approprier. Lorsque la Compagnie nouvelle reprit ses travaux, le gouvernement colombien lui remit 15000 hectares de terrain, reconnaissant officiellement que le tiers des travaux était effectué - les déblais enlevés étaient évalués à trente millions de mètres cubes. 16 kilomètres étaient navigables sur le versant de l'Atlantique et 6 autres kilomètres étaient presque achevés sur le versant du Pacifique.
L'idée de la construction d'un canal à niveau fut définitivement abandonnée; mais, en s'en tenant à l'achèvement du canal avec écluses, il restait trois difficultés à élucider.
1° Se rendre maître d'un approvisionnement d'eau considérable et pour cela utiliser les crues du rio Chagres ;
2° Étudier la nature des terrains inférieurs de la Culebra pour s'assurer qu'ils permettraient le travail d'une tranchée de 70 mètres de profondeur sans crainte de glissement ou d'éboulement des pentes;
3° Parer aux effets pernicieux du climat.
Voyons rapidement les études entreprises sur ces trois points et les résultats aujourd'hui acquis.
1° Le régime du rio Chagres a été étudié de la façon la plus complète; on a relevé les différents niveaux des eaux depuis 1883 et les crues anormales, mesuré les apports d'alluvions aux points à creuser, la quantité d'eau apportée par les pluies chaque année, et cela pendant 15 ans, sur le versant de l'Atlantique, et 13 ans sur le versant du Pacifique. Ce, diverses statistiques donnent la certitude de pouvoir utiliser les crues, de ménager une réserve d'eau largement suffisante pour parer à la baisse des eaux pendant quatre mois de sécheresse de janvier à avril, et d'avoir constamment disponible une source hydraulique d'énergie pour la manœuvre électrique des portes d'écluses et d'éclairage de la voie du canal. Ces études démontrent que le rio Chagres, au lieu d'être un danger, est l'auxiliaire le plus précieux, qu'il est indispensable pour l'utilisation d'un canal à écluse.
2° A la Culebra, non seulement de nombreux puits de sondage ont été creusés pour déterminer la nature des terrains inférieurs, mais on a pratiqué une tranchée à travers la région la plus inquiétante suivant l'axe du canal, ayant 9 m. 70 de largeur au plafond, 45° de pente sur les flancs et à une hauteur de 48 mètres au-dessus du niveau de la mer; en outre, un tunnel a été percé dans cette même partie à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer sur une longueur de 210 mètres et sur 3 mètres de largeur. Ces sondages entrepris en 1895 ont produit plus de 3 millions de mètres cubes de déblais; ils ont fait évanouir et la crainte de trouver de la roche dans les terrains inférieurs et le vieil épouvantail du glissement de la montagne.
3° La Compagnie nouvelle ne pouvait recommencer à engager des Chinois et des Africains comme terrassiers, ces races n'ayant montré aucune résistance au climat: elle fit appel aux Jamaïcains, et ceux-ci ont depuis dix ans résisté merveilleusement et ont été d'excellents travailleurs, aux prix de 5 francs et 7 francs par jour. D'ailleurs la rigueur du climat a été bien exagérée; si la fièvre paludéenne est fréquente aux époques des pluies, elle n'est pas dangereuse, et la fièvre jaune n'y est pas à l'état endémique : en 1897, époque où elle fut importée après dix ans d'immunité, elle causa six décès en six mois.
La Compagnie nouvelle a montré aujourd'hui que le canal est une pauvre d'un succès assuré, et son opinion est sanctionnée par celle du comité technique international qu'elle a invité à suivre ses travaux. Elle propose un projet qui laisse le choix entre trois hauteurs du niveau de l'écluse supérieure; ce sont trois projets distincts dénommés " canal à écluse à 29 mètres, canal à écluse à 21 mètres, canal à écluse à 10 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer"; ces différents projets offrent le précieux avantage de pouvoir être exécutés successivement, sans interrompre le transit commercial, à mesure que son importance grandissante en nécessitera l'exécution. En dix ans le canal à 29 mètres de hauteur peut être livré; à partir de ce moment, le produit de l'exploitation sera engagé en atténuation des dépenses pour abaisser le canal à 21 mètres, ce qui supprimera le bief supérieur; pour l'abaisser ensuite à10 mètres, ce qui supprimera le bief intermédiaire et ne laissera subsister qu'une seule écluse ; enfin pour mettre le canal au niveau de l'Océan, avec un simple bassin de marée.
On estime que la dépense à engager pour exécuter en une fois le canal au niveau de la mer serait de 2 milliards et demi et la durée des travaux de vingt ans; une telle entreprise est au-dessus des forces d'un seul peuple. Elle ne pourrait être due qu'à la coopération de toutes les grandes nations civilisées, si une entente internationale pouvait s'établir ; mais c'est là un simple rêve qui s'évanouit bien vite devant les convoitises, les appétits, les dissensions, les intérêts, les rivalités des peuples!
Au contraire, en conduisant les travaux par étapes, l’œuvre devient immédiatement réalisable par les seules forces de la nation qui l'entreprendra. La construction du canal à 29 mètres de hauteur est évaluée à 800 millions et la durée des travaux estimée à six ans; immédiatement le transit est ouvert et les appréciations les plus pessimistes accordent dès le début un rendement de 5 0/0. Nul doute que l'accroissement rapide du transit n'oblige à poursuivre les travaux jusqu'au niveau de 21 mètres et ne fournisse les millions nécessaires; de même, nul doute que l'on abaisse ainsi le canal au niveau de la mer, sans effort, méthodiquement, progressivement et pour le plus grand profit du commerce du monde et en particulier des propriétaires du canal.
Le canal de Suez ne s'est-il pas ainsi constamment accru sur ses propres ressources? Si l'on mesure l'avenir prodigieux du canal de Panama, le développement des relations entre les deux côtes des Amériques, l'essor que le commerce donnera à ces peuples arrêtés dans leur progrès par le manque de communications, si l'on mesure l'attente, l'impatience de ces peuples, les richesses immenses des régions andines, on reste convaincu que l’œuvre de Panama dépassera à pas de géant l’œuvre du canal de Suez.
Les estimations faites jusqu'ici pour évaluer le prix des travaux sont forcément entachées d'exagération par l'impression que laissera longtemps subsister le gaspillage fabuleux de la première Société du Canal. Cette Société a été jusqu'à payer le mètre cube de déblais 80 francs, alors qu'il est exécuté par la Société actuelle à 5 francs. Il est permis de penser que, grâce aux améliorations apportées aux machines et aux méthodes de travail depuis dix ans, grâce à des contrats et des marchés mieux rédigés, on atteindra une diminution considérable des dépenses et une réduction notable dans la durée du travail; pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler le percement des canaux maritimes de Manchester, de Kiel, de Corinthe, les drainages exécutés à Chicago.
L'étude détaillée des trois projets du canal à écluses m'entraînerait beaucoup trop loin, malgré l'intérêt passionnant qui s'y attache, mais il me paraît indispensable d'en donner les grandes lignes. Tous ces projets comportent un barrage à Bohio,sur le versant Atlantique, pour créer un lac de 30 kilomètres carrés à 16 mètres au-dessus du niveau de la mer, en captant les eaux du Rio Chagres; ce lac alimentera le premier bief, de Bohio à Obispo ; ensuite un barrage à Alhajuela, dans le cours supérieur du rie, pour alimenter le bief supérieur, élevé de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer et long de 10 kilomètres. Dans le premier projet à construire, deux écluses bout à bout, élevant chacune les navires de 5 mètres, feront communiquer le premier bief avec le canal à niveau. Trois écluses bout à bout feront communiquer le premier bief avec le bief supérieur, à 30 mètres, de 10 kilomètres de longueur. La descente vers le Pacifique se fait par deux écluses à Paraiso, deux à Pedro-Miguel et une à Miraflores, comprenant entre les écluses extrêmes une longueur de 4 kilomètres; l'écluse de Microflores fait pénétrer dans le canal à niveau, ayant 13 kilomètres jusqu'à la grande rade.
Lorsque le deuxième projet sera achevé, le bief supérieur sera supprimé et il restera les écluses de Bohio, les deux écluses de Pedro-Miguel, l'écluse de Miraflores ; lorsqu'on atteindra le troisième projet, il restera les deux écluses de Pedro-Miguel et une écluse de marée à Microflores; enfin le canal à niveau ne comportera qu'un bassin de marée à Miraflores. Tous ces travaux d'art, barrages et écluses, sont étudiés dans leur moindre détail ; les matériaux, pierres, granit, roche, sont sur place.
En possession de ces connaissances techniques, muni de cartes et de plans, je parcourus alors avec le plus vif intérêt tout le tracé du canal. Il offre l'aspect d'une rivière ; les talus se sont tassés suivant la pente naturelle des terres argileuses, les pluies y ont tracé de petits ruisseaux, les palétuviers et toute la flore tropicale recouvrent les bords ; ce n'est pas un canal comme ceux que nous sommes habitués à voir en Europe, aux berges régulières, entretenues avec soin, garnies de leur bordure d'arbres; c'est réellement un fleuve, dont le courant serait à peine sensible ; aux nombreux points de rencontre avec le Chagres rien ne distingue le fleuve du canal ; de place en place un village s'est créé à l'époque des travaux; comme sur la ligne ferrée, il est fait d'une agglomération de maisons en bois surélevées au-dessus du sol, presque toutes fermées maintenant. Quelques-unes sont louées aux indigènes ; de temps à autre on défile devant une hutte de roseaux et de feuilles de cocotiers abritant toute une famille indienne, une barque flotte sur le canal, amarrée aux pilotis de la hutte; plus loin, une drague inactive est accostée à la berge; plus loin, une longue file de chalands est remisée dans une sorte de garage et attend la reprise des travaux.
Les 26 kilomètres creusés sur le versant Atlantique sont fastidieux à parcourir. Le canal s'ouvre à quelques centaines de mètres des appontements de Colon, sans que rien le distingue d'une embouchure naturelle de rivière. A Panama, au contraire, l'ouverture du canal est pleine de vie, d'animation, de mouvement; aboutissant à l'embouchure du rie Grande, à 5 kilomètres de la ville de Panama, il se prolonge vers la haute mer, par un chenal balisé jusqu'à la rade des îles Naos, où les fonds sont assez grands pour que les plus gros navires y stationnent. Un appontement magnifique, de 400 mètres de longueur, muni de voies ferrées, de grues de déchargement, de hangars, est construit le long de la berge, et les navires y chargent et déchargent avec la même facilité que dans un grand port européen; ce port appelé port de la Bocca est réuni avec Panama et Colon par le chemin de fer, et les trains circulent sans interruption jusqu'à Panama ; une belle route carrossable permet en outre de faire le trajet dans une des voitures qu'on trouve stationnant près de la gare. Tout le commerce de Panama s'est transporté là ; seuls, les petits caboteurs viennent encore s'échouer sur les vases qui découvrent devant Panama à marée basse. Ici comme à Colon l’œuvre est achevée, elle est en exploitation.
L'excursion qui l'emportera sur les autres dans mon souvenir, celle qui m'a procuré l'impression la plus forte de saisissement devant l'immense travail accompli, est la visite des chantiers de la Culebra.
En descendant du train à la petite station de Culebra, on gravit le faîte d'une petite colline large de quelques centaines de mètres, et brusquement on a à ses pieds la formidable tranchée. Ce n'est pas une tranchée, c'est une gorge de montagne, une vallée encaissée telle que la nature en crée dans les massifs montagneux. L’œil embrasse l'ensemble du point où le hasard m'a conduit. En face, le sommet conique de la Culebra, qui domine de 60 mètres le fond de la gorge à gauche; dans le profil de la coupure les plaines mamelonnées du versant Atlantique, descendant en pente douce; à droite le versant du Pacifique, tombant si brusquement que dans le prolongement de la coupure l’œil ne perçoit que les nuages.
Sur tout le flanc entaillé de la montagne, en face de moi, de longues files de wagonnets sont étagées sur six plans espacés de 10 mètres en 10 mètres; chacun de ces plans, large de 10 mètres, correspond à un bond nouveau en profondeur; c'est une succession de banquettes horizontales donnant au flanc de la montagne l'aspect d'un escalier de géants. Sur les banquettes inférieures, les locomotives entraînent des trains de vingt wagons chargés de terre, qu'ils vont déverser à grande distance, d'autres trains reviennent des lieux de décharge et se rangent sous les machines à excaver toujours en mouvement. Plus loin, des mineurs préparent des trous de mine qui pulvérisent la terre et permettent aux godets des excavateurs de l'enlever comme font les godets d'une drague dans un lit de vase; le grincement des chaînes, le bruissement de la vapeur montent de la profondeur de la tranchée. Quinze cents hommes sont au travail, répartis en différents chantiers. La rive sur laquelle je suis, élevée seulement de 30 mètres au-dessus du fond de la tranchée, est taillée presque à pic, le terrain étant de ce côté beaucoup plus résistant et compact; c'est la rive même du canal. Elle est définitivement établie. Le fond de la tranchée est à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur 1500 mètres de longueur; à son extrémité, du côté du Pacifique, elle est prolongée par un tunnel de 300 mètres de longueur dont la section grandit chaque jour et dont la plate-forme est à 40 mètres au-dessous du niveau de la mer; dans quelques mois le plafond disparaîtra à son tour sous la morsure des excavateurs à vapeur et la tranchée se trouvera augmentée de 300 mètres.
Je m'arrache avec peine au spectacle émouvant de la lutte victorieuse de l'homme contre la terre ; je traverse la tranchée et sur la pente opposée je prends place avec quelques autres promeneurs sur un wagonnet de décharge qui nous conduit vers le versant de l'Atlantique, où l'on déverse les déblais dans une vallée déjà à moitié comblée. Au-delà du seuil de la Culebra le canal, d'abord à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'abaisse suivant la pente naturelle du terrain jusqu'au village d'Obispo, où une dépression brusque de 10 mètres nécessitera deux écluses séparant le bief de la Culebra du bief d'Obiosso; puis nous revenons sur nospas vers le versant du Pacifique où les décharges s'opèrent aussi dans la vallée du rio Grande jusqu'au village de Paraiso. A partir d'ici le canal est à peine dessiné jusqu'à Miraflores.
La promenade est achevée. Ma dernière visite au Canal de Panama, la plus importante, est accomplie. J'en emporte un souvenir inoubliable, une admiration vraie pour ces hommes qui, depuis dix ans, luttent sans fracas, mais avec ténacité, soutenus par la foi en l’œuvre qu'ils accomplissent; j'en emporte la conviction certaine du succès de l'entreprise ;l'espoir qu'il appartiendra à la France d'achever ce canal après en avoir été l'artisan malheureux des premiers jours. Les Américains du Nord supputent ce découragement des Français qui ne savent pas, qui ne voient pas, qui ne croient pas ; ils offrent 200 millions pour acquérir ce qui a coûté 1500 millions, au moment où, toute difficulté vaincue, tout aléa écarté, avec 500 millions ils achèveront l’œuvre. Ils lancent avec le plus grand sérieux la menace de créer le canal du Nicaragua, alors que leurs ingénieurs les plus autorisés reconnaissent que cette entreprise serait autrement coûteuse que celle de Panama et que plusieurs la déclarent impossible, dans l'espoir d'affaiblir encore notre résistance; ils savent que la Société nouvelle est arrivée à ses dernières ressources; que dans deux ans, dix-huit mois, elle devra arrêter les travaux, et ils précipitent leurs attaques pour nous enlever et les profits et la gloire d'avoir ouvert la grande voie interocéanique.
Que nous réserve l'avenir? Hélas ! je crains que nous n'abandonnions par dégoût, par ignorance, par manque de ténacité une tâche aussi belle. Le nom de Panama est honni en France. Nous souffrirons longtemps encore des sommes perdues et plus encore de l'anéantissement brutal d'espérances grandioses. Pour oublier, pour renaître à l'espoir, pour désirer poursuivre l’œuvre jusqu'au bout, il faut avoir vu, comme je viens de le voir, des hommes consciencieux lutter pour la grandeur de leur patrie là même où leurs devanciers avaient failli.
Raymond BEL.