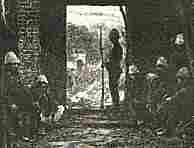
SUR LES FRONTIERES DU TONKIN
PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS
TEXTE ET DESSINS INEDITS.
XXIV
Séjour à Doson. - Le génie protecteur de la mer. - Retour à Hanoï
D’après ce qui précède, on conçoit qu'a part les Tonkinois, qui vivaient du travail de la terre et auxquels il était assez indifférent de changer de maîtres, les habitants de Monkay, aussi bien que tous les Chinois de la frontière, qui vivaient des produits de la piraterie et de la contrebande, voyaient avec ennui s'établir dans le pays un ordre régulier, par l'occupation française et la délimitation des frontières.
Les mandarins chinois des frontières ne devaient pas être les moins furieux de ce changement de régime; aussi toute cette région était-elle travaillée depuis longtemps par les autorités chinoises. De nombreux renseignements nous l'ont appris plus tard, et j'en détache le suivant, dont l'authenticité nous est prouvée :
Dans le courant du mois de septembre. le mandarin chargé de la marine a Long-moun, a l’entrée de la rivière de Kim-chéou, arriva dans la baie de Pak-lung avec sa flotte et débarqua sur l'île de Vanninh plusieurs mandarins chinois. Ceux-ci convoquèrent les notables, les avertirent que les grands mandarins envoyés par la cour de Pékin pour délimiter la Frontière du Tonkin étaient a bord de leurs jonques, et qu'ils venaient pour leur donner des instructions. Les notables devaient déclarer territoire chinois tout le pays entre le cap Paklung et Tien-hien si les Français essayaient de contester leurs assertions, on les battrait et on les chasserait facilement.
Comme les notables hésitaient et faisaient remarquer qu'en tout cas leur témoignage serait facilement contredit par les habitants des trois chrétientés tonkinoises, qui allaient de cette façon devenir chinoises, et en particulier par les chrétiens de l’île de Traco, administrés par des prêtres indigènes (mission espagnole), les mandarins répondirent : " cette affaire sera facile a régler; vous ne devez rien craindre de la part des Français; vous voyez qu'ils n'ont plus de navires sur nos côtes, ils ont fait rentrer leurs soldats en France et ils en sont réduits a se servir de soldats annamites; les grands mandarins français désirent abandonner le Tonkin; et ils le feront immédiatement s'ils rencontrent de grandes difficultés. "
Ces assertions, dont plusieurs, on le sait, n'étaient que trop vraies, trouvaient du crédit près des négociants chinois de Monkay, qui avaient tout intérêt a ce qu'il n'y eut pas de changement de régime.
M. de Goy, le vice-résident, qui habitait avec ses miliciens dans la citadelle annamite, ou il se trouvait un peu prisonnier, était obligé de faire le coup de feu chaque fois qu'il se rendait avec une escorte dans l'enclave (nom que l'on donnait au pays tonkinois situé entre le cap Paklung et l'île chinoise de Tchouksan, autour de la baie d'Oanh-xuan) ; Il n'ignorait pas toutes ces menées, et s'attendait a une attaque sérieuse, averti que des bandes nombreuses se formaient sur le territoire chinois; mais, ne jugeant pas encore le danger si prochain, il crut, après l'arrivée deMM. Bohin et Haïtce, devoir se rendre a Haïphong, puis a Hanoi, pour rendre compte de la situation et demander des instructions.
Il invita de nouveau, avant son départ, M. Haïtce a venir habiter la citadelle; mais celui-ci se croyait plus en sûreté au milieu de la ville. entourée d'ailleurs de palissades et habitée par les riches négociants dont nous avons parlé.. Il était en outre gardé par un poste, malheureusement bien peu nombreux.
Pendant que les membres de la commission étaient bloqués dans Laokay et que M. Haïtce attendait vainement dans Monkay l'arrivée de S. E. Teng, président de la délégation chinoise du Kouang-si. au-devant duquel il avait été envoyé, je passai un mois fort agréable dans la. presqu'île de Doson.
Trop faible encore a ma sortie de l'hôpital pour songer a rejoindre nos collègues , M. Paul Bert eut l’obligeance de mettre a ma disposition le splendide cottage qu'il avait fait construire sur un rocher battu de tous côtés par le vent de la mer, a l'extrémité de la presqu’île de Doson.
Une belle plage de sable blanc se déroule au pied du rocher, et un petit hôtel français fort bien tenu s'est établi a l'extrémité de la plage, pour les baigneurs qui veulent venir l'été de Haïphong afin d'y prendre des bains et. d'y rétablir leur santé en respirant la brise de mer.
Plus tard peut-être on devra. songer a établir dans nos possessions d’Indochine des sanatoria de montagne. analogues aux villes administratives que les Anglais habitent dans l'Himalaya; car, si nous n'avons pas d'Himalaya en Extrême-Orient, nous avons des plateaux suffisamment élevés, comme celui de Bolovens
ou celui des Phoucuns (voir le Tour du Monde, juillet. 1885), pour que la température soit tempérée. Mais pour cela il faudra faire des routes, de grands travaux, des déboisements et des constructions, qu'on ne peut entreprendre d'ici longtemps; aussi; en attendant, il nous parait fort rationnel de hercher sur les côtes des lieux exposés a la brise de mer et a proximité de plages de. sable ou les Européens puissent chaque année aller passer quelques semaines dans la mauvaise saison.
A ce point de vue Doson est admirablement choisi. a condition qu'une route praticable le relie a Haïphong ou qu'un môle de débarquement y soit construit;. a l'heure actuelle l'embarquement et le débarquement ne peuvent s'y faire que difficilement et par beau temps.
La. saison était trop avancée pour les baigneurs; aussi, une lois installé, je vécus absolument isolé, ne voyant que mes deux domestiques annamites et les miliciens chargés de la garde élu pavillon, chassant et me promenant toute la journée sur les plages.
Je n'appris que le 19 le malheur qui venait de frapper la colonie : Paul Bert était mort le 11, et son corps était déjà parti pour la France quand je connus cette triste nouvelle. Mes forces revenaient rapidement, et je commençais a être inquiet du sort des autres membres de la commission, dont je ne recevais aucun avis; je partis donc pour Haïphong, ou je demandai des instructions a M. Vial, le nouveau résident supérieur, lui disant que je me sentais suffisamment remis pour aller rejoindre M. Haïtce , si, comme je le pensais, il était trop tard pour retourner a Laokay. M. Vial me conseilla de prolonger mon séjour a Doson pour soigner ma santé, et j'achevai de m'y rétablir, sans autre souci que l'absence complète de nouvelles des autres membre de la commission que je savais bloqués dans Laokay.
Je profitai de ce temps pour visiter la presqu'île et ses environs, Cette presqu'île, qui regarde d'un côté la haute mer et de l'autre un enfoncement du Cua-nam-trieu, est formée aux deux extrémités par des collines rocheuses, entre lesquelles. s'étend une bande de terre plate et sablonneuse d'une dizaine de kilomètres de longueur. Sur la pointe ouest, ou atterrit le câble sous-marin, est situé le cottage du résident général; la pointe est se termine en l'ace d'une petite île ou se trouve le phare de Hong-do, qui sert pour l'atterrissage Haïphong et l'entrée du Cua-nam-trieu.
De la haute mer le pays semble désert et l'on n’aperçoit que les rares cases que les habitants Haïphong commencent a y faire bâtir pour venir prendre des bains de nier; cependant la presqu'île contient un important village comptant plus d'un millier d'habitants.
Abrité contre le vent de la nier et surtout contre la vue des pirates par de hautes et épaisses haies de bambous, les maisons se trouvent échelonnées le long de la plage qui regarde le Xam-trieu deux routes assez larges traversent le village dans toute sa longueur, et elles sont bordées par des haies de bambous si serrées, qu'on pourrait y passer sans se douter qu'on a traversé un village populeux, si l'on n'en était averti par les aboiements des chiens et la vue des enfants, qui fuient précipitamment au loin devant vous et s'enfoncent entre les bambous, pour ressortir par bandes et vous examiner curieusement par derrière.
Les hommes s'adonnent a la pêche côtière; montés sur de petites barques, ils ne prennent jamais le large, et ne peuvent que clans les temps calmes jeter leurs immenses seines de deux a trois cents mètres de long, avec lesquelles ils font parfois des pêches merveilleuses.
Les femmes sèchent le poisson et fabriquent le nuoc-nam (sorte de saumure de poisson fermenté, et non pourri, comme on le dit souvent), Ce sont elles aussi qui cultivent les rizières, paraissant très fertiles malgré l'absence de tout engrais.
Il est remarquable en effet que la mer ne rejette a la côte aucune (le ces algues que laissent sur nos rivages
les marées descendantes; les rochers de toute la côte sont d'ailleurs entièrement nus et dépourvus de fucus. On cultive aussi la patate douce et l'arachide, et sur les collines rocheuses, qui, au premier abord, paraissent absolument incultes, on récolte en abondance d'excellents ananas. La brousse est peu productive : quelques oiseaux de rivage et des tourterelles sont a peu prés le seul gibier que j'y aie rencontré.
Les Annamites ne se construisent pas de sanctuaires élevés sur les rochers et visibles de loin en mer, comme les chapelles que l'on retrouve partout sur nos côtes de France, mais ils n'en ont pas moins leurs génies protecteurs de la mer, ainsi que je pus m'en rendre compte pendant mon séjour a Doson.
Un officier de mes amis, qui retournait en France sur le Chandernagor, s'étant trouvé arrêté par la marée en dedans de la barre de Haïphong, à deux ou trois milles de Doson, eut l'idée de profiter de ce retard pour venir me faire ses adieux. Je le retins a dîner, et le soir nous ne pûmes trouver aucune barque pour le ramener a bord de son bateau, qui devait partir avant le jour. Nous fîmes mettre a l'eau une petite, yole appartenant a la résidence, et nous nous embarquâmes avec trois miliciens, peu habitués a ce genre d'embarcation. Tant qu'on fut a l'abri de la pointe, tout alla bien; mais une fois en face de la passe, la mer devint très forte; nous disparaissions complètement entre les lames. La nuit était très noire, et nos miliciens, accoutumés à manier les avirons des sampans, se trouvaient des rameurs fort maladroits pour notre pirogue; nous pouvions craindre a chaque instant d’être engloutis. Nous fumes trop heureux d’être recueillis par la baleinière du bateau-feu, mouillé dans la passe; le sous-officier qui le commandait envoya a notre secours en entendant nos cris, et conduisit a temps a bord de son navire mon imprudent camarade.
Nous avions laissé la yole, allégée de notre poids, aux mains des miliciens, espérant qu'ils pourraient la conduire a terre; mais ils furent entraînés par le courant et ils ne revinrent que le soir du jour suivant, quand je ne les attendais plus.
Ils me racontèrent qu'une fois que j'eus abandonné la barre ils n'avaient plus pu se conduire et qu'ils avaient été portés par le courant jusque sur la côte de Quan-yen. Le lendemain matin, comme je faisais ma promenade habituelle autour de la pointe de rochers découverts a marée basse, je vis arriver processionnellement mes trois miliciens avec plusieurs de leurs camarades. et des personnes de leur famille habitant le village; ils portaient sur des plateaux des bougies de cire, des fruits. du riz, du porc rôti, des volailles et de l'eau-de-vie de riz. Ils s’arrêtèrent près de l’extrémité de la pointe, se servirent comme autel d'une petite anfractuosité du rocher, et là, après avoir allumé les cierges et rangé leurs victuailles, ils se mirent en prière.
Je n'interrompis pas leur pieux exercice; mais quand ils eurent achevé je les interrogeai, et ils me répondirent que ces trois hommes avaient couru un si grand danger qu'ils n'avaient pu être sauvés que par l’intervention d'un génie protecteur. Ils profitaient de l’indemnité que je leur avais donnée comme prix de leur corvée pour venir faire un sacrifice et remercier le génie de la mer qui les avait protégés. Inutile d'ajouter que sur-le-champ victuailles et eau-de-vie de riz furent absorbées par; les sacrificateurs, pour le grand honneur du génie, auquel on en attribua cependant quelques parcelles, qui furent jetées a la mer.
J'étais chaque jour de plus en plus inquiet sur le sort des membres de la commission bloqués dans Laokay. lorsque le 1er décembre je reçus une note de M. Hunal, le résident de Haïphong,- m'annonçant la mort de M. Haïtce, du lieutenant Bohin et de leurs compagnons.
Je partis aussitôt pour Haïphong, ou j'appris que M. Bohin avait échappé au massacre et que les commissaires français de Laokay avaient pu enfin sortir de ce lieu pestiféré et venaient d'arriver a Hanoï. Je rencontrai, le 2 au matin, a Haïphong, le brave Bohin, qui allait a Hanoï. Laissant alors a un boy, en qui cependant je n'avais guère confiance, le soin d'aller prendre mes bagages a Doson, je me hâtai aussi de me rendre a Hanoï.
Là je retrouvai mes collègues, attristés du nouveau malheur qui nous frappait, et ne songeant plus à se réjouir de leur heureux retour. Nous fumes tous de l'avis de notre président, M. Dillon, pour demander a partir le plus tôt possible pour Monkay, ou nous désirions entrer en même temps que les troupes envoyées pour l'occuper. Le capitaine Bouinais, promu commandant, avait repris sa place clans la commission, et le commandant Daru, encore très fatigué, devait rentrer en France.
Une petite colonne, sous les ordres du commandant Poncet, marcha immédiatement sur Monkay; mais l’autorité militaire ne crut pas devoir nous autoriser a l'accompagner. Il fallait agir avec prudence et a coup sur : a aucun prix ou ne devait s'exposer a un échec; et comme ou ignorait si les Chinois feraient une résistance sérieuse, une deuxième colonne, sous les ordres du colonel Dugenne, qui allait prendre le commandement de la région, se tenait prête a renforcer la première. On nous dit d'attendre la prise de Monkay et l'arrivée de la deuxième colonne pour nous rendre a notre poste, et nous fumes obligés de séjourner a Hanoï jusqu'au 20 décembre.
Le commandant Poncet trouva le pays entièrement envahi par les Chinois, et ne s'avança qu'avec la plus grande circonspection. Les réguliers se retirèrent cependant sans résistance devant nos troupes, et les pirates et les bandes irrégulières, ne se sentant plus soutenus, se réfugièrent en Chine : la ville de Monkay fut prise sans coup férir. Les habitants de la ville, qui ne se sentaient pas la conscience nette de la mort de M. Haïtce, avaient tous émigré sur le territoire chinois, et le commandant Poncet entra dans une ville déserte.
Mais, avant de continuer ce récit, revenons en arrière, et, au moyen des renseignements recueillis de tous côtés pendant notre séjour a Hanoï et plus tard a Monkay, reconstituons l'histoire de l'attaque et du massacre de notre malheureux collègue.
XXV
M. Haïtce a Monkay - Attaque du 24 novembre - dans la ville. Siège de la citadelle. - Mort de. M. Haïtce.
Depuis trois semaines déjà M. Haïtce attendait l’arrivée de S. F. Teng. Le commissaire chinois Wang, qui, outre sa qualité de commissaire, remplissait les fonctions importantes de tao-taï de ces régions, vint cependant lui faire une visite, visite que M. Haïtce alla lui rendre a Tong-hin-kaï.
Il fut reçu par S. E. Wang avec le même empressement, la même cordialité que l'année précédente. Wang refusa de s'occuper de délimitation avant la venue des deux délégations, mais il se félicitait de l'arrivée de NI. Haïtce a Monkay, parce que leur présence a tous doux ne pouvait qu'apaiser les esprits et favoriser les rapports entre le autorités frontières des deux pays.
Lors du départ de M. Bohin, Wang fit demander, fort courtoisement d'ailleurs, a M. Haïtce si cet officier allait attaquer Com-ping, le principal village de l'enclave annamite, et il se déclara satisfait quand on lui eut répondu qu'il allait simplement en tournée topographique.
Pendant ce temps les Chinois se préparaient a une attaque. Le père Grandpierre, missionnaire français, qui était depuis longtemps établi dans la petite île de Tchouk-san, située clans cette partie du Kouang-tong venant toucher la mer entre l'île de Traco et le territoire de Com-ping, était averti par ses chrétiens des intentions hostiles et des préparatifs des Chinois. A différentes reprises il écrivit a M. Haïtce, qui jusqu'au dernier jour ne voulut tenir aucun compte de ses
conseils et de ses avertissements, qu'il trouvait trop pessimistes.
Il habitait, avons-nous dit, a l'intérieur de la ville, gardé seulement par trois chasseurs et quatre miliciens; le reste de la garnison, composé d'une douzaine de chasseurs et d'autant de miliciens annamites, de M. Perrin, commis de résidence, et de M. Ferlay, employé du génie, logeait dans la petite citadelle annamite, a un kilomètre environ de la ville.
Dans 'la nuit du 24 au 25, vers neuf heures du soir, M. Haïtce entendit de chez lui une fusillade assez vive du côté de la citadelle ; il sortit de la ville et se rendit aussitôt vers la citadelle; mais, avant qu'il fut arrivé, la fusillade avait cessé, et il rentra rassuré dans Monkay, dont les portes se refermèrent sur lui comme chaque nuit, et ou les veilleurs continuèrent comme d'ordinaire leurs rondes et leurs cris.
A deux heures il fut réveillé par des clameurs et le bruit de coups précités qu'on frappait a sa porte, essayant de l'enfoncer. Cette porte, renforcée par d'épais bâtons en bois dur, était extrêmement solide, et les assaillants ne parvinrent pas a la forcer.
En se mettant a la fenêtre, M. Haïtce aperçut une foule nombreuse en armes dans la rue, poussant des cris de mort, et plusieurs balles vinrent frapper la fenêtre près de lui. Les chasseurs ouvrirent aussitôt le feu, et en un instant la rue fut évacuée par les assaillants, qui se cachèrent dans les rues adjacentes et derrière les murs des maisons, d'où plusieurs continuèrent à riposter. Ces Chinois ne portaient pas l'uniforme des réguliers, mais beaucoup avaient des armes à tir rapide.
Les habitants de Monkay restèrent dans leurs maisons; il parait difficile de croire qu'ils ne furent pas complices et qu'une bande de plusieurs centaines de combattants ait pu s'introduire sans bruit dans une ville gardée par de nombreux veilleurs de nuit. si on ne lui eût pas ouvert les portes.
Après un mottent de répit, pendant lequel on put croire qu'on réussirait à tenir jusqu'au jour, on entendit escalader le toit par derrière la maison; puis les assaillants arrachèrent les tuiles, et par les trous faits dans la toiture ils firent. pleuvoir sur les assiégés des balles et (les fusées incendiaires. Pendant plus de deux heures, encouragés par M. Haïtce, les trois chasseurs et les quatre miliciens luttent contre la foule, qui augmente sans cesse; mais vers cinq heures du matin le feu a pris à divers endroits à la fois; [ont le derrière de la maison est en (lamines, et le plancher de la chambre où se tiennent les défenseurs commence à prendre feu; il faut se décider à quitter les lieux.
On ouvre la porte : les trois chasseurs se précipitent les premiers dans la rue, et par leur contenance font fuir les Chinois, qui continuent cependant à tirer sur eux, abrités par les cloisons des vérandas. L'un des chasseurs tombe à ce moment frappé mortellement; les quatre miliciens et les deus boys annamites sont pris par les Chinois, et le reste o la vaillante petite troupe fuit dans la direction de la citadelle, se retournant de temps en temps pour faire feu et tenir en respect ses ennemis.
Arrivés au bout de la rue, ils trouvent la porte barricadée : la retraite est coupée ; toutes les maisons dont les portes de derrière donnent sur le fleuve sont hermétiquement fermées, et M. Haïtce frappe en vain à plusieurs d'entre elles. Le temps presse cependant les pirates, voyant leur proie enfermée, commencent à s'enhardir, quand, après plusieurs sommations, la porte de l'avant-dernière maison, qu'habitait le doï de la police annamite, s'ouvre et donne aux fugitifs une issue vers le fleuve.
Le doï refuse d'ailleurs de les abriter longtemps, et quand on entend les coups précipités frappés à la porte de la rue, par les pirates, qui menacent de la défoncer, il adjure M, Haïtce de s'enfuire par le fleuve, s'excusant de ne pouvoir l'accompagner, paie qu'il voulait arrêter quelque temps chez lui les poursuivants. La marée était haute et le fleuve baignait. le derrière de la maison ; M. Haïtce, éveillé au milieu de la nuit.; puis occupé à repousser les attaques des pirates, s'était enfui à demi vêtu et sans coiffure; il se jette à l'eau, suivi (le ses hommes; ils font ainsi une cinquantaine de mètres avec de l'eau et de la vase jusqu'aux épaules, et arrivent par bonheur à gagner la rue du marché d'Haï-Ninh avant crue les Chinois ne soient sortis de Monkay.
Il restait près d'un kilomètre à faire pour gagner la citadelle, et l'on pouvait craindre d'être tourné Mais à moitié route ils rencontrent M. Perrin, qui arrivait en toute hâte à son secours avec la. moitié de ses hommes.
Il avait été attaqué dans la citadelle juste au moment où s'étaient fait entendre des coups de fusil à Monkay; l'attaque n'avait pas été très sérieuse, mais il venait seulement de pouvoir sortir pour se porter an secours de M. Haïtce. On gagna alors facilement la citadelle sans être poursuivi par les Chinois.
Ceux-ci d'ailleurs ne savaient que trop bien que leur proie ne pouvait leur échapper; et pendant ce temps, ivres de fureur et rendus à leur nature sauvage par la vue du sang, ils s'acharnaient sur les cadavres du chasseur et des miliciens tombés clans le combat ; ils promenèrent leurs têtes dans la ville, au bout de bambous, avec celle de la chienne du lieutenant de Goy, qui était restée dans la maison de M. Haïtce.
Les chefs faisaient éteindre l'incendie de la maison attaquée. pour s'emparer des bagages de MM. Haïtce et Bohin, des cartes, des documents et des chevaux.
Les habitants tonkinois nous affirmèrent, dans la suite, que la plus gaude partie de ces dépouilles avait été déposée chez le taotaï Wang; mais celui-ci ne voulut ou peut-être n'osa jamais en faire la restitution, ce qui eût presque été un aveu de sa complicité.
La journée du 25 fut assez calme, et nos compatriotes en profitèrent pour organiser la défense dans la citadelle.
Les Chinois, et en particulier les bandes irrégulières, attaquent rarement pendant le jour: on ne se fiait donc pas à cette trêve apparente et l'on s'attendait à être attaqué la nuit suivante. La ville de Monkay, dont on eut des nouvelles par quelques fugitifs annamites, était au pouvoir des pirates chinois; de nouveaux renforts arrivaient sans cesse de Tong-hin, et plusieurs réguliers en uniforme se trouvaient parmi eux. On mettait le feu à quelques maisons des Chinois qui entretenaient des relations commerciales avec les Européens; les autres commerçants restaient enfermés dans leurs maisons.
|
Dans la journée du 25 on avait abandonné la citadelle pour se réfugier dans le réduit (situé au point b) au sommet d'une colline d'une trentaine de mètres, boisée et escarpée, L'attaque commença dès la tombée de la nuit avec une grande violence. Nos compatriotes tiraient à bout portant, utilisant, outre leurs fusils, de petits pierriers annamites dont était armé le réduit. La bande augmentait d'heure en heure, et jusqu'à sept heures du matin les assauts se renouvelèrent presque sans, interruption. La garnison n'avait plus de vivres, pas d'eau, et les munissions, en fort petite quantité, n'allaient pas tarder à lui faire défaut. Quand il fit grand jour, les assaillants se retirèrent encore à une certaine distance. Mais cette journée du 26 dut être terrible pour les assiégés qui voyaient les collines autour de Tong-hin, sur le territoire chinois, se couvrir de tentes et de soldats. Des réguliers de plus en plus nombreux venaient se joindre aux troupes qui avaient attaqué le premier jour. L'arrivée de M. Bohin avec ses vingt chasseurs et ses vingt tirailleurs annamites, mais surtout avec son sang-froid et son habitude de la guerre annamite, pouvait seule permettre une retraite sur Hakoï, situé à une quarantaine de kilomètres de Monkay, et où le lieutenant Mac-Mahon tenait un petit poste avec une section de chasseurs. Mais M. Bohin à qui l'on avait déjà envoyé trois courriers, n'arrivait toujours pas; il était facile de deviner que ces courriers étaient tombés entre les mains des Chinois. Une femme indigène, au service des employés du fort, consentit à se dévouer et à tenter de traverser la ligne des assaillants pour porter une lettre de M. Haïtce au père Grandpierre, à Tchouk-San. Celui-ci, espérait-on, pourrait faire avertir M. Bohin. |
Au sortir de la citadelle, à cent cinquante mètres à peine, cette femme tombe dans une embuscade chinoise : elle s'enfuit en courant sur la route de Traco, où elle est poursuivie par quelques pirates. Ne perdant pas sa présence d'esprit, elle éparpille à la volée, dans les champs, quarante piastres qu'elle portait sur elle, et quelques effets de soie contenus dans un panier. Les Chinois, pris à ce stratagème, s'attardent à ramasser les piastres, et pendant ce temps la femme peut gagner un petit bois, où elle reste cachée dans un fourré. Quelques heures après, elle se remettait en route pour Traco, où elle arrivait à cinq heures du soir: de là le missionnaire annamite, fit parvenir la lettre au père Grandpierre, qui la reçut à dix heures du soir. Cette lettre arriva le lendemain seulement à M. Bohin, alors qu'il était déjà en route pour Monkay.
Dans cette journée et dans la précédente, outre les courriers envoyés au père Grandpierre pour les faire parvenir au lieutenant Bohin, M. Haïtce en expédia trois au lieutenant de Mac-Mahon, qui commandait le petit fort d'Hakoï, pour lui demander des secours. Un seul des trois tram parvint à sa destination. Or, le lieutenant de Mac-Mahon. alors attaqué vigoureusement lui aussi, ne put se dégager qu'avec peine, et, bien que n'ayant pas hésité, dans une situation dangereuse pour son poste, à se démunir de la moitié de ses hommes, cette petite troupe arriva trop tard pour sauver les assiégiés.
Le père Grandpierre, atteint d'ailleurs d'accès pernicieux violents qui le clouaient sur sa natte, dut se sauver, le jour, même, de sa chrétienté de Tchouk-san, où sa vie était menacée, et il se rendit en toute hâte à Haïphong pour rendre compte de ce qui se passait.
Vers la tombée de la nuit, le 27, les Chinois recommencent leurs assauts contre le réduit. M. Bohin n'arrive toujours pas, et de tous les côtés on aperçoit la plaine couverte d'ennemis, qui entourent complètement la citadelle. Craignant que le terrain ne fût miné, ou redoutant d'y rencontrer quelque autre fâcheuse surprise, les ennemis n'envahissent cependant pas la citadelle, qui est abandonnée des nôtres, et concentrent tous leurs efforts sur le réduit où ils se sont réfugiés. Ce réduit. en fort mauvais état, est à peine assez grand pour contenir les vaillants défenseurs, mais, placé au sommet d'une petite colline escarpée. dont les flancs sont couverts d'une végétation épaisse et à peine percée de, quelques sentiers étroits et, difficiles, il permet aux assiégés de tenir sans trop de pertes. La nuit est des plus noires : sitôt qu'apparaît un Chinois il est fusillé à bout portant. et les autres reculent ; malheureusement, dans la petite troupe il n'y a pas de commandement militaire : chacun tire à son gré et ne sait pas assez ménager les munitions.
Vers le milieu de la nuit, les chasseurs parlent de faire une sortie et d'essayer de profiter de l'absence de la lune pour opérer la retraite sur Hakoï : ils sont épuisés de fatigue et: de faim, et la soif surtout se fait cruellement sentir. Depuis plus de quarante-huit heures ils n'avaient pris ni aliments ni boisson, et avaient été jour et nuit sur le qui-vive.
M. Haïtce encourage ses hommes, les engageant à résister au moins jusqu'au soir suivant, et leur représentant que M. Bohin et un secours de Hakoï arriveront certainement dans la journée, et que, les Chinois n'osant pas attaquer de jour, la retraite sera alors facile.
Cependant les attaques redoublent; les Chinois, ne pouvant enlever de vive force le réduit, amoncellent dans le bois de la paille, de l'huile et de la poudre, et essayent de l'incendier ; ils ne peuvent y réussir, mais ils produisent ainsi une fumée âcre et épaisse, qui vient augmenter les souffrances des assiégés.
Le matin on s'aperçoit que les munitions sont à peu près épuisées. MM. Haïtce et Perrin, voyant à ce moment l'attaque se ralentir et croyant que les Chinois s'éloignent comme les nuits précédentes avec le jour. se décident à tenter une sortie pour chercher à gagner Hakoï.
On sort, sans être vu, par l'un des petits sentiers couverts de bois qui sillonnent la colline; mais, une fois dans la campagne, on s'aperçoit qu'un caporal de chasseurs et deux tirailleurs annamites, qui étaient descendus dans la citadelle pour essayer d'y trouver quelques vivres, n'avaient pas été avertis de l'évacuation du réduit et qu'on les avait oubliés. M. Haïtce, ne veut point abandonner ces malheureux : il fait cacher ses hommes et revient au réduit avec deux chasseurs pour chercher le caporal et les deux tirailleurs, perdant ainsi un temps précieux.
Aussi, à peine sortent-ils du bois, se dirigeant au pas de course vers la route de Haikoï, qu'ils sont poursuivis par une foule de Chinois qui les criblent de balles et poussent des cris de mort. Il faut de temps en temps faire volte-face pour utiliser les dernières cartouches à arrêter les poursuivants.
Arrivés à la rivière, toujours suivis de près, ils s'aperçoivent avec désespoir que le gué de la route de Hakoï est impraticable: la marée est trop haute et plusieurs des chasseurs ne savent pas nager. Malgré cela, comme il n'y a pas d'autre chance de salut, M. Haïtce ordonne de traverser la rivière. Quelques-uns se noient dans cette tentative: d'autres, aidés par ceux qui savent nager, parviennent à gagner la terre en perdant leurs armes et leurs munitions. Le doï de la police qui, le 25, avait si difficilement ouvert sa porte à M. Haïtce dans la ville de Monkay et qu'on devait soupçonner tout au moins de n'avoir pas voulu l'avertir à temps du danger qui le menaçait, se dévoue à ce moment. Trois fois il passe la rivière à la nage, portant un chasseur: mais quand il revient une quatrième fois, les ennemis se sont rapprochés et il meurt percé d'une balle au milieu du courant avec le chasseur qu'il portait. Les Chinois, se mettant à la nage, leur coupent la tête dans la rivière même.
Cependant MM. Haïtce et Perrin, qui avaient voulu jusqu'au dernier moment rester sur la rive gauche pour surveiller le passage, se trouvaient pressés par la foule des assaillants, qui, maintenus quelque temps par leur fière attitude, se rapprochaient alors sans cesse; ils se mettent à la nage avec quatre chasseurs et parviennent à gagner l'autre rive.
Les miliciens étaient dispersés ou tués, tandis que quatre autres chasseurs, défilant le long de la rive, arrivent à l'ancien arroyo de la douane (voir la carte, où une barque montée par des Annamites catholiques les fait passer de l'autre côté. Ces quatre chasseurs, dont un caporal, purent arriver dans l'île de Traco, où ils furent, quelques heures après, recueillis par M. Bohin, qui accourait.
MM. Haïtce et Perrin et les quatre chasseurs se trouvèrent cernés en arrivant sur la rive droite, au moment où ils allaient s'enfuir sur la route de Hakoï. par une bande de Chinois venant des villages voisin et aussi par d'autres qui, connaissant mieux la rivière que nos compatriotes, avaient passé l'eau à un gué plus élevé.
On n'a plus ni armes ni munitions : toute résistance est impossible; quelques chasseurs réussissent à s'enfuir par la route de Hakoï, où ils sont recueillis à quelques heures de là par le petit détachement que le lieutenant de Mac-Mahon envoyait au secours de M. Haïtce. Dans leur fuite ils out le temps de voir M. Perrin, qui s'est réfugié dans la rivière, tomber percé de coups de lances, et M. Haïtce, blessé déjà d'une balle à la jambe, disparaître au milieu des Chinois.
Des renseignements ultérieurs nous ont appris la fin de ce triste drame : on força notre malheureux ami à marcher jusqu'à la ville, où il fut massacré dans la rue par la populace. Puis, par une ancienne habitude de cannibalisme que l'on retrouve trop souvent dans l'Annam et dans la Chine du sud, son corps fut dépecé, le foie mangé, et le fiel, mélangé avec de l'alcool de riz, absorbé par ces sauvages, qui espèrent ainsi s'approprier le courage et la valeur du brave tombé entre leur mains.
Les têtes et certaines parties du corps de tous les Français ou Annamites tués dans cette journée furent promenées pendant plusieurs jours au bout de piques dans la ville de Monkay et dans les environs, au milieu de fêtes de cannibales bien dignes de ces bons Chinois que l'on nous affirme souvent avoir un caractère si doux, si poli et si civilisé.
Ainsi mourut, le 27 novembre, notre collègue et ami M. Haïtce, victime de son dévouement pour son pays et aussi pour la cause de la civilisation, massacré par des Chinois établis sur le territoire annamite et par leurs voisins qui, vivant de piraterie et de contrebande, avaient intérêt à empêcher notre établissement et notre surveillance dans ces parages.
M. Haïtce avait vingt-sept ans. Arrivé jeune à Paris. il avait trouvé le temps, tout en étant employé des postes à la Bourse, de suivre d'une façon brillante les cours de l’école des langues orientales. Pendant ce temps aussi, il collaborait activement à différents journaux et publications, entre autres au Supplément du Dictionnaire de la conversation, qui lui doit de nombreux articles. Nommé interprète en Chine, il fut ensuite successivement secrétaire particulier de M. Harmand, commissaire général de la république en Indochine ; puis chef de cabinet de M. Lemaire quand ce dernier fut envoyé extraordinaire près de la cour de Hué ; il avait , comme nous l'avons vu, remplacé M. Scherzer à la commission de délimitation.
Travailleur infatigable et d'une intelligence remarquable, M. Haïtce pouvait prétendre au plus brillant avenir; d'un abord froid et réservé, il se livrait difficilement, mais on n'en appréciait que mieux son esprit et son cœur quand il vous avait donné sa confiance. Le pays perdait un serviteur précieux, et nous, un camarade et un ami que les fatigues éprouvées et les dangers courus ensemble nous avaient rendu particulièrement cher.
XXVI
Rapport du lieutenant Bohin attaqué près de Tong-son.
Pendant que ces événements se passaient à Monkay, le lieutenant Bohin, attaqué de son côté, ne parvenait à se sauver qu'à grand-peine. On me permettra d'extraire de son rapport au président de la commission le récit de son expédition.
" Etant partis le 20 au malin, nous ne pûmes débarquer au cap Paklung que le 21, à trois heures du soir, par suite du mauvais état de la mer. J'étais accompagné du bang-bien, mandarin de Coum-ping, qui devait me conduire sur la frontière. Notre absence devait être de huit jours, et les hommes emportaient des vivres pour cette durée.
" Les journées des 22, 23, 24 et 25 furent tranquilles; le pays paraissait très calme, mais on ne voyait que de rares habitants; la région elle-même jusqu'à Hankoï était inculte, pauvre et à peu près inhabitée.
Le 25, à midi, je recevais une lettre de M. Haïtce, m'encourageant à achever mes travaux, et n'indiquant que d'insignifiantes alertes auxquelles il ne l'allait pas prêter attention.
" Le 26, à dix heures du matin, nous arrivions au village de Song-phong, à trois heures de marche de Coum-ping. Ce village, situé au fond d'une vallée très étroite, est dominé de toutes parts, et le chemin que nous devions suivre passe lui-même par un col d'une altitude de cent trente à cent cinquante mètres environ. A midi je recevais du père Grandpierre une lettre m'annonçant que de graves événements se passaient à Haï-Ninh; cette lettre, portant la même date que celle de M. Haïtce; ne m'inquiéta pas outre mesure. Néanmoins, notre mission s'achevant à Coum-ping, je pressais le départ, lorsque je fus averti que des Chinois armés venant de Trong-son avaient l'intention de me barrer la route et occupaient tous les passages.
" Je vérifiai le fait, et en effet, au moment où nous nous mottions en marche, en un clin d’œil tous les sommets des mamelons se couvrirent de Chinois armés et pavillons déployés; beaucoup d'entre eux portaient l'uniforme des réguliers chinois.
" Ayant pris la formation du convoi en marche, nous essayâmes de gravir le chemin qui passe par le col précité; nous dûmes y renoncer, car la rapidité de la pente et l'altitude ne nous auraient pas permis d'arriver au sommet en état de pouvoir repousser les Chinois qui l'occupaient. Je fis contourner ce massif sous le feu des Chinois, alors au nombre de quatre cents environ; nous les repoussions de mamelon en mamelon, et, lorsque la vallée se fut un peu élargie après deux heures de combat ( il était deux heures et demi), un dernier assaut nous assura définitivement le chemin, et nous poursuivîmes les Chinois de nos feux.
Durant le combat, deux Français et un milicien formant notre extrême droite tombèrent dans une embuscade, par suite des accidents du terrain, couvert en cet endroit; ils se défendirent vaillamment; un chasseur et le milicien se dégagèrent; mais malgré tous nos efforts nous ne pûmes sauver le deuxième chasseur, qui tomba entre les mains des Chinois et fut massacré; il nous a été impossible de nous emparer de son corps, la petite troupe que je commandais étant harcelée de toutes parts.
Nous avons vu tomber des mamelons quinze Chinois sous nos feux (les habitants donnent comme chiffres vingt et un morts et beaucoup de blessés). Le combat a constamment eu lieu entre cinquante et trente mètres.
" A quatre heures nous étions à Coum-ping. Là une lettre plus grave du père Grandpierre, datée du 26 au matin, me fut remise à mon arrivée. J'expédiai immédiatement l'ordre au patron du cotre de venir nous prendre; il était quatre heures de l'après-midi.
Cet ordre ne lui parvint que le 27 à cinq heures du matin, alors que, n'ayant pas de nouvelles de lui, nous étions partis pour Coum-ping afin de nous embarquer sur des sampans qui nous auraient déposés à Trace.
"La marée étant basse, nous dûmes aller à pied jusqu'à la baie de Tchouk-san, où nous trouvâmes le cotre. Le patron me remit une nouvelle lettre du père Grandpierre des plus pressantes et qu'il venait de recevoir le matin même. Le cotre avait, lui aussi, été attaqué la veille au soir et avait repoussé vaillamment cette attaque.
" Nous nous embarquâmes immédiatement, et je donnai l'ordre au patron, M. Héraut, de nous déposer à Trace, d'où, eu une heure et demie, je pouvais être au secours de la citadelle ; il était neuf heures du matin. A dix heures nous recueillîmes dans un sampan venant à notre rencontre quatre chasseurs, dont un caporal, sans casques, sans vêtements, n'ayant qu'un fusil.
" Ils nous apprirent le désastre de Haï-ninh, comment ils avaient pu arriver jusqu'à nous, la direction
prise par quelques-uns des autres, la disparition de M. Haïtce, enfin la mort de MM. Perrin et Ferlay. Trois miliciens également avaient pu échapper au massacre et se trouvaient dans le village catholique de Trace.
" Une reconnaissance fut faite: aucun Français ne se trouvait dans la région, mais nous pûmes recueillir le phou de Haï-ninh et deux miliciens; le troisième ne put être retrouvé.
Nous dûmes attendre la marée du 28 pour nous diriger vers la rivière de Haï-ninh, car je voulais explorer le littoral et cette rivière aussi haut que le cotre pourrait remonter.
Par le phou j'envoyai des émissaires à la recherche de ceux des Français ou miliciens qui se trouvaient encore clans la région. On n'avait aucune nouvelle de M. Haïtce. Dans la nuit plusieurs villages, Haï-ninh y compris, furent incendiés; il nous sembla que la mission de Tchouk-san elle-même était la proie des flammes. Le père Grandpierre étant parti pour Haïphong, je n'avais pas à le rechercher.
" Le 28, à six heures du matin, nous repartions sans autres nouvelles. L'état de la mer ne nous permit que de suivre la côte à distance. Le pavillon fiançais fut hissé, et des salves de mousqueterie furent tirées à intervalles, afin d'attirer sur la plage ceux qui auraient pu être sauvés.
A l'entrée de la rivière de Monkay nous trouvâmes une chaloupe à vapeur qui montait à Monkay ; je la fis héler au moyen de signaux, qu'elle aperçut enfin.
" Je l’empêchai de remonter à Monkay et je la réquisitionnai, espérant, malgré l'heure de la marée, pouvoir avec son aide explorer une, partie de la rivière. Une avarie de ses chaudières ne le permit pas; ses feux étaient éteints par la fuite qui s’était produite. Le cotre ne put que mouiller un kilomètre plus loin.
La plage était couverte d'habitants catholiques fuyant leurs villages que les pirates chinois incendiaient, ne respectant que ceux qui n'étaient pas catholiques . J'en interrogeai un certain nombre; d'après eux il ne restait plus un Français.
M. Haïtce ainsi que les autres fonctionnaires et militaires avaient été pris, tués ou noyés. M. Haïtce et plusieurs autres avaient essayé sans y réussir. de gagner Hakoï.
Une reconnaissance fut de nouveau faite dans la journée; nous recueillîmes trois nouveaux miliciens, mais nous ne découvrîmes aucun Français ; tous s'accordaient à dire qu'ils étaient massacrés.
Dans la journée je reçus un billet du chef de détachement envoyé d'Hakoï au secours de la citadelle : toute espérance nous était désormais interdite, car la route d'Hakoï, que je comptais parcourir, venait de l’être.
Dans la soirée le missionnaire annamite de Traco, réfugié avec ses chrétiens, au nombre d'un millier, en partie sur des jonques, en partie sur la plage, vint me demander de rester. Je lui fis comprendre que le peu de munitions qui nous restait ne le permettait pas, et que, en attendant du secours que je demandais pour lui, le mieux était de faire partir les jonques du côté de Hakoï.
Le 29, à cinq heures, la chaloupe à vapeur se mit en marche, suivant le littoral d'aussi près que possible. Des signaux sont faits, mais nous n'apercevons personne. A neuf heures et demie nous arrivions à Hakoï. La ville était en flammes.
M. le lieutenant de Mac-Mahon, qui venait de recevoir un train envoyé la veille, vint au-devant de nous. Il nous apprit que le détachement envoyé par lui au secours de Haï-ninh avait recueilli quatre Français, mais n’avait eu aucune nouvelle des autres.
• M. de Mac-Mahon avait été attaqué le 27, puis sérieusement le 28; quelques heures avant notre arrivée, le feu avait été mis à Hakoï, qui est entièrement détruit. Il s'attend à être de nouveau attaqué incessamment. Il venait de faire transporter le matériel dans le nouveau fort, où il a pour un mois de vivres.
" Après m’être concerté avec lui, je laissai tout le détachement, chasseurs et miliciens, et je repartis immédiatement avec la chaloupe à vapeur réquisitionnée, afin d'exposer le plus rapidement possible la gravité de la situation aux autorités militaires et civiles.
C'est ce que nous apprîmes plus tard du père Grandpierre et de M. Bohin.
XXVII
Départ pour Monkay - La baie de Halong
C'était le cœur serré, mais ayant cependant hâte de remplacer notre malheureux collègue, de poursuivre si c'était possible sa vengeance et de continuer son œuvre, que nous nous mettions en route pour Monkay.
Le 22 la canonnière le Casse-tête nous embarquait à Haïphong. et nous prenions la mer, ou plutôt nous suivions les canaux et rades successives qui s'étendent de Haiphong au cap Paklung.
Nous passons d'abord devant Quang-yen, dont nous admirons le vaste hôpital neuf, bien exposé au vent du large.
Le lendemain matin nous entrons dans la baie de Halong, qui, avec ses myriades d’îlots calcaires, offre un spectacle inoubliable.
Les typhons et. les tempêtes qui soufflent d' Haïnan, à travers le golfe, nous dit J.Scot, éclatent avec toute leur force sur la côte de Quang-yen, et la suite des siècles a sapé, rongé et émietté tout ce qui n'était pas le roc solide, en sorte que toute la côte jusqu'au cap Paklung est bordée par un immense labyrinthe d’îles et de rochers nus, désignés fort insuffisamment par le nom des Milles-Iles.
La baie de Halong présente un caractère de beauté tout spécial. Elle baigne une quantité prodigieuse d’îlots enchevêtrés les uns dans les autres, dont beaucoup ne sont que des rocs pelés; les uns sont percés de part en part; d'autres, avec leur base rongée par les vagues, ressemblent à de gigantesques champignons; d'autres sont couverts d'un manteau d'arbustes et d'arbres à feuillage toujours vert; tous sont peuplés d'innombrables oiseaux de mer de différentes espèces, mouettes, cormorans, orfraies ou aigles de mer.
Jamais contrebandiers ou pirates n'ont pu trouver de théâtre plus splendide et plus approprié à leurs exploits. Jusqu'à ce que la France eut commencé la. campagne du Tonkin, tous les habitants des villages des îles et des villes de la côte faisaient tour à tour la contrebande et la piraterie, passant à la pèche le temps que leur laissaient ces occupations.
Même en ce moment, malgré le grand nombre de canonnières et autres navires de guerre qui sillonnent ces parages, il n'est pas prudent pour les jonques, ni même pour les chaloupes à vapeur qui y mouillent la nuit, de se laisser surprendre par des jonques qui, au premier abord, peuvent paraître d'innocentes barques de pêche. Il faut veiller avec soin pour ne pas se laisser aborder ni entourer par ces pêcheurs suspects.
Au fond de la baie et au nord, on aperçoit la petite île de Hong-Gaï, connue depuis longtemps pour ses gisements carbonifères; c'est le New-Macao des anciens négociants hollandais. Le port de Hong-Gaï est très sûr; avec de légères améliorations il pourra recevoir les navires du plus fort tonnage, et la ville, qui ne peut manquer de s'y développer quand les mines seront régulièrement exploitées, sera admirablement située pour approvisionner les navires de charbon et aussi pour en fournir au chemin de fer qui devra avoir Quan-yen comme tête de ligne.
- Après avoir traversé la baie de Fai-tzi-long (dont plusieurs géographes ont fait le nom anglais de Fitz-long), la forme des îles change de caractère elles lie sont plus calcaires, paraissent moins escarpées, et plusieurs sont susceptibles de culture; telle est celle de Sam-mui-tao, derrière laquelle nous mouillons le 23, à cinq heures du soir, au mouillage dit de la Vipère.
Plusieurs canonnières et un certain nombre de chalands ayant amené les troupes sont mouillés en ce point. et la canonnière Mutine porte le résident général, M. Vial, et le général Menier qui ont voulu visiter par eux-mêmes la ville de Monkay, pour se rendre compte de son importance tant au point vue commercial qu'au point de vue militaire.
On se rend réciproquement visite, et comme la chaloupe à vapeur contiendrait difficilement tous les passagers, nous nous décidons à passer la journée suivante à bord du Casse-tête. D'ailleurs les questions que nous allions avoir à débattre avec les Chinois comprenaient des questions maritimes. Suivant l'intérêt que pouvait offrir la baie d'Oanh-xuan comme point de mouillage pour nos navires de guerre, on devait attacher une importance plus ou moins grande à revendiquer le cap Paklung ; les commissaires avaient donc tout intérêt à s'éclairer près des commandants des différents navires qui avaient déjà pratiqué ce mouillage. Le commandant Bugard, capitaine de frégate, fut même pendant un certain temps attaché à la commission de délimitation pour lui fournir les renseignements techniques dont elle avait besoin; il était. en ce moment sur la Nièvre, transport mouillé près de nous, mais il lui fallait se rendre à Haïphong avant de venir nous rejoindre.
Dans la journée du 24 nous descendîmes à terre sur l’île de Traco, où étaient campées une compagnie de tirailleurs annamites et une batterie de canons de montagne.
Cette île de Traco forme une longue bande de terre, s'étendant depuis l'île de Tchouk-san jusqu'à l'entrée du Paklam; là s'élève une petite colline, appelée Mui-ngoc, où l'on établit ensuite un blockhaus avec un magasin d'approvisionnements.
Ce point est celui où le débarquement est le plus aisé; on ne peut cependant y aborder qu'à marée haute et avec des navires calant moins de trois mètres; encore le chenal qu'il faut suivre entre les bancs de sable pendant quatre kilomètres est-il très variable, ce qui en rend le balisage difficile et cause de fréquents échouages.
L'île de Traco n'est séparée, de celle de Vanninh que par un arroyo de peu d'importance, navigable seulement à marée haute; mais de vastes terrains marécageux et couverts de palétuviers rendent fort difficiles les
communications par terre entre Mui-ngoc et Monkay même à marée basse.
Le soir on fêta le réveillon à bord du Casse-tête, et le lendemain matin, à six heures, nous partions en chaloupe à vapeur pour nous rendre à Monkay, où le commandant Poncet qui avait fait préparer nos logements, nous reçut de la façon la plus cordiale.
P.
NEIS.
(La fin à la prochaine livraison)
SUR LES FRONTIERES DU TONKIN
PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS
TEXTE ET DESSINS INEDITS.
XXVIII
Arrivée et séjour à Monkay
Nous
avons dit plus haut ce qu'était Monkay avant les événements
du mois précédent. A notre arrivée nous la trouvâmes
a peu près telle que nous l'avait décrite M. J. Scot; mais le village
annamite qui précède la ville, et la forteresse annamite avaient
été presque entièrement consumés par les flammes;
les maisons disséminées dans la campagne avaient aussi presque toutes
été incendiées.
Apres la mort de M. Haîtce les Chinois
avaient pillé et brûlé tout ce qui était case annamite,
et, après la rentrée de nos troupes, les Annamites avaient usé
de représailles envers les maisons chinoises. La ville de Monkay, cependant,
restait intacte; seule la maison occupée par MM. Haîtce et Bohin
présentait des traces de feu.
Le déménagement des habitants
de la ville ne s'était pas accompli en un jour, mais méthodiquement
et complètement. Dans les maisons tout avait été enlevé,
marchandises, meubles et ustensiles de ménage; rien n'avait été
brisé, et l'on voyait qu'on avait agi sans précipitation, n'abandonnant
que îles meubles trop lourds, grossiers et saris valeur.
Les devantures
des magasins, ornées de leur enseignes, formées par de longues planches
laqué, noires ou rouges avec des caractères d'or, de même
que les ornements des portes, que nous avait décrits M, J. Scot, n'avaient
subi aucune dégradation ; mais les bâtonnets ne fumaient plus devant
les petits hôtels, et, au lieu des riches commerçants a longue queue
et a vêtements de soie, on ne voyait circuler dans les rues, à part
les coolies de l'administration, que des uniformes de chasseurs du Vincennes ou
de tirailleurs annamites.
Ceux-ci s'étaient installés dans les
maisons vides du centre de la ville, se fabriquant bien vite des table des bancs
et des lits de camp avec les rayons des magasins, les volets et même les
planchers; les cuisines étaient occupées et, dans cette garnison
relativement confortable, régnait un air de bien-être et de gaieté.
On se croyait en sûreté et l'on s'inquiétait peu de mettre
la ville en état de défense.
De vastes quartiers restaient déserts
et présentaient un contraste frappant avec le centre de la ville. Monkay
contenait naguère, dit-on, près de dix mille habitants; mais il
ne faudrait pas croire qu'elle tient autant de place qu'une ville européenne
de même importance. On sait combien, à part les riches commerçants,
les Chinois occupent peu de place dans un logement: c'est par dizaines qu'ils
s'entassent pour la nuit dans la plus petite chambre ou dans la moindre barque.
Les
habitants annamites de Van-ninh revenus a la suite de nos troupes commençaient
déjà a relever leurs maisons en ruine, mais aucun n'habitait dans
la ville de Monkay.
Paris l'après-midi de noire arrivée le commandant
Poncet nous fit passer devant le front des troupes rassemblées, puis il
nous présenta un a un les officiers de la garnison, près desquels
nous étions destinés a vivre pendant de longs mois.
On envoya
le jour même une lettre au village chinois de Tong-hin, pour avertir les
Commissaires chinois de notre. arrivée. Cette lettre fut confiée
a un sous-officier de chasseurs, qui passa a gué la rivière de Tchouksan,
séparant Monkay de Tong-hin. Il était sans armes et portait la lettre
a la main. Quand il arriva de l'autre côté du gué, il rencontra
un petit mandarin militaire, qui lui fit signe qu'il venait prendre la lettre
pour la porter a son adresse.
Dés le lendemain nous recevions de Wang
une réponse aimable, nous souhaitant la bienvenue et nous disant qu'il
envoyait immédiatement un courrier au président Teng, qui attendait
a Kim-tchéou; pour l'avertir de notre arrivée. Cette lettre nous
fut apportée par un mandarin a cheval, et, sitôt qu'il eut passé
le gué, un sous-officier de chasseurs le précéda et le conduisit
vers la demeure de notre président: ce fut désormais toujours de
cette façon que l'on communiqua ensemble, et grâce a ces précautions
il ne se produisit jamais a ce sujet d'incident fâcheux.
Deux jours après
notre arrivée, la colonne Dugenne, composée d'une compagnie de chasseurs,
de trois compagnies de tirailleurs tonkinois et d'une batterie d'artillerie, vint
camper près de Monkay et se dirigea le lendemain sur l'enclave, ou elle
occupa sans résistance Transon et les points principaux de la région.
De
même qu'a Monkay, les habitants chinois s'enfuirent devant nos troupes,
abandonnant leurs maisons, et les habitants tonkinois restèrent chez eux.
Le colonel Dugenne fit fortifier Transon, et ce poste resta occupé par
nos soldats pendant tout le temps de la délimitation, sans qu'il y eut
aucune contestation de la part des commissaires chinois.
Notre position envers
nos collègues chinois ne laissait pas d'être très délicate;
nous ne pouvions sans preuves matérielles et évidentes les accuser
de l'assassinat de notre malheureux ami. Une accusation formelle de notre part
eut été une faute grossière; nous aurions couru au-devant
d'un échec certain, et cependant, nous savions pertinemment que Wang au
moins, qui était chargé de toute l'administration de cette réunion,
ne pouvait pas être entièrement innocent de ce crime. En admettant
qu'il n'en eut pas été l'instigateur, il était impossible
qu'il n'eut pas eu connaissance du complot et de ses préparatifs.
Des
renseignements qui nous parvinrent plus tard, mais dont nous ne pouvions pas user
officiellement. nous avertirent que cette attaque; de même que celle dont
avaient été victimes MM. Geil et Henry sur le Long-po-ho avait été
concertée depuis longtemps entre le vice-roi de Canton, le président
de la commission Teng et le tao-lai Wan ; celui-ci, chargé de l'exécution.
avait fourni les armes et fait enrôler les hommes par un pirate appelé
Bac-ha, qui commandait lors de l'attaque de Monkay.
Dés le 28 décembre
Wang et Li vinrent nous faire visité a Monkay et nous présenter
leurs compliments de condoléances pour la mort de notre collègue.
J'avoue qu'il nous fallut faire un violent effort pour prendre la main qu'ils
nous tendaient.
Peu de jours après notre arrivée a Monkay, nous
reçûmes la visite du père Grandpierre, qui, a peine rétabli,
était revenu prendre son poste dans le village chinois de Tchouk-san, a
quatre ou cinq heures de Monkay. Nous avons vu qu'il n'avait pas tenu a lui que
notre malheureux collègue ne fut averti a temps; il accepta encore de mettre
au service de la commission sa connaissance du pays et ses nombreux moyens d'information.
Le père Grandpierre, était d'ailleurs bien connu des officiers dé
marine qui avaient fait la campagne de Chine : a diverses reprises il put procurer
des pilotes a l'amiral Courbet et lui fournir des renseignements utiles.
Agé
de trente-cinq ans et paraissant a peine son âge, malgré la dure
existence qu'il menait depuis douze ans dans le village de Tchouk-san, le père
Grandpierre, comme la plupart des missionnaires catholiques en Chine, portait
des vêtements chinois, la tête rasée et la queue tressée
derrière la tête.
Les habitants de Tchouk-san ne sont pas des
Chinois; ceux-ci les appellent des sauvages, et ils méritent presque ce
nom. Ils ont une langue particulière et gardent toute leur chevelure. Apathiques,
paresseux et peureux, il a fallu toute l'énergie du père Grandpierre
et fout son dévouement pour arriver à fonder cette chrétienté.
Environné de tous côtés de pirates et mal protégé
par des mandarins qui lui sont hostiles, il a du faire de sa chapelle un véritable
blockhaus, ou il a déjà soutenu et repoussé plusieurs attaques
des pirates.
Pendant la dernière guerre, menacé par les mandarins
officiels, il dut se réfugier avec tous ses chrétiens dans une île
plus éloignée de la côte, ou ses sauvages se laissèrent
mourir de nostalgie et de faim, plutôt que de travailler.
Rentré
a Tchouk-san aussitôt après la paix, il avait réorganisé
sa paroisse, malgré sa position précaire, restauré sa chapelle
et son orphelinat; ou il recueillait les enfants; qui, sans cela; eussent été
vendus aux pirates pour être envoyés sur les marchés de Hong-kong
et de Shang-Ha. Tchouk-san commençait à se peupler, quand les troubles
de Monkay vinrent encore compliquer sa situation.
Forcé depuis bien
des années d'être toujours sur ses gardes et de prévoir les
complots formés contre lui, il avait, au moyen de Chinois catholiques,
un service de renseignements des mieux organisés, et il avait été
maintes fois averti a temps des dangers qui le menaçaient.
On conçoit
combien un pareil auxiliaire pouvait nous être utile. Il consentit a nous
consacrer le temps que lui laissaient ses occupations ordinaires, et il devint
bientôt pour nous tous, non seulement tin collaborateur, mais un véritable
ami.
C'est avec son aide que nous pûmes arriver a connaître les
détails de la mort de M. Haïtce, et c'est aussi grâce a lui
que nous parvînmes a retrouver la tête de notre collègue. Encouragé
par la promesse d'une prime assez forte offerte par notre président, plusieurs
de ses hommes se mirent en campagne et nous apportèrent successivement
plusieurs têtes plus ou moins bien conservées. Je les examinai toutes
avec le plus grand soin, et je pus désigner avec certitude deux crânes
d'Européens et enfin la tête de notre malheureux ami. parfaitement
reconnaissable a certains signes particuliers.
Assisté du docteur Roberdo
et de plusieurs des amis qui avaient particulièrement connu M. Haïtce
pendant sa vie, nous ,pûmes lui faire dresser un acte de décès,
et l'on rendit les honneurs funèbres a ses restes et a ceux du chasseur
et des miliciens qui avaient été retrouvés. Ils furent inhumés
a mi-route entre la ville de Monkay, ou ils avaient été attaqués,
et la citadelle, ou ils s'étaient si vaillamment défendus.
Toute
la garnison de Monkay assistait a cette triste cérémonie. M. Dillon
et le colonel Tisseyre rendirent hommage, en termes émus, a la mémoire
de M. Haïtce et des braves qui étaient morts avec lui.
Un mausolée
bâti eu grosses pierres de taille, provenant de la ruine d'une vieille pagode,
fut élevé sur sa tombe et perpétuera dans ce pays le souvenir
de nos compatriotes.
Dans
les premiers jours de notre arrivée on se croyait bien en sûreté
dans la ville, mal défendue cependant, entourée de haies de bambous
et, a peu de distance, de petits bois qui pouvaient favoriser une attaque. Hors
de la ville il n'était pas prudent de s'éloigner, et, sur chaque
mamelon, on pouvait craindre de rencontrer des pirates embusqués.
Si
nous devons nous lier a des renseignements que, pour nia parti je crois très
dignes de foi, les têtes de tous les Européens de Monkay, depuis
celles des membres de la commission et du colonel Dugenne jusqu'à celle
du dernier soldat. étaient mises a des prix variés, suivant les
grades. On donnait même des primes pour tous objets rapportés eu
Chine et ayant certainement appartenu a un Européen, tels que casques,
chaussures ou vêtements.
Quand le colonel Dugenne eut achevé d'organiser
les postes dans l'enclave, il revint a Mon-kay et, a. partir de ce moment il régna
dans la ville une activité fébrile. Des le point du jour, les soldats,
en tenu(; de travail, se mettaient a l'ouvrage ; en peu. de temps tous les environs
de la ville furent déboisés et débroussaillés : bambous
ou arbres fruitiers. maisons ou pagodes, tout ce qui pouvait favoriser une attaque
ou gloser le tir des assiégés fut rasé impitoyablement. La
citadelle annamite fut remise en état de défense, et le fortin,
entièrement déboisé, fortifié et approvisionné,
fut armé de hotchkiss et de deux canons de quatre-vingt-dix millimètres
: maintenant il pouvait résister a toute une armée chinoise.
Un
petit blockhaus fut en outre construit sur l'une des collines qui dominent le
village chinois de Tong-hin. Nous nous trouvions dans une position inverse de
celle que nous avions a Lao-kay ; ici c'est nous qui dominions le village chinois
et les forts environnants la ville elle-même fut convertie eu un véritable
camp retranché, et l'on en détruisit près de la moitié
afin de mettre l'autre moitié en état de défense. Tous ces
travaux que faisait exécuter le colonel Dugenne étaient nécessaires
pour assurer notre sécurité, mais je dois avouer que c'était
sans regret et même avec un certain plaisir que je voyais détruire
cette ville et raser les maisons des habitants qui avaient été complices
de la mort de notre collègue.
Les renseignements les plus alarmants
ne cessèrent en effet de nous être rapportés a partir du mois
de février.
Quand les habitants de Monkay virent que décidément
nous voulions rester et occuper la ville, ils furent exaspérés,
et sans les grandes précautions prises par le colonel Dugenne nous eussions
certainement été attaqués une nuit ou l'autre.
Outre ces
travaux de défense, le colonel faisait faire chaque nuit des rondes dans
toute la plaine et dresser des embuscades dans les endroits ou les Chinois de
Tong-hin pouvaient passer la frontière.
Il ordonnait aussi des reconnaissances
un peu plus éloignées, pendant lesquelles nos officiers topographes
purent lever une partie de la frontière vers le nord.
Dans une de ces
reconnaissances, qui s'avança jusqu'au pied des Cent-Mille-Monts, on fit
prisonnier un pal, habitant de la montagne, qui s'était par mégarde
aventuré sur notre territoire, et on l'amena a Monkay.
Ces
populations, comme les Mans, auxquels elles ne ressemblent nullement, vivent dans
les parties les plus reculées des montagnes. Celui qu'on nous amena, a
peu près nu, paraissait a moitié mort de faim, et il sauta avec
avidité sur la nourriture qu'on lui offrit; personne ne comprenait un mot
de son langage. Avec ses cheveux frisés, ses yeux non bridés et
sa peau brune; il me rappelait beaucoup plus certains types de la Malaisie que
tout autre indochinois. On ne pouvait l'interroger, et le lieutenant Hairont voulut
bien le photographier; puis, quelques jours apres, le colonel le fit reconduire
au point ou on l'avait pris. Quand on lui eut fait comprendre qu'il était
libre, il prit sa course, comme un lièvre, dans la direction de la montagne,
et s'enfuit a toute vitesse sans regarder derrière lui.
Les maisons
de Monkay, bien plus grandes que celle de Dong-dang, ont presque toutes un étage
et plusieurs chambres; sur le derrière se trouve une petite terrasse qui
donne sur la rivière; si l'usage des vitres et des fenêtres mobiles
n'était totalement ignoré. on aurait pu y être installé
assez confortablement pendant l'été. Au moment de notre arrivée
et surtout les deux mois suivants, la température. étant froide
et humide, ceux d'entre nous qui ne purent se faire construire des cheminées
eurent a souffrir du froid.
Monkay renferme plusieurs pagodes : on utilisa
les deux plus grandes, l'une pour y placer l'ambulance, et l'autre pour en faire
notre salle de conférences. Celle-ci se trouvait placée près
de la porte est de la ville, et les Chinois pouvaient y venir avec leurs escortes,
leurs porteurs et leurs domestiques sans que ces derniers pussent se répandre
dans la ville.
Les discussions sans fin recommencèrent avec les collègues
chinois, et, bien qu'on eut alternativement, presque chaque jour, une conférence
en Chine a Tong-hin, ou chez nous a Monkay, les affaires ne marchèrent
pas plus vite qu'a la Porte de Chine.
Les
premiers temps, pour se réunir on passait a gué, a cheval, la petite
rivière: plus tard on convint de construire un pont provisoire qui ne servirait
qu'aux communications des deux commissions.
La frontière, en effet,
ne devait être passée par personne autre. Tout Français ou
même tout Annamite qui se serait aventuré à traverser la rivière
aurait été arrêté, s'il n'avait auparavant été
écharpé par la population. Les Chinois; de leur côté,
étant a plusieurs reprises venus commettre des actes de brigandage dans
les hameaux annamites, tout Chinois trouvé sur notre territoire, qui ne
pouvait justifier de la cause de sa présence de notre côté
de la frontière, était passé par les armes après une
courte enquête.
Les autorités chinoises ne protestèrent
jamais contre cette manière d'agir, et le colonel Dugenne ainsi que les
commissaires nous déclarèrent souvent que tous les Chinois que l'on
trouvait errants sur notre frontière ne pouvaient être que de dangereux
pirates.
Comme on s'était plaint a Wang que les bandes qui avaient assailli
M. Haïtce venaient du territoire chinois et avaient trouvé asile sur
ce territoire a l'arrivée de la colonne du commandant Poncet, les commissaires,
ne pouvant nier le fait, protestèrent qu'il leur avait été
absolument impossible de l'empêcher et qu'ils s'emploieraient de tout leur
pouvoir pour faire arrêter les coupables. Le chef de pirates Bac-Ha et plusieurs
autres qui avaient été les instigateurs du massacre n'en restaient
pas moins en sûreté a Tong-hin et dans les environs. Nous étions
avertis de leur présence: cependant ils ne furent jamais inquiétés.
En revanche, plusieurs fois par semaine les commissaires nous faisaient avertir
que des exécutions de pirates chinois auraient lieu sur le bord de la rivière
près du pont de la commission, et l'on y décapitait en effet de
trois a cinq individus.
Du haut d'un petit blockhaus qui dominait le pont,
j'assistai quelquefois à ce triste spectacle. Le lieu de l'exécution
était une petite plage de galets, et les bourreaux, habillés de
rouge, en même nombre que les condamnés, y attendaient les victimes
en aiguisant leur sabre, dont la lame, plus large du haut que du bas, ressemble
à une sorte de couperet.
A cent mètres environ, par un sentier
qui descend sur la rive, on voit arriver au grand trot un mandarin a cheval, immédiatement
suivi par les condamnés, qui, les mains attachées derrière
le dos, n'en courent pas moins a toutes jambes, suivis chacun par un gardien armé
d'un bambou. Puis viennent une cinquantaine de réguliers en uniforme armés
de leurs fusils, et une nombreuse population qui suit en courant. Arrivés
près des bourreaux, les patients s'agenouillent, la face tournée
vers la rivière et les têtes tombent immédiatement; avant
qu'on ait eu le temps de se demander comment on va opérer. A ce moment
les soldats déchargent leurs armes en l'air, et le mandarin a cheval, les
soldats et toute la foule des curieux détalent a toutes jambes en poussant
des cris aigus. Ils craignent d'être poursuivis par l'âme des suppliciés,
et c'est pour l'effrayer qu'ils font tout ce bruit. Seuls les bourreaux, qui doivent
être des esprits forts, ne s'empressent pas de se retirer et essuient tranquillement
leurs sabres sur l'herbe de la rive. Les corps et les têtes doivent d'après
la loi, rester trois jours a l'endroit ou ils sont tombés; mais comme la
vue de ces corps étendus sur notre passage, quand nous nous rendions en
conférence a Ton-hin, nous était peu agréable, on les faisait
disparaître au bout de quelques heures, puis on exposait les têtes
dans des panier, de rotin sur le marché ou sur les routes fréquentées
de Tong-Hin, avec une inscription disant la cause de leur supplice. Nous n'avons
jamais su de quoi étaient accusés les malheureux qu'on décapitait
ainsi : mais s'il avait fallu exécuter tous ceux qui faisaient. ou avaient
fait de la piraterie, on eut été obligé de condamner plus
des trois quarts des habitants du pays.
Les
anciens habitants de Monkay avaient espéré, a notre arrivée,
obtenir de rentrer dans leurs demeures et avaient fait demander par les commissaires
chinois a notre président s'il pouvait faire prendre des mesures dans ce
but. M. Dillon répondit que cela était hors de sa compétence
et regardait les autorités territoriales du Tonkin. D'ailleurs l'autorité
militaire se souciait peu d'ouvrir les portes de la ville a cette bande de pirates
et d'espions.
Pendant que le colonel Dugenne prenait ainsi toutes ces précautions
en cas d'attaque, l'autorité civile, représentée par le vice-résident
M de Goy, ne restait pas inactive. Etabli dans une grande pagode située
entre le fortin et le fleuve et disposant de soixante miliciens annamites, il
lit fortifier sa résidence, creuser des fossés et instruisit militairement
ses miliciens, qui se trouvèrent bientôt en état de concourir
a assurer la sécurité du pays. M. de Goy, ex-lieutenant d'infanterie
de marine, qui avait déjà passé quatre ans en Indochine,
parlait couramment l'annamite et connaissait bien le pays; il s'efforça
d'organiser l'administration des habitants annamites qui étaient revenus
dans leurs maisons et commençaient a relever de ses ruines le village brûlé
de Haï-ninh.
Pour ces pauvres gens, d'ailleurs, l'incendie de leurs cases
n'est pas un malheur bien considérable, et en quelques jours une nouvelle
case est construite. La patate douce, principale culture du pays, était
restée en terre, et les champs que les Chinois avaient abandonnés
pouvaient aussi être récoltés par ces Annamites aussi vivaient-ils
fort tranquillement sous la protection de nos soldats.
M. de Goy n'en éprouva
pas moins les plus grandes difficultés pour choisir les autorités
indigènes, phu, huyen et maires, car tous ces gens ne croyaient point a
la durée de notre occupation.
Plusieurs de ceux qui acceptèrent
des fonctions ne le firent que sur l'instigation des Chinois, auxquels ils rendaient
fidèlement compte de tout ce qui se passait. Aussi l'activité déployée
par le colonel Dugenne dans les travaux de fortifications de Monkay fit-elle plus
pour faciliter l'administration du pays que toutes les proclamations, promesses
et assurances verbales qu'on put donner aux Annamites. Malheureusement, au moment
ou il commençait a bien connaître son personnel, M. de Goy fut remplacé
par un jeune homme brouillon, ignorant des choses annamites et plus propre a faire
des rapports de police qu'a l'administration dans des circonstances aussi délicates.
Des
le mois de janvier, grâce a ces mesures énergiques, toute la plaine
de Monkay entre le Paklam et l'arroyo de la douane devint suffisamment sure. Il
est vrai 'que l'on ne pouvait s'aventurer qu'en troupe armée de l'autre
côté de la rivière de Monkay, en face de la ville, ou nous
n'avions pas encore de poste fixe et ou les pirates chinois vinrent piller une
maison et assassiner deux femmes presque en face de la pagode de la résidence;
mais on pouvait des maintenant faire de longues promenades a cheval jusqu'à
l'autre côté de l'ancien arroyo de la douane, dans la direction de
Mai-ngoc et de file de Traco. Au moment ou les bruits d'attaques contre Monkay
étaient les plus menaçants, l'amiral Rieunier, qui prenait le commandement
de la division des mers de Chine, vint nous rendre visite, vers la fin de janvier,
et séjourna quelques jours parmi nous.
Un soir, au milieu d'un grand
dîner auquel, comme chef de gamelle, j'avais donné tous mes soins,
le Dugenne et l'amiral dînant avec nous, nous entendîmes des coups
de fusil du côté du village de Haï-ninh, et le sergent qui gardait
cette porte de la ville cria aux armes. La table fut vidée en un clin d'œil,
chacun se rendant a son poste et les autres allant voir ce qui se passait. Toutes
les précautions étaient prises a ce moment, et l'on n'avait a craindre
aucune surprise; aussi, n'ayant pas de poste de combat, je continuai a découper
avec soin une oie magnifique qui était le plat de résistance de
notre dîner : les convives revinrent se mettre a table avant qu'elle fut
refroidie. C'était une fausse alerte, causée par les miliciens de
la résidence : ils avaient cru apercevoir des pirates chinois le long de
la rivière, et ils avaient tiré dans la direction de la porte de
Monkay. Les soldats dit poste., de garde a cette porte, avaient entendu les balles
siffler au-dessus de leur tete et ils avaient donné l'alarme. Bien que
vingt fois on nous eut avertis que Monkay allait être attaqué a jour
fixe, c'est la :seule alerte que nous ayons eue dans cette ville.
Pendant une
visite que nous rendaient nos collègues, a propos du premier de l'an chinois,
l'amiral reçut avec nous les commissaires. et. au cours de la conversation
il eut soin de leur dire qu'au moindre acte d'hostilité qui viendrait a
se produire de la part des Chinois du côté de Monkay, il était
absolument décidé a user de représailles et a brûler
et dévaster, au moyen de son escadre, cent kilomètres des côtes
de Chine.
Ces fêtes du thet (premier de l'an annamite) retardèrent
de quelques jours nos affaires: puis nous réprimes les conférences,
et des la première séance qui suivit on arriva a une entente verbale
a peu prés complète. Non que les Chinois aient jamais voulu considérer
l'enclave et le cap comme annamites, mais ce jour là ils acceptaient de
reconnaître le statu quo et notre droit a occuper provisoirement la région,
en attendant la décision de nos deux gouvernements. Malheureusement ces
bonnes dispositions ne durèrent pas. Ils demandèrent a attendre
au lendemain pour signer cette convention, et le lendemain ils demandèrent
un mois, puis ils recommencèrent leurs éternelles tergiversations.
Malgré
les bruits d'attaque et les avis continuels que nous recevions de bonne source
de nous tenir sans cesse sur nos gardes, nous pûmes, grâce aux énergiques
mesures du colonel Dugenne, faire des excursions autour de Monkay des le mois
de février. C'est l'époque du printemps pour ce pays, et tous les
talus des champs dans les environs sont revêtus de haies de rosiers du Bengale
dont les fleurs sont odorantes en ce pays. L'incendie des maisons de Haï-ninh
avait respecté les jardins, et en peu de temps les ruines noircies furent
en maints endroits couvertes par des bosquets de roses.
La chasse était
peu productive, le pays étant trop cultivé pour donner asile au
gibier, et il eut été imprudent de s'éloigner du côté
des collines. Les bécassines dans les terrains humides, les tourterelles
et quelques rares perdrix rouges dans les terres sèches, voilà a
peu près le seul gibier que l'on rencontrât. Une autre chasse, plus
amusante, était celle des chiens chinois, redevenus sauvages dans les collines
situées à l'est de la ville: ces animaux n'avaient pas suivi leurs
maîtres en Chine, mais pendant notre séjour ils ne s'approchèrent
jamais de Monkay. Ils s'étaient creusé des terriers dans les collines,
et quand, dans nos promenades à cheval, nous les rencontrions dans la plaine,
on s'amusait a les forcer comme des renards.
L'un des premiers soins du commandant
Poncet, quand il s'était installé a Monkay, avait été
de faire cultiver un vaste espace de terrain près du fortin ; aussi en
quelques semaines on eut en abondance des salades, des radis et des légumes
verts de diverses espèces, non seulement pour les officiers, mais pour
tous les Européens.
Le marché que l'on avait établi près
de la ville ne fut d'abord que peu approvisionné, et cela se conçoit.
le pays ayant été complètement dévasté; peu
a peu cependant les pécheurs de la côte y apportèrent leurs
poissons, et les habitants de Traco et des autres points qui avaient échappé
au pillage vinrent y vendre leurs porcs, leurs œufs, leurs volailles, des fruits
et quelques légumes. Ils nous vendaient d'ailleurs ces denrées au
moins le triple de ce qu'elles valaient a Hanoï.
La principale culture
du pays est la patate douce, qui forme la base de la nourriture des pauvres; tous
préfèrent le riz, qui pousse bien aussi dans la plaine de Monkay,
mais la patate donne facilement jusqu'à trois récoltes par an, et
a chaque récolte une plus grande quantité de principe nutritif;
on cultive en outre l'arachide, le maïs et un peu de sarrasin.
Cette plaine,
sillonnée par de petits arroyos, est parsemée de bouquets d'arbres
formés par d'immenses banians, sous lesquels on trouve souvent des tombeaux.
Près de l'ancien arroyo de la douane, le pays est plus boisé. Dans
une vieille pagode ombragée de grands arbres, située a quatre kilomètres
environ do Monkay, l'autorité militaire avait placé un petit poste
commandé par un officier, et ce poste de Kouniam-tong devint presque chaque
soir le rendez-vous de nos promenades a cheval.
Parfois, quand la marée
était basse, on traversait, l'arroyo a gué et l'on se rendait au
village catholique de Tjunnin, qui se relevait rapidement de ses ruines.
C'étaient
les gens de ce village qui avaient sauvé du massacre trois chasseurs en
leur faisant passer l'arroyo, et quand les Chinois furent maîtres du pays,
ils avaient incendié le village et chassé les habitants.
Sous
la direction de leur curé annamite ils se mirent activement au travail
des l'arrivée des Français. Se trouvant un peu éloignés
de nos postes, ils commencèrent par construire une enceinte fortifiée
défendue par des palissades et des bambous épineux; pour se mettre
a l'abri d'un coup de main des pirates; puis, avec les matériaux des maisons
chinoises que l'on avait détruites et qu'on les autorisa a employer, ils
se construisirent des cagnas, recouvertes en tuiles, plus confortables que celles
qu'ils eussent jamais possédées. Au centre du village un vaste hangar
recouvert en tuiles, dans un coin duquel logeait le curé annamite, servait
d'église.
Toutes les missions de cette partie du Tonkin sont des missions
espagnoles, et les évêques espagnols sont bien moins difficiles que
les nôtres pour le recrutement du clergé indigène. Aussitôt
que les néophytes connaissent un peu leur religion et qu'ils savent lire
l'écriture latine, on les trouve assez instruits pour les ordonner prêtres
et les envoyer administrer une paroisse. Ils ne savent en général
ni le latin ni aucune langue européenne et jouissent de fort peu de prestige
près de leurs paroissiens. Le curé de Tjunnin ne se distinguait
des autres hommes du village que parce qu'il portait les cheveux courts au lieu
du chignon national, mais il était du reste vêtu a l'annamite, et
nous le rencontrions parfois travaillant aux champs on a la fortification du village,
comme ses paroissiens, et portant des habits aussi sordides que les autres. Malgré
tout, on est bien heureux, surtout dans ces pays troublés ou il est imprudent
de perdre de vue un poste militaire, de se trouver au milieu des villages catholiques.
Quels que soient les missionnaires, Français ou Espagnols, leurs paroissiens
regardent toujours forcément les Européens comme des amis, et tant
qu'on est sur leur terre on peut être certain d'être averti a temps
si l'on court quelque danger. Les habitants de Tjunnin nous saluaient toujours
avec empressement; ils nous servaient de guides dans nos promenades, et l'on se
sentait parmi eux en parfaite sécurité, tandis que dans le voisin
village bouddhiste de Mout-say. qui se trouvait plus a l'est, les habitants fuyaient
ou se cachaient a notre approche, et plusieurs fois nos patrouilles trouvèrent
des pirates chinois cachés dans ce village.
Quelle que soit la politique
que l'on suivra envers les catholiques au Tonkin, que, suivant l'expression de
Francis Garnier, on s'en serve sans les servir, ou que, s'appuyant sur eux, on
leur accorde quelque confiance sinon quelques avantages, on pourra toujours être
certain qu'ils préféreront notre domination a l'administration si
capricieuse des mandarins, qui, suivant leur bon plaisir, les laisseront en paix
pendant quelques années, pour les persécuter ensuite avec fureur
pendant plusieurs autres. Comment s'étonner d'ailleurs de la prudence et
du peu d'enthousiasme avec lesquels ils sont venus a nous en 1885, particulièrement
dans les missions espagnoles, quand on se rappelle de quelle manière, en
1874, après les avoir compromis, on les a livrés dans tout le Tonkin
aux fureurs des lettrés, lors de notre départ du pays!
Les premiers
mois a Monkay se passèrent donc assez agréablement. Le soir on se
réunissait autour d'un grand feu, dans une maison chinoise que nous décorions
pompeusement du nom de Cercle, ou avec les officiers de la garnison nous mettions
en commun les journaux, revues et livres que nous recevions. Nous n'avions, il
est vrai, et nous ne devions avoir dans la suite, aucune satisfaction, dans cette
région, au point de vue de la réussite de notre mission, mais la
vie matérielle était suffisamment confortable et les distractions
variées, grâce aux bonnes relations qui ne cessèrent de régner
entre les nombreux officiers habitant alors la ville. Des le mois de mars, les
conditions changèrent: mon ami et compagnon habituel, le commandant Bouinais,
était parti pour Pékin; quelques semaines après, le colonel
Dugenne partait eu colonne avec la plupart des officiers, et les autres allaient
loger dans la citadelle restaurée. Puis les chaleurs étaient revenues
et avec les chaleurs les accès de fièvre. Dans ces
vieilles maisons
de Monkay, les rez-de-chaussée et les sous-sols étaient encombrés
de détritus qui fermentaient et. des les premières chaleurs, dégageaient
des odeurs nauséabondes. Les animaux immondes les plus variés envahissaient
nos logements.
Je dois cependant excepter de ceux-ci deux énormes araignées
ayant le corps de la grosseur du pouce, et plus de quinze centimètres de
l'extrémité d'une patte a l'autre ; elles avaient élu domicile
au-dessus de mon lit et j'avais bien défendu a mon boy de les troubler;
elles ne descendaient jamais bien loin le long du mur, mais elles me débarrassaient
des moustiques et surtout des cafards qui pullulaient chez moi. Elles chantaient
un ronron sonore analogue a celui du chat, mais pouvant s'entendre d'une chambre
a l'autre. Pendant les longs accès de fièvre qui me clouèrent
sur mon lit a celte époque, ce chant me paraissait singulièrement
agréable et je suivais leurs chasses avec intérêt. Bonnes
mères de famille d'ailleurs, elles portaient, fixé sur leur dos,
un gros sac de fine soie, de la grosseur du petit doigt, au travers duquel ou
apercevait une douzaine d'œufs d'un jaune d'or, ce qui ne les empêchait
pas de se précipiter, avec une vitesse extrême, sur des cafards presque
aussi gros qu'elles; elles les piquaient au cou.. leur suçaient le sang
et les laissaient retomber en quelques secondes.
Je ne dirai pas que j'en étais
réduit a cette seule distraction, car dans ces pays on observe autour de
soi tant de choses intéressantes et l'on a si peu de loisir pour les noter,
que je n'ai jamais pu comprendre qu'on put trouver le temps de s'ennuyer.
Pendant
les mois d'avril et de mai, M. Hart ou l'ingénieur Li vinrent plusieurs
fois me prier d'aller a Tong-hin soigner des malades auxquels ils s'intéressaient.
Je remarquai qu'une véritable ville s'était construite depuis notre
arrivée. Les plus riches négociants de Monkay s'étaient résolus
a abandonner pour jamais leur ancienne résidence, et ils faisaient bâtir
de grands magasins pour continuer leur honnête commerce. - Si l'on veut
bien se rappeler que le traité de Tien-tsin ne prévoit pas de marchés
nouveaux ouverts au commerce européen dans le Kouang-tong, il sera facile
de comprendre que l'existence d'une ville commerciale dont les habitants ne trafiquaient
d'ailleurs que de denrées acquises par piraterie ou par contre-bande n'avait
plus sa raison d'être sous un régime régulier.
Nous
aurons désormais la, en face de Monkay, une nouvelle ville chinoise dont
les riches habitants essayeront de continuer l'honnête commerce qu'ils faisaient
autrefois, et qu'une surveillance des plus actives pourra seule empêcher.
Quant a l'avenir de cette ancienne ville florissante de Monkay, nous ne pouvons
que souhaiter de voir accomplir la prédiction que, des 1884, faisait le
clairvoyant M. J. Scot :" il faut qu'elle disparaisse de la carte pour que
la province de Quang-yen jouisse d'un peu de sécurité ".
Malgré
tout, les magasins ne s'approvisionnaient plus, la piraterie et la contrebande
étant impossibles pour le moment; les riches négociants écoulaient
seulement, dans leurs nouveaux magasins, les anciens approvisionnements, et une
multitude de coolis, de petits marchands et d'employés se trouvaient dans
une misère affreuse, mourant. de faim et risquant souvent leur vie pour
venir voler quelques patates dans les champs des environs de Monkay.
Plusieurs
fois, quand M. Dillon et moi nous restâmes seuls membres de la commission,
toute la population de Tong-hin vint faire des manifestations sur notre passage,
et les réguliers chinois furent obligés de contenir les manifestants.
Un jour même, S. G. Wang nous avertit que la population, exaspérée,
devait tenter une attaque contre nous la première fois que nous irions
en Chine pour une conférence: il nous disait qu'il avait pris toutes ses
précautions, mais nous demandait de l'avertir de l'heure exacte de notre
arrivée en Chine.
Nous partîmes comme d'ordinaire, a pied, avec
nos chasseurs sans armes comme escorte, et nous fumes étonnés de
rencontrer au bout du pont le taotaï Wang, qui, avec l'ingénieur Li
et une forte escorte, venait lui-même a notre avance. Plusieurs milliers
de Chinois se pressaient derrière la haie de réguliers entre laquelle
nous passâmes pour nous rendre a la pagode des conférences. Ces manifestations,
que nous soupçonnions toujours organisées a l'instigation de nos
excellents collègues, n'influaient naturellement en rien sur nos discussions,
mais au retour, bien que nous fussions accompagnés par le taotaï Wang
et Li-Hing-Joueï, la population rompit les lignes des réguliers, et
les anciens habitants de Monkay, se jetant a plat ventre devant nous, se mirent,
a pousser des cris lamentables et a implorer notre pitié. Nous ne pouvions
absolument rien pour eux, et nous n'avions heureusement, aucune décision
a prendre, car, vraiment, au point de vue de la conscience, ce sont la des questions
complexes dont on est heureux de ne pas avoir a prendre la responsabilité.
Ces
habitants de Tong-hin et de Monkay. si l'on en excepte les plus riches négociants
(qui étaient absolument chinois, de race chinoise) de même que tous
ceux des environs jusqu'au delà de Hakoï, sont d'une race ou plutôt
d'une branche de la race mongole tout a fait distincte; ils s'appellent eux-mêmes
des Hakkas. Ils ont été chassés, il y a un certain nombre
d'années, des environs de Canton, ou ils avaient la mauvaise. habitude
de piller leurs voisins et de vivre a leurs dépens, et ils ont refoulé
ou réduit a l'état de vassaux les Annamites du pays qu'ils ont envahi
après leur exode. La cour de Hué s'inquiète naturellement
fort peu de ces empiétements, et les mandarins locaux, intimidés
ou bien payés, se laissent facilement séduire. Habitués,
depuis des siècles peut-être, a vivre de brigandage sur terre ou
de piraterie sur mer, ces Hakkas devront être ou exterminés ou expulsés
du territoire qu'ils ont envahi, si l'on veut assurer la tranquillité et
la liberté des Annamites, aux dépens desquels ils vivent en ce moment.
Ce
pays, il est vrai, était en grande partie habité par des Chinois,
et c'était là le grand argument de nos collègues, qui n'en
avaient guère d'autre; les autorités chinoises des environs étaient
souvent intervenues pour régler les différends, ce qui s'explique
par l'éloignement de cette région et la faiblesse des mandarins
annamites; mais les traditions, les rôles d'impôts et même la
grande géographie officielle chinoise nous indiquaient ce pays comme faisant
partie du Tonkin. Nos collègues cependant furent intraitables sur ce point
: ils avaient des ordres formels du vice-roi de Canton de ne pas reconnaître
ce territoire comme tonkinois.
Devant une pareille attitude toute discussion
devenait oiseuse; il ne fallait pas espérer convaincre des gens qui ne
voulaient pas, qui, même, par ordre supérieur, ne pouvaient pas être
convaincus. Ce ne fut cependant qu'après avoir longuement et a plusieurs
reprises développé toutes les preuves que nous avions a fournir,
et fait toucher du doigt aux commissaires chinois d'inanité de leurs arguments,
que nous convînmes de considérer la question de l'enclave comme pendante
et de nous occuper d'autres choses.
On fit donc, dans un projet de procès-verbal
accompagné de carte, une convention provisoire réservant a la décision
de nos gouvernements titre entente sur la question de l'enclave, et, comme la
colonne Dugenne occupait le pays, on convint de garder le statu quo jusqu'à
l'arrivée de cette décision.
Tout
étant réglé, les cartes préparées et les procès-verbaux
rédigés et collationnés, nous espérions signer le
lendemain et en avoir fini, pour le moment, avec cette irritante question de l'enclave,
quand, au lieu de tous les membres de la commission, nous vîmes arriver
seul, chez nous, le 6 février, le commissaire Wang. Il venait nous apprendre
que la parole qu'ils avaient donnée la veille ne devait compter pour rien.
Poussé par M. Dillon, il finit par avouer que pendant la nuit ils avaient
consulté le vice-roi de Canton par le télégraphe, et qu'ils
avaient été désapprouvés. Ils voulaient bien encore
considérer une partie de l'enclave comme réservée jusqu'à
la décision des gouvernements, mais ils refusaient d'y comprendre le cap
Paklung, et nous demandaient de faire évacuer nos troupes immédiatement
de ce point. La flotte chinoise du vice-roi de Canton venait, disait-il. mouiller
dans cette rade tous les cinq ou six ans, et c'était la une preuve suffisante
des droits de la Chine sur le cap Paklung !
On conçoit qu'après
la convention de la veille le pauvre Wang, que l'on changeait toujours des commissions
difficiles, fut font mal reçu. On fit semblant de refuser de croire que
les autres commissaires et en particulier le président Teng fussent d'accord
avec lui. et l'on menaça de rompre entièrement si l'on revenait
sans cesse le lendemain sur ce qui était convenu la veille. Nous ne pouvions
d'ailleurs admettre que le vice-roi de Canton, qui faisait partie de la commission,
mais qui n'y parut jamais, et avec lequel, par conséquent, toute discussion
était impossible, vînt modifier ainsi nos projets de conciliation.
Nous
avions, sans engager l'avenir, poussé les concessions jusqu'aux dernières
limites, puisque, certains du droit du Tonkin sur l'enclave, et ayant les preuves
en main, nous consentions a réserver la question pour pouvoir nous occuper
d'autres choses. Finalement on ne signa rien, la convention resta verbale, mais
en fait nos Troupes continuèrent a occuper l'enclave et le cap jusqu'à
la décision des deux gouvernements.
On se mit donc a s'occuper de la
délimitation entre la porte de Chima et Monkay, puis de la région
de Cao-bang jusqu'au Yunnan. Les documents étaient souvent incomplets,
obscurs: le pays n'avait pas en-core été parcouru par nos colonnes,
aussi ce travail était-il aussi long que délicat.
Le colonel
Tisseyre s'en changea d'abord, mais appelé bientôt a Hanoi, prés
du gouverneur. comme commandant de sa maison militaire, il nous quitta dans le
mois de février, et le commandant Bouinais continua, avec M. Hart et l'ingénieur
Li les discussions des documents et l'établissement de la carte.
Pendant
ce temps notre ministre a Pékin, auquel avaient été soumises
par le gouvernement nos réserves au sujet de l'enclave, s'occupait du traité
de commerce et en même temps des rectifications qui pourraient être
laites aux frontières de la Chine et du Tonkin. Le commandant Bouinais
fut envoyé a Pékin pour l'éclairer sur la question des frontières,
et M. Dillon et moi nous restâmes seuls membres de la commission a Monkay.
Le
commandant Bouinais était parti le 16 mars, et le jour de son départ
on avait pu signer un procès-verbal provisoire accompagné de quatre
cartes, avec cette réserve qu'il pourrait y avoir, pour les noms et positions
des villages, postes, passes, montagnes, etc., situés dans le voisinage
de la frontière, des modifications, additions ou suppressions aux cartes
signées en ce jour par les deux délégations.
Le travail,
en effet, était loin d'être achevé, et, aidé par les
deux officiers topographes, MM. Bohin et Hairon, je m'occupai, de concert avec
M Hart et l'ingénieur Li, d'établir les cartes définitives.
Le
29 mars, M. Dillon et moi nous pûmes signer le procès-verbal définitif
de délimitation de toute la frontière des deux Kouangs, moins l'enclave
et la question des îles, qui étaient réservées. La
question des îles Gotow, sur lesquelles nos droits étaient absolument
évidents, ne fut pas résolue sans peine, et ce n'est qu'après
de longues discussions que les commissaires chinois se décidèrent
a abandonner leurs prétentions sur ces îles.
Notre rôle
paraissait être achevé pour le moment, puisque c'était a Pékin
que devaient se décider la question de l'enclave et celle des rectifications
de détail prévues par le traité de Tien-tsin, et qu'il ne
pouvait être question de commencer l'abornement a cette époque de
l'année.
Les chaleurs commençaient a se faire sentir, et les
pluies tombaient déjà en abondance; les fièvres recommencèrent
a sévir parmi nous. Successivement M. Bohin, puis M. Delenda, furent gravement
atteints et durent quitter le Tonkin. Bien que n'ayant plus rien a y faire, M.
Dillon et moi nous fumes maintenus a Monkay.
De nombreux renseignements nous
apprenaient que les Chinois arrivaient de tous côtés. Liu-Vinh-Phoc
levait des troupes sur les frontières, et les bruits d'attaques devenaient
de plus en plus menaçants. Les anciens habitants de Monkay et de l'enclave,
qui avaient fui leurs demeures, faisaient des manifestations près des commissaires
chinois et agitaient toute la région. Cependant nous avions de fortes raisons
de croire que, tant que la commission chinoise resterait dans le pays, aucune
attaque ne se produirait du côté de Mon-kay, et le seul moyen de
retenir nos collègues sur la frontière était d'y rester aussi.
On nous donna donc l'ordre d'attendre a Monkay la fin des négociations
qui se poursuivaient a Pékin.
Ce ne fut qu'a la fin de juin que l'on
nous releva de notre longue et pénible faction, et que nous apprîmes
les décisions prises par le ministre de France a Pékin.
Les îles
Gotow nous restaient, mais l'enclave et le cap Paklung étaient rétrocédés
aux Chinois a titre de rectification de frontière. De ce côté
encore, quoiqu'il nous fut bien pénible de voir céder cette région
pour laquelle nous avions tant combattu, nous n'avions pas absolument perdu notre
peine, puisque c'était grâce aux revendications soutenues par nous
que l'on avait pu faire de la cession de l'enclave une transaction pour le traité
de commerce.
Nos troupes devaient donc évacuer le poste de Paklung et
l'enclave, et, les habitants rentrant chez eux et désormais chinois, l'agitation
allait cesser et notre présence devenait absolument inutile. Nous partîmes
le 26 juin pour Hanoï ; nous emmenions avec nous le père Grand-pierre,
que les services qu'il avait rendus a la commission de délimitation avaient
pu rendre suspect aux Chinois et dont la présence en ces temps troublés
a Chouk-san offrait les plus grands dangers. L'évêque de Canton lui
avait donc donné l'ordre d'aller attendre a Hong-kong que l'apaisement
se fît sur la frontière.
Quelques jours apres, nous apprîmes
que M. Dillon était nommé ministre plénipotentiaire et que
l'abornement était renvoyé a des temps plus propices. Nous quittâmes
le Tonkin, après avoir obtenu du ministère l'autorisation de revenir
par l'Amérique.
Je choisis pour ce retour une ligne qui venait de s'établir
dans le but de faire concurrence a celle de San Francisco. Je pris a Hong-kong
mon billet pour le Havre en passant par le Canada, et après un intéressant
voyage, je débarquai au Havre le 25 juillet, juste deux ans après
notre départ de Marseille.
P. NEIS