
Le
premier poste Français à Carsevenne, d'aprés une photographie

Le
premier poste Français à Carsevenne, d'aprés une photographie
PAR M. GEORGES BROUSSEAU
Nul
n'ignore le différent que soulève entre les gouvernements français
et brésilien, la question de délimitation des frontières
de la Guyane française. Tout un vaste territoire est revendiqué
par les deux pays. Le dernier protocole du 10 avril 1897, signé entre la
France et le Brésil, détermine d'une façon à peu près
précise les limites de ce Territoire contesté.
Au Nord, les Guyanes
anglaise et hollandaise, le Tumuc Humac et l'Oyapoc; à l'Est, l'océan
Atlantique; au Sud, l'Araguary (Aouari, Oyari) jusqu'à sa source, et de
cette source une ligne parallèle à l'Amazone jusqu'au rio Branco
; à l'Ouest, le rio Branco.
Dans ces conditions, il est inutile de retracer
ici l'histoire de la question, il suffit de rappeler sommairement la cause de
la contestation. Elle remonte au traité d'Utrecht, lequel dit en substance
(art. 8) :
" Que la navigation de l'Amazone, ainsi que les deux rives
du fleuve, appartiendront au Portugal, et que la rivière de Japoc ou Vincent
Pinson servira de limite aux deux colonies. "
Malheureusement
1° Pour
les Portugais ou les Brésiliens, la rivière de Japoc ou Vincent
Pinson, c'est l'Oyapock ; pour les Français, l'Araguary. Voilà pour
la limite à la côte;
2° Pour ce qui est de l'intérieur,
les Brésiliens disent que la rive nord de l'Amazone signifie tout le bassin
nord de ce fleuve; les Français disent que la rive seule est brésilienne
et que l'intérieur est français
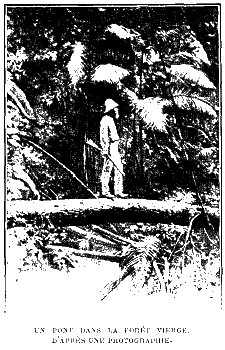 | En
sorte qu'un arbitrage est devenu indispensable pour résoudre un litige
qui remonte à près de deux cents ans. Le Brésil nous a déjà
offert, en 1856, de partager le Territoire contesté en prenant pour limite
le Fleuve Carsevenne ou Calsoène. Mais la Fiancé a refusé
ce partage non justifié, en maintenant ses droits jusqu'à l'Araguary. Il est facile de réduire à néant les prétentions du Brésil en lui prouvant que les mots Oyac, Oyapoc et Oyari sont, en langue indienne, des appellations géographiques communes à toutes les rivières. Oyac veut dire rivière; Oyacqui, petite rivière; Oyapoc, la grosse rivière ; Oyassa. dont on a fait Ouassa et Ouessa, veut dire rivière à droite ; Oyari dont les explorateurs ont fait le Yari, le Jani et Aouari, d'où Araguary, veut dire, indifféremment avec Oyapoc, la grande rivière, la grosse rivière; en conséquence, on ne peut pas en inférer que l'Oyapoc actuel soit précisément le Tapon ou le Japon du traité d'Utrecht. Il faut donc placer la question sur un autre terrain. Par exemple, pour la limite à l'intérieur, il n'est pas possible qu'il soit jamais entré dans l'intention des négociateurs du traité d'Utrecht de vouloir choisir comme limite le cours complet d'un oyapoc quelconque jusqu'à sa source, les rives de ces rivières peuplées d'Indiens rebelles et redoutables étant complètement inconnues en 1713. Ensuite, il tombe sous le bon sens que l'Araguary, dont le cours inférieur connu se dirige de l'Est à l'Ouest, a été pris comme ligne de prolongation d'une limite parallèle à l'Amazone, tandis qu'au contraire l'Oyapoc, qui, lui, a un cours sensiblement perpendiculaire au grand fleuve amazonien, a du naturellement être écarté de la question. D'un autre côté, jamais Vincent Pinson n'a pu avoir de navire coulé par le prororoca au nord de l'île de Maraca, où ce prororoca n'existe pas; et, de toutes façons, laissant le cap du Nord à sa droite, il n'a pu rentrer que dans le canal du nord de l'Amazone, la seule issue qui fût ouverte alors dans cette région. |
Depuis
l'an 1600 environ, commencement de la contestation avec le Portugal, jusqu'à
présent, l'intérieur de cette vaste étendue de territoire
est resté à peu près blanc sur les cartes. Les tracés
les plus fantaisistes ont été donnés par les explorateurs
aux rivières du Contesté, et il a fallu l'importante découverte
des mines d'or de Carsevenne-Cachipour pour remettre à l'ordre du jour
cette contestation, et donner à la question une importance qu'elle n'avait
jamais eue. Cette découverte a eu aussi d'autres résultats en corrigeant
le cours et en déterminant la source de certains fleuves, tels que le Cachipour,
le Counani, le Carsevenne et le Mapa Grande.
Elle nous apprend également
que les sources du Cachipour, que l'explorateur Coudreau croyait avoir découvertes,
dans ses derniers voyages, dans le voisinage de celles de l'Oyapoc, ne peuvent
être aujourd'hui que les sources de l'Araguary, le seul fleuve important
existant entre le Yari et l'Oyapoc. D'un autre côté, des renseignements
dignes de foi, des relevés récents même, nous autorisent à
dire que le cours de I'Araguary, aussi inconnu des diplomates d'aujourd'hui que
de ceux de 1713, se dirige Est-Ouest en partant de l'embouchure, puis tourne ensuite
sensiblement vers le Nord. De plus, l'Araguary, dans son cours supérieur,
se divise en deux branches, et comme l'on ne sait pas encore laquelle des deux
est la plus importante, on peut s'attendre de ce fait à une nouvelle contestation.
Le Brésil ne manquera pas d'affirmer c'est la branche de gauche qui est
le fleuve; et la France soutiendra que la branche de droite est la continuation
naturelle du fleuve l'Araguary. Ne serait-il pas préférable de faire,
s'il en est temps encore, quelques modifications à l'arrangement du 10
avril 1897, modifications qui correspondraient mieux à l'esprit de l'ancien
traité, qui, lui, n'indique que le point de départ à la côte
de la frontière et n'indique pas l'attribution des terres de l'intérieur
et dit seulement que les deux rives de l'Amazone appartiennent au Portugal
?
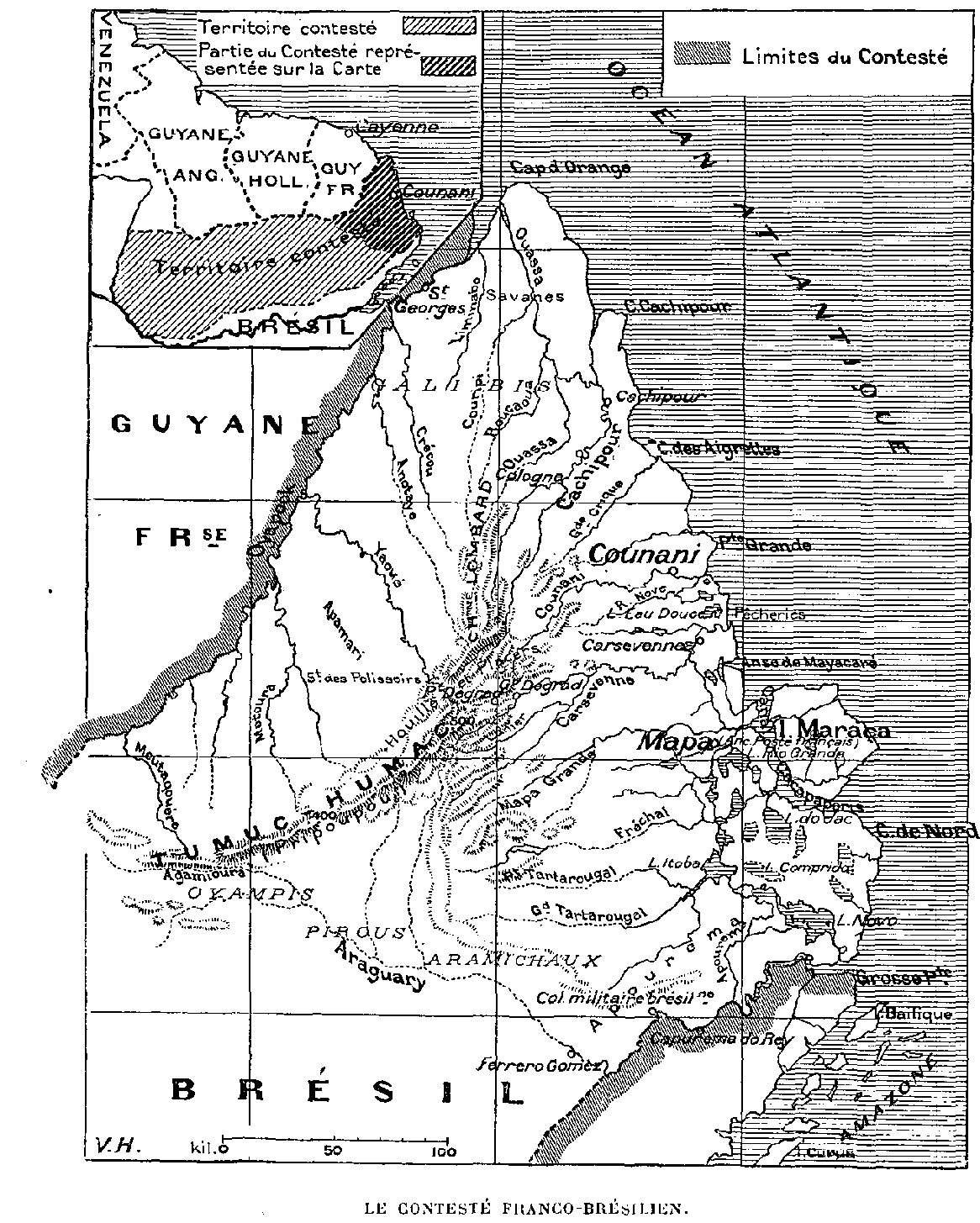
Il
était facile, par exemple, de limiter la frontière inférieure.
L'Araguary depuis son embouchure; une ligne à 200 kilomètres environ
de l'Amazone jusqu'au rio Branco.
A notre humble avis, si cela avait été
possible, il eût mieux valu se réserver sur ce point du cours supérieur
et de la source de l'Araguary encore inconnus. On comprendra l'importance de cette
réserve en jetant les yeux sur une carte et en tirant une ligne de l'embouchure
de l'Araguary, suivant son cours, puis le quittant lorsque ce fleuve tourne au
Nord, et allant rejoindre le rio Branco parallèlement au cours de l'Amazone.
Nous restions ainsi dans l'esprit du traité d'Utrecht, et, cependant, de
vastes et riches régions peuplées d'Indiens et les vastes savanes
du rio Branco, où pullulent les bœufs, nous échapperont certainement
si on limite â l'Araguary jusqu'à sa .source.
La partie littorale
d'entre oyapoc et Araguary compte environ 60 000 kilomètres carrés,
avec près de 450 kilomètres de côte. Les territoires de l'intérieur,
de l'Araguary au rio Branco, mesurent environ 200 000 kilomètres carrés,
soit 260 000 kilomètres carrés pour les territoires que nous conteste
le Brésil, superficie deux fois et demie plus importante que la Guyane
française actuelle.
L'embouchure de l'Araguary nous met aux portes de
l'Amazone, et l'île de Macara, possédant des abris sûrs en
eau profonde, commande, dans une certaine mesure, l'entrée du grand fleuve.
Tout
le pays est merveilleusement arrosé par un grand nombre de fleuves et de
rivières. Le littoral sur l'Atlantique reçoit constamment les vents
alizés du Sud-Est ou du Nord-Est qui apportent la fraîcheur et les
pluies jusque sur les plateaux de l'intérieur. Depuis deux ans le vent
n'a pas soufflé une seule fois de la partie Ouest.
Deux saisons se partagent
l'année : la saison pluvieuse, du 15 février au 15 août, et
la saison sèche, du 15 août au 15 février. La température
moyenne de la journée est de 26 à 27 degrés à la côte,
22 degrés dans les appartements et les montagnes de l'intérieur.
La nuit, il n'est pas rare de voir le thermomètre à 15 degrés,
même à 12 degrés dans les montagnes. Ces données ne
concernent que la région entre l'Oyapoc et l'Araguary. L'état sanitaire
du Contesté est excellent. Aucune des épidémies qui sévissent
au Para et dans l'Amazone, fièvre jaune et variole, n'ont encore apparu
dans le pays. Les vents du large préservent toute la côte. Les maladies
les plus communes sont la fièvre paludéenne et la dysenterie, et
encore n'atteignent-elles que les chercheurs d'or qui vivent de fatigues et de
privations dans les forêts de l'intérieur.
Les maisons doivent
être aérées le plus possible et leur façade principale
exposée à l'Est, de préférence au bord d'une rivière
ou d'un lac. Même en forêt vierge, partout où existe un déboisement
suffisant d'un ou deux hectares, la vie est très possible aux Européens,
et avec quelques travaux de drainage et l'assainissement, les accidents paludéens
ne sont pas à craindre.
Notamment il faut éviter, en forêt
vierge de l'intérieur, de s'établir sur des montagnes ou des mornes.
Plusieurs propriétaires de placers en ont fait l'expérience. Les
ouvriers couchant sur un point élevé étaient toujours atteints
de fièvres, tandis que ceux des ravins ou des plaines demeuraient indemnes.
Porter des vêtements légers, s'abstenir de boissons alcooliques,
boire de l'eau filtrée et faire bouillir son filtre au moins une fois la
semaine sont des précautions hygiéniques indispensables. Avec cela,
bien logé et bien nourri, on n'a pas à craindre l'anémie
et les maladies.
Sur le littoral, on est plus exposé, par suite de la
présence d'une couche de limons provenant en majeure partie du dépôt
des vases de l'Amazone, dont le courant, comme on sait, longe les Guyanes
Ceux
qui ont vu, comma moi, avec quelle abondance se font ces dépôts,
à chaque marée, pendant la saison sèche, ne doivent point
s'étonner de trouver les cartes anciennes en désaccord complet avec
la position des côtes actuelles, qui ne cessent de s'exhausser et de gagner
sans cesse sur l'Océan par les apports successifs de chaque année.
Les fleuves sont obstrués; les lagunes, séparées de la mer,
deviennent en peu de temps des lacs d'eau douce dans l'intérieur.
C'est
ainsi que s'est formée la région des lacs de Mapa à l'Araguary.
Le
voyageur qui, partant de l'Oyapoc, veut traverser le Contesté du Nord au
Sud, doit s'enquérir de canotiers, qui pourront aussi être des porteurs,
et se munir de vivres suffisants pour plusieurs mois. Il doit partir au commencement
de la saison sèche, c'est-à-dire fin juillet ou commencement d'août.
Cinq jours de canotage en remontant le Ouassa, où l'on trouve quelques
rares habitations, l'amènent à la rivière Couripi, l'affluent
de gauche le plus important de ce fleuve.
Nous sommes ici en pays indien :
les rivières ont presque toutes une lisière de forêts, épaisse
quelquefois d'un kilomètre et plus, interrompue de temps à autre
par une échappée qui donne vue sur d'immenses savanes propres à
l'élevage du bétail. Le pays, en grande partie noyé pendant
la saison des pluies, est sec et brûlé à la saison sèche.
Au
milieu de ces immenses lacs qu'on appelle savanes se trouvent des îlots
de terre ferme et fertile; c'est là que l'Indien construit sa case et fait
ses plantations. En hiver, il peut entrer dans sa cuisine avec sa pirogue; mais
il n'en est pas de même en été : ces immenses lacs se vident
et se dessèchent en grande partie, et la moindre étincelle tombée
dans ces herbes sèches allume des incendies qui durent quelquefois des
mois en tiers. S'il arrive que l'on soit surpris par un de ces incendies poussé
par un vent violent, pour éviter d'être brûlé et quasi
asphyxié il faut immédiatement allumer soi-même à ses
pieds un nouvel incendie qui, dévorant de suite un certain espace, vite
refroidi, permet de se garer de l'ouragan de flamme et de fumée qui passe
à droite et à gauche. Pendant l'été, l'Indien quitte
sa case de la savane et vient habiter sous les frais ombrages bordant la rivière.
Il y construit le plus souvent un petit carbet avec ces feuilles de palmier pour
se mettre à l'abri de la fraîcheur des nuits. Le plus souvent, il
ne se donne même pas cette peine; il dort en famille sur des feuilles de
pinot (palmier de marais), sous une grande moustiquaire carrée soutenue
aux quatre coins par des piquets. En cette saison, la vie est douce pour lui:
dormir, manger et boire, se baigner, pêcher, chasser, chanter le soir au
clair de la lune en buvant du cachiri, sont ses occupations favorites.
Après
deux nouveaux jours de navigation on arrive, toujours sur le Ouassa, aux premières
habitations des Indiens Palicours de la rivière Roucawa. Sur la rive gauche,
se trouve un petit système montagneux cri l'on remarque la montagne Soussouris,
nom créole qui veut dire chauve-souris. Comme ce nom l'indique, c'est
le repaire préféré, des vampires.
Les bords de la rivière
sont très fréquentés par les caïmans, et il n'est pas
rare de les rencontrer par bandes tellement nombreuses qu'elles arrêtent
les canots qui vont à la pèche ou à la chasse dans les petits
affluents de droite et de gauche.
Un peu plus haut, c'est, toujours sur la
rive gauche, la montagne Typock et, après la montagne, la rivière
de même nom. 'fout le long de la rivière, sur une tendue de 60 kilomètres
environ, sont disséminées, par petits groupes de trois ou quatre,
les cases des Indiens Galibis. Cette tribu, autrefois très puissante, occupait
tout le littoral depuis Surinam jusqu'au Carapaporis, mais il n'en reste plus
aujourd'hui que quelques débris au Maroni, Mana, Sinnamary, l'Oyapoc et
Ouassa.
Sur la rive droite de l'Ouassa, un peu avant le confluent avec la rivière
Typock, on trouve la crique Macaouane, qui draine les eaux de grands marécages
où pullulent les caïmans et toutes les espèces de gibier d'eau
du pays. Par cette voie, à la saison des pluies, on peut aller en canot
du Ouassa au Cachipour.
Enfin, en remontant toujours le fleuve, à 130
kilomètres environ de son embouchure, on arrive à la montagne Pelade
(pelée), gigantesque monolithe granitique avec minerai de fer dépourvu
de végétation, qui se dresse sur la rive droite. De ce point, en
marchant au Sud pendant trois ou quatre heures, on eut atteindre le Cachipour
en traversant la fameuse savane de Pomme, l'ancien député de la
Guyane française à la Convention. Ici se trouvaient autrefois des
établissements prospères, et les bœufs pullulaient dans ces riches
savanes où le bétail trouvait, en toute saison de gros pâturages
et de l'eau. On aperçoit encore au bord de la rivière les ruines
de ces habitations qui furent pillées et ruinées par les Portugais
pendant les guerres de la Révolution.
A Cachipour, l'aspect change;
les habitants sont, en majorité, des Brésiliens et métis.
Les habitations sont séparées le long du fleuve par de vastes espaces.
Peu de savanes, et d'ailleurs impropres à l'élevage, aussi peu ou
point de bétail. Cependant, on peut trouver à s'y approvisionner
de couac (farine de manioc), bananes et poisson sec. La population a été
considérablement augmentée en ces derniers temps par les soi-disant
colons et. travailleurs de colonisation qu'une compagnie brésilienne subventionnée
y a introduits. Cette compagnie a fondé un établissement nommé
Cologne, sur un plateau de la rive gauche du fleuve.
La région du Cachipour
est très riche en or; des découvertes récentes viennent d'y
être faites, et on peut prévoir et prédire l'avenir prospère
et certain qui s'y prépare.
De Cachipour, un petit sentier à
travers la fora conduit en doux jours à Counani. Counani est un bourg florissant
de. 350 habitants, situé sur la rive gauche du fleuve de ce nom, à
22 kilomètres environ de son embouchure. II y a un quai ombragé
de beaux manguiers avec appontement au débarcadère. Une église
assez bien entretenue et quelques maisons à planchers couvertes en tôle
métallique ont un aspect assez confortable. Quelques-unes sont de véritables
magasins de commerce où l'on trouve un peu de tout, comme à Cayenne.
Dans
la rivière, à un et deux jours de canotage, on trouve d'assez belles
habitations où l'on fabrique du couac, voire un peu de caoutchouc. On exploite
aussi des bois de construction et d'ébénisterie ; on y peut acheter
du machoiran salé et du poisson sec en abondance. L'élevage du bétail
n'y réussit pas, parce que les savanes de Counani ne sont pas doubles,
comme on dit dans le pays; elles sont trop sèches ou trop noyées.
Quant
à la fameuse cacaoyère des Pères Jésuites, dont M.
Coudreau a fait une description exagérée, elle est située
à deux heures de canot en amont du village sur la rive droite. Il en reste
encore pas mal de pieds sur une longueur de 400 à 500 mètres et
une moyenne de 60 à 70 mètres de largeur. Les plants, énormes
et très vieux, portent encore des fruits, malgré les lianes elles
plantes parasites qui les dévorent.
Deux fois par mois, à chaque
quartier de lune, un vapeur brésilien subventionné vient directement
du Para à Counani, faisant escale an retour à Carsevenne et à
I1 lapa, et une fois par mois, à l'aller, à l'Araguary. A partir
d'ici, le voyage est facile et l'on est presque en pays civilisé.
Plus
au Sud, entre Counani et Carsevenne, se trouvent les belles savanes de la Nouvelle
Rivière (rie Nove), dont une branche se jette dans un vaste lac d'eau douce
et une autre se perd dans les sables et les marais avant d'arriver à la
mer. On peut, à le rigueur, à la belle saison, traverser à
pied cet espace de 45 à 50 kilomètres qui sépare les deux
fleuves en deux ou trois jours de marche; mais il y a peu de guides qui connaissent
cette route, et les plus malins se perdent, même avec une boussole, dans
ces plaines herbeuses toutes pareilles, coupées de toutes parts par des
bouquets de verdure, également pareils, et par des rivières aux
sinueux contours.
Le voyage par mer de Counani à Carsevenne avec un
grand canot peut, s'il y a bon vent, se faire en une seule journée. Le
Carsevenne est. un fleuve un peu plus fort que notre Charente. Son embouchure
est large et spacieuse, mais tortueuse et complètement cachée à
la vue du. large. De plus, elle est obstruée par des bancs de sable et
de vase rendant la navigation difficile. Heureux pays de chasse et de pèche
où pullulent les palmipèdes et les échassiers, côte
à côte sur le même banc de vase ou le même tronc d'arbre
mort, où on les voit perchés pôle-môle depuis la petite
alouette de mer, la bécassine et le chevalier, jusqu'au grand jacobin au
bec énorme.
Comme dans toutes les autres rivières du Contesté,
ce sont d'abord des rives marécageuses couvertes de palétuviers,
puis des palmiers en grand nombre avec des campas, des palétuviers rouges
et des bois plus durs, précieux pour les constructions et l'ébénisterie.
Les aras bleus et rouges, les perroquets verts et bleus, les perruches, les toucans,
les ibis éclatants couleur de pourpre et les aigrettes plus blanches que
l'hermine remplissent de bruit, de mouvement et de poésie les rives du
fleuve enchanté qui conduit aux mines d'or.
Avant la découverte
de l'or, Carsevenne n'avait que 45 à 50 habitants disséminés
dans cinq ou six habitations situées sur la rive du fleuve, auprès
de vastes savanes propres à l'élevage sur un espace de 45 kilomètres
environ. Aujourd'hui, depuis 1894, cela a bien changé : le bourg principal,
situé à 24 kilomètres de l'embouchure, en face de la seconde
chute, possède plus de 100 cases, presque toutes rebâties à
neuf après l'incendie du 28 septembre 1897 qui le dévora presque
en entier. Quelques-unes de ces cases sont à étage, et presque toutes
sont habitées par des commerçants français et quelques Anglais.
Il
est bien malheureux de constater ici qu'aucune autorité, sinon le caprice
plus ou moins fantasque des habitants, n'ait présidé à l'établissement
de ce bourg important, pour faire au moins aligner les rues et les places et laisser
entre elles un espace suffisant. Les maisons de bois, disparates, en désordre,
ont l'air de se pousser et de se bousculer le long de petites rues tortueuses
et trop étroites, dans le voisinage immédiat du débarcadère.
Il en résulte de graves inconvénients pour l'état sanitaire
de la population, sans compter qu'une simple étincelle, comme en 1897,
a pu embraser en quelques heures tout le groupe central du village.
Les vapeurs
et navires ne calant pas plus de 2,80 à 3 mètres peuvent venir mouiller
en face du bourg, où le transbordement et le débarquement se font
facilement à l'aide d'embarcations.
Le village de Firmine, en face,
rive gauche, compte une vingtaine de cases où habitent principalement les
métis du pays et les Brésiliens, 60 environ. La population totale
des deux rives atteint 500 habitants. A 50 kilomètres de l'embouchure on
ne trouve plus de savanes; la forêt vierge règne en maîtresse
avec ses hôtes mystérieux, couvrant de sa ténébreuse
humidité des débris organiques de toutes sortes où grouillent
des milliers de mondes d'animalcules vivant de la putréfaction.
A 100
kilomètres à vol d'oiseau, à 150 au moins par la rivière,
se trouve le Grand-Dégrad, village assez important, où se fait le
transbordement des marchandises pour le Petit-Dégrad, distant de 13 kilomètres.
Le
Petit-Dégrad est le point le plus peuplé de l'intérieur;
on y compte encore aujourd'hui 250 à 300 cases et de 600 à 700 habitants,
suivant la saison. C'est, dans le bois à peine éclairci, sous les
grands arbres au bord d'une petite rivière (ici on dit crique) de 7 à
8 mètres de large, encore navigable pour les petits canots et les pirogues,
des cases disséminées, sans ordre, de ci de là, parfois agglomérées
par 4 ou 5 avec un embryon de rue. Quelques coins de ce campement cosmopolite
sont tenus avec soin par leurs propriétaires premiers occupants. Nous sommes
heureux de constater que ce sont pour la plupart des Français.
Du Petit-Dégrad
part l'unique sentier qui conduit aux placers. it s'enfonce à l'ouest de
la forêt vierge sur une longueur de 35 à 40 kilomètres et
franchit ou contourne 32 montagnes peu hantes 250, 300 et 400 mètres d'altitude,
mais quelques-unes presque à pic. Quand le sol de glaise rouge sur les
pentes est détrempé par les pluies, on redescend souvent sans le
vouloir la montée gluante et glissante quo l'on a eu tant de peine à
gravir. Autre agrément: il y a entre deux montagnes des marécages
où l'on enfonce jusqu'au ventre.
Malgré tout, les ravitaillements
de 1 500 à 2000 mineurs se font par cet unique sentier à dos d'hommes,
et une charge de 20 à 25 kilos coûte encore 6 grammes et 8 grammes
d'or, pour aller au fond, disent les mineurs. Au beau temps du rush, le transport
d'une charge du Petit-Dégrad aux placers se payait 60 grammes d'or, une
boîte de sardines coûtait 10 grammes, une boite de lait 20 grammes,
et j'ai acheté au mois d'août 1894, au Grand Placer, un quart de
bouillon gras en bouteille, 15 grammes d'or. Le reste était à l'avenant.
Aujourd'hui les prix sont à peu près raisonnables : une boîte
de lait coûte un gramme, un pain d'une livre un gramme, deux boites de sardines
un gramme, etc..
Le voyage du bourg de Carsevenne au Grand-Dégrad se
fait en cinq ou six jours, au moyen de pirogues ou de canots créoles pouvant
porter chacun de une à deux tonnes de marchandises, suivant la saison.
Ce voyage d'aller coûte 35 francs par 100 kilos et par passager ayant droit
d'apporter avec lui son pagara ou une petite malle. Le voyage de retour
ne coûte que 15 ou 20 francs par passager et peut se faire en deux jours
et demi, trois jours au plus.
Au sud de Carsevenne se trouve la plus belle
et la plus importante région du Contesté. C'est ici qu'est l'avenir.
Cette région peut nourrir plus d'un million de colons pêcheurs, agriculteurs,
éleveurs et mineurs.
Là, en effet, tout est préparé
pour recevoir des habitants ; pas de routes à faire, elles existent ; les
lacs pullulent de gibier et de poisson ainsi que les mille canaux qui les relient;
pas de défrichement ou presque pas ; les savanes sont immenses et fertiles
et nourrissent déjà une race de bœufs très appréciés
au Brésil et à Cayenne. Les chevaux et les moutons s'y acclimatent
très facilement.
De Carsevenne on peut aller à Mapa par les savanes
de Trapide, situées à quelques lieues en amont du village, mais
il vaut mieux aller par mer. Si le vent est favorable, en douze heures on arrive
au mouillage des vapeurs, à la Croix de Mapa (5 mètres d'eau à
marée basse). On nomme ainsi l'intersection de quatre branches d'une rivière.
Au
Nord de la Croix de Mapa se trouve le Mapa Grande, qui mêle ses eaux à
son embouchure avec toutes ces rivières. C'est dans le Mapa Grande, rive
gauche, en face de la première chute, à un kilomètre de l'habitation
de Pedro de Freitas, qu'on voit un monticule surmonté des ruines d'un tombeau
construit en pierres granitiques colossales et taillées. On y a trouvé
des urnes remplies de cendres analogues à celles trouvées dans les
sépultures indiennes.
De la Croix de Mapa on arrive au chef-lieu en
une heure de canotage. Mapa est un village d'une cinquantaine de cases, avec une
église et un blockhaus construit par Cabrai. Une vingtaine de maisons sont
planchéiées et fermées sur les côtés. Il y a
deux grandes rues principales, larges de plus de 10 mètres, et les cases
sont séparées les unes des autres. L'une de ces rues est parallèle
à la rivière et l'autre perpendiculaire à la première.
Toutes deux sont situées sur deux langues de terre rouge, entourées
de tous côtés par la vase et les palétuviers, excepté
sur un seul point où passe le sentier qui rejoint, 15 kilomètres
plus loin, la branche du Maragnan à l'habitation Thomé.
En partant
de Mapa, de quelque côté que se dirige le voyageur, il trouvera partout
des habitations prospères, et la pêche et la chasse ne le laisseront
jamais manquer du nécessaire.
Plusieurs sentiers traversent le pays
depuis Mapa, et, en remontant vers les campos grandos, savanes à
bœufs de l'intérieur, on peut aller en cinq jours par terre jusqu'à
l'Apuréma. Par l'Apuréma, la région la plus riche en savanes
et en bétail, nous touchons à l'Araguary. C'est aussi la partie
la plus prospère sinon la plus peuplée du Contesté. Dans
les campos coupés de petits cours d'eau aux rives boisées de ci
de là, le voyageur qui suit un des nombreux sentiers du pays aperçoit,
au milieu de la savane, un petit morne ombragé de grands arbres et d'autres
plus petits, arbres fruitiers pour la plupart : manguiers, orangers, citronniers,
goyaviers, bananiers, etc.., au milieu desquels se dissimule l'habitation ou fazenda
du fazendeiro ou éleveur du campe. Le voyageur inconnu y trouvera
toujours la plus franche et la plus cordiale hospitalité.
En dehors
du lait frais, du fromage, des volailles et des roufs, des cochons vivant en liberté,
des moutons dont le fazendeiro peut user à volonté, ses vaqueros
à cheval, qui surveillent le jour les grands troupeaux de bœufs, lui
apportent à leur rentrée, chaque soir, un approvisionnement de gibier
suffisant qu'ils ont eu le loisir de tuer dans leurs longues courses de la journée.
A la tombée de la nuit, les vaches nourrices et leurs petits rentrent au
parc près de l'habitation, où elles sont plus à l'abri des
attaques des jaguars.
Après le repas du soir et la prière qui
se fait en commun, clans la nuit douce et parfumée, au clair de lune, commencent
les réjouissances: les danses et les chants accompagnés du violon,
du rebec, de lamandoline et de la clarinette. Nombreux sont les saints du calendrier
ainsi fêtés, jusque bien avant dans la nuit. Les soirs moroses, de
pluie ou d'orage, assis cu cercle dans la salle commune, les fazendeiros, leurs
vaqueros et leurs femmes aiment à conter leurs aventures de chasse ou de
pêche, au des histoires plus tragiques sur les ladies bravos, le
diable et les sorciers.
Tel est, dans ses grandes lignes, l'aspect général
du pays compris entre l'Oyapoc et l'Araguary. Ce dernier fleuve est de beaucoup
le plus important des Guyanes ; son débit est bien supérieur à
celui du Maroni et les vapeurs y remontent à plus de 200 kilomètres
dans l'intérieur jusqu'à Ferrera Gomez, village situé sur
la rive droite, de formation récente et d'avenir certain, où se
centralise le caoutchouc, de plus en plus exploité, de plus en plus abondant,
que l'on récolte dans le bassin de l'Araguary.
La population d'entre
Oyapoc et Araguary peut s'évaluer à 7650 âmes.
Fuyant les
conquistadores et après eux les cruautés des Portugais, toutes les
tribus indiennes de l'Amazone se sont réfugiées vers les montagnes
centrales, entre les sources de l'Oyapoc et de l'Araguary et le haut rio Branco.
Je ne crains pas d'évaluer au moins à 120 000 le nombre total des
indigènes du Territoire contesté.
Si l'on ajoute à cela
que de puissantes compagnies, auxquelles le Brésil a concédé
entièrement, au mépris des traités, le Jan, le Parou, le
Jamunda, le Trumbettas, etc.., exploitent avec de nombreux ouvriers les arbres
à caoutchouc très abondants dans les forêts avoisinant ces
grandes rivières et leurs affluents; ensuite les éleveurs des vastes
prairies du rio Branco, on aura une idée de l'importance de cet immense
territoire encore vierge où dorment tant de richesses naturelles, comme
le caoutchouc et l'or.
Comme partout ailleurs, il est nécessaire que
le colon dispose d'un petit capital. Il arrivera dans la Nouvelle-Guyane avec
un stock de marchandises, parmi lesquelles il faut mettre au premier rang : le
tafia, le vin, la farine, les tissus (toile bleue, toile blanche, cotonnades,
indiennes, mouchoirs, paliacas, broderies à bon marché), saindoux
en boîtes de 5 kilos, 1 kilo et 1/2 kilo, beurre. sucre en boîtes,
huile d'olive, savon, lait concentré, biscuits en caisses, chapeaux de
laine et de paille, quelques outils, pioches, pelles, houes, sabres d'abatis,
haches américaines, fusils de chasse, poudre, plomb et cartouches, quinine
et médicaments, etc..
Avec cela, la vie du colon sera douce ; dès
son arrivée il réalisera de beaux bénéfices, et en
toute sécurité il pourra procéder, tout en pêchant
et en chassant, à une plus importante installation dans l'avenir.
En
tête des principales productions se trouve l'or. La seule région
jusqu'ici exploitée et connue de Carsevenne-Cachipour (30 kilomètres
carrés environ) donne une moyenne de 100 kilos par mois.
L'approvisionnement
des commerçants et chercheurs d'or de Carsevenne nécessite une consommation
mensuelle d'environ 200 tonneaux de provisions de toute nature, qui arrivent de
Cayenne tous les mois ou en transit des autres pays. Cc tonnage tend tous les
jours à augmenter, car les autres centres du Contesté viennent de
plus en plus échanger leurs produits et s'approvisionner à Carsevenne.
En outre des caboteurs, deux vapeurs font le service entre Cayenne et Carsevenne,
et un autre vapeur brésilien, subventionné celui-là, fait
la ligne du Para, Araguary, Counani, Carsevenne, Mapa, deux fois par mois à
chaque quartier de lune, pour éviter le prororoca du cap du Nord,
très dangereux au temps des fortes marées. Aucun navire ne se risque,
à la pleine ou à la nouvelle lune, dans les parages de l'embouchure
de l'Araguary au Carapaporis.
Ensuite viennent : le caoutchouc, très
abondant et reconnu de première qualité, au Para; les bœufs et les
moutons, dont nous avons déjà parlé ; les chevaux et les
cochons; la pêche sur la côte, qui fait vivre plus de 2 000 pêcheurs
et occupe 200 à 250 bateaux tapouyes, revenant après chaque saison
au Para avec 1000 tonnes de poisson sec; la pêche dans les lacs, très
productive avec une espèce de morue acclimatée dans l'eau douce
et qu'on nomme acry et piraroucou; les bois de construction et d'ébénisterie
et surtout le wapa (ouapa), bois résineux qui ne pourrit ni dans
la terre, ni dans l'eau, et qui servirait avantageusement pour le pavage en bois
de nos rues; la farine de manioc ou couac, les bananes, le café, le cacao,
qui ne demande même pas une grosse main d'oeuvre, le maïs, le tabac,
la canne à sucre, etc..; pour l'avenir, les campas et les calatas
qui poussent au bord des rivières, servant de bordure aux savanes,
sinon en familles, mais assez rapprochés pour être facilement exploités.
Le
Territoire contesté possède environ 90000 kilomètres carrés
de savanes et de prairies, à peu près 40000 sur la rive gauche du
rie Branco et 10000 dans la région intermédiaire. Les savanes et
les prairies de l'intérieur sont saines; leur climat tempéré
et sec, un peu semblable au climat de l'Algérie, convient à la colonisation
européenne.
La région de Mapa et des lacs surtout semble plus
particulièrement désignée pour devenir une région
de peuplement, pouvant nourrir plus d'un million d'habitants. lei, en effet, peu
ou point de routes à construire, elles existent; dans les lacs et les nombreux
canaux qui les relient, point de travaux préparatoires pénibles
et malsains, dessèchements ou défrichements. Le colon des prairies
sera avant tout un éleveur, ce qui le dispensera de remuer la terre. Ensuite,
la plupart de ses cultures industrielles, café, cacao, coucou, tabac, coton,
se contentant des terres légères du pays, pourront être faites
en savane. Avec un petit capital, il pourra s'installer et trouvera tout de suite
on abondance, pour son alimentation, poisson et viande de bœuf à bon marché.
La région possède aujourd'hui 40 000 têtes de bétail,
sans compter les chevaux et les moutons. Le kilo de viande y coûte 0fr.50
au détail. Sur pied, avec marchandises d'échange, tafia, vin, farine,
tissus, etc., le kilo de viande y revient à 20 ou 25 centimes.
En résumé,
établissement facile, climat relativement tempéré, pêche
et chasse abondantes, nourriture confortable, voilà réunis les éléments
nécessaires, indispensables à la prospérité de toute
colonisation.
Des prospections anciennes ont signalé la présence
de l'or un peu partout dans le Territoire contesté, et des prospections
récentes ont donné des résultats satisfaisants qui permettent
d'espérer mieux pour l'avenir.
Visible ou invisible dans le quartz,
l'or natif est à peu près pur mélangé à un
peu d'argent, mais jamais ce dernier métal n'a dépassé la
proportion de 7 % dans les Guyanes, et à Carsevenne-Cachipour
3 à 4 %. Quoiqu'il n'y ait eu encore aucune étude sérieuse
en profondeur, la richesse des filons est incontestable pour les endroits où,
comme à Carsevenne, les alluvions ont une telle richesse uniforme et résultent
de la destruction presque sur place d'une infime partie de ces filons.
Les
criques Tamba, Laurens, Sannemougou, Onémark et leurs branches forment
ou comprennent une région de plusieurs kilomètres carrés
de surface où la richesse de la couche alluvionnaire se maintient à
peu près égale partout. Et, de cette richesse, nous pouvons en inférer
sans crainte que les sept à hait montagnes, qui composent ce que nous appelons
le Grand Placer, portent clans leurs flancs des richesses incalculables.
En
effet, quelle étude de géologue, quel travail d'ingénieur
secondé par des milliers d'ouvriers, quelle analyse de chimiste auraient
pu, mieux que l'érosion clos eaux et de l'atmosphère aidant à
la décomposition des roches pendant des milliers de siècles, mettre
à jour la preuve palpable de tant de richesses.
Le critérium
de la richesse filonienne est là tout entier, et nous n'avons pas besoin
d'autre preuves pour affirmer l'existence de ces richesses ?
En somme, comme
on le voit, le Contesté vaut qu'on s'en occupe sérieusement, et
vouloir l'abandonner ou s'en désintéresser serait une faute grave.
Depuis longtemps ses richesses ont excité les convoitises da Brésil
et avant lai du Portugal. Aussi ne faut-il pas trop s'étonner, en lisant
les protocoles résumant l'histoire des négociations échangées
avec la France à propos du Contesté, de voir nos adversaires éluder
presque toujours la question, espérant à la longue occuper pied
à pied la région en litige.
Espérons que, cette fois,
la dernière commission militaire dirigée par le commandant Drageon,
commissaire da gouvernement, pourra s'entendre avec une commission brésilienne
pareille à la nôtre, ayant les mêmes instructions sur le territoire
môme du litige.
Le Territoire contesté offre à la colonisation,
au commerce et à l'industrie françaises des débouchés
et des garanties plus que suffisants au point de vue des conditions climatologiques,
de la richesse de ses mines, de ses pêcheries et de la facilité avec
laquelle prospèrent déjà l'élevage des bestiaux et
les quelques cultures que l'on y a essayées, pour que dès le débat,
immédiatement, nous paissions en retirer de beaux bénéfices.
Pour
nous, nous croyons fermement à l'avenir de la nouvelle Guyane, et nous
attendons avec confiance la décision de l'arbitre qui doit rétablir
nos droits incontestables à la possession de ce pays si riche que d'anciens
gouvernants trop pessimistes ou mal renseignés avaient pour ainsi dire
laissé déchoir.
Georges BROUSSEAU.
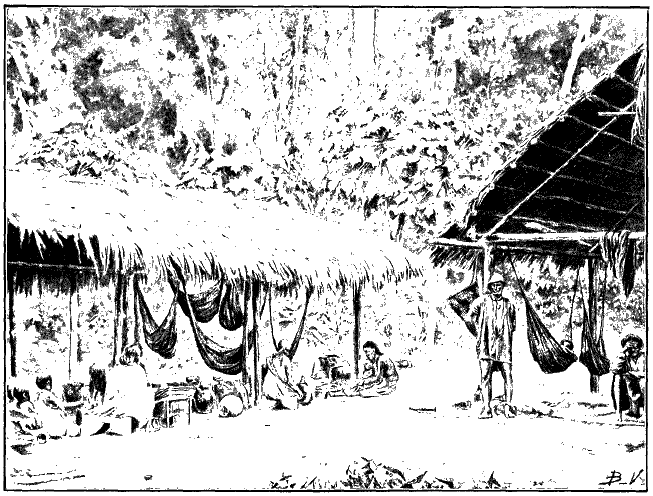
Indiens
Galibis de l'ouassa - d'aprés une photographie
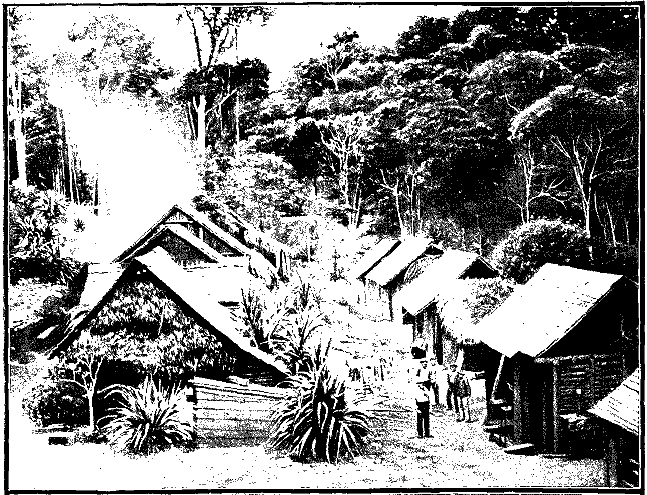
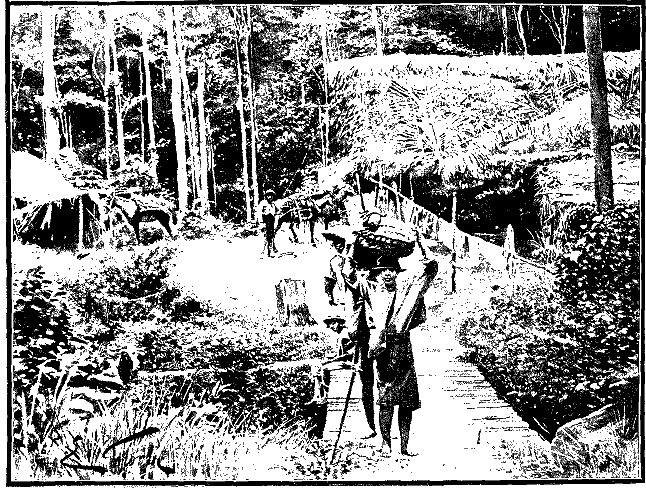
Cases
de mineurs, groupe de porteurs, d'aprés photographie
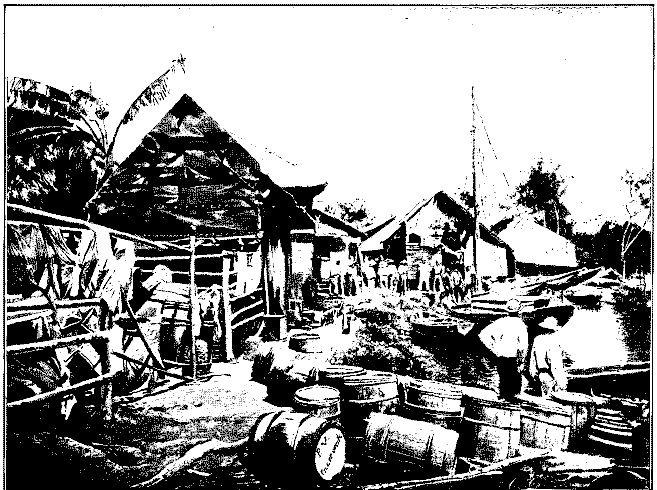
Le
quai de Carsevenne, d'aprés une photographie