

VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'INTÉRIEUR DES GUYANES
PAR LE DOCTEUR JULES CREVAUX, MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE FRANÇAISE.
1876-1877. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.
I
CAYENNE. - LES ÎLES DU SALUT.
Départ. — But du voyage. — Mauvaise nouvelle. — Marie Clo-Clo. — Aspect de Cayenne. — Séjour à l'îlet de la Mire. — Maigre ordinaire : repas de sarigues. — Sababodi. — Retour à Cayenne. — Mgr Emonet. — La montagne de Bourda. — Les Iles du Salut. — Plantes. — Oiseaux. — Polissoirs des Indiens. — Le R. P. Kroenner.
Chargé, par les ministres de l'Instruction publique et
de la Marine, d'une mission ayant pour but l'exploration de l'intérieur de la
Guyane française, je quitte Saint-Nazaire le 7 décembre 1876, à bord du Saint-Germain.
Mon projet est de remonter le fleuve Maroni jusqu'à sa source pour arriver à
une chaîne de montagnes : les monts Tumuc-Humac, où les anciens géographes
plaçaient le pays légendaire de l'Eldorado.
Nous essuyons d'abord quelques jours de mauvais temps sur les côtes de France,
mais le reste de la traversée est des plus agréables.
Le 29, au lever du soleil, l'officier de quart me montre une échancrure dans
la côte du continent américain : c'est l'embouchure du fleuve que je viens explorer,
le Maroni. Quelques heures plus tard nous abordons aux Iles du Salut.
Messieurs les médecins, soyez les bienvenus, nous dit le commandant des îles,
la fièvre jaune vient de faire son apparition à Cayenne. Depuis le dernier courrier,
c'est-à-dire depuis un mois, il est mort un médecin, un magistrat et deux ingénieurs.
» Nous atteignons la rade de Cayenne vers cinq heures du soir.
Je m'installe chez une créole de la Martinique qui a la spécialité de loger
les médecins : c'est Marie Clotilde, plus connue sous le nom de Marie Clo-Clo
Cayenne s'est notablement agrandi depuis mon premier voyage en 1869 et 1870.
L'animation y est plus grande. On y respire un air de fête continuel; et la
raison en est bien simple : c'est que les noirs trop impatients ne peuvent pas
attendre jusqu'au dimanche pour dépenser les grosses pièces de cinq francs qu'ils
gagnent depuis quelques années à l'exploitation des gisements aurifères.
Le surlendemain, à sept heures du matin,
on me donne l'ordre de faire partie d'une commission chargée de visiter un convoi
de coulies, c'est-à-dire de travailleurs arrivant des Indes sur un navire anglais.
Un vapeur de la station, l'Alecton, est chargé de nous transporter au
large, en dehors de la barre qui empêche les gros navires d'entrer en rade.
On nous apprend qu'une épidémie de typhus sévit à bord, ce qui me détermine
à renvoyer sur l'Alecton, de ma propre initiative, les membres de la
commission dont je fais partie, et à rester seul sur le navire étranger pour
donner mes soins aux malades.
Je fais ensuite débarquer le plus grand nombre des passagers à l'îlet de la
Mère, dans les bâtiments de l'ancien pénitencier. Cette petite île, que j'avais
remarquée lors de mon premier voyage à la Guyane, est d'un aspect fort pittoresque
et d'un séjour assez enchanteur pour qu'un de mes collègues y soit resté pendant
deux ans, sans demander son rappel à la capitale. .
Aujourd'hui l'îlet de la Mère n'est plus habité que par un surveillant et quatre
transportés invalides chargés de l'entretien des bâtiments abandonnés.
Mon devoir me prescrivait de séjourner dans l'îlet; je m'y établis chez un capitaine
anglais, qui consentit à me nourrir, mais fort mal, à raison de dix francs par
jour. Heureusement la brave femme du surveillant, qui avait servi autrefois
au buffet de la gare de Dijon, trouva moyen de relever ce maigre ordinaire avec
quelques plats à sa façon, composés de bulcines, espèce de gros escargots assez
communs dans le pays, et d'iguanes que mon petit coulie allait chercher sur
les roches de l'île. Ce futur compagnon de voyage, inscrit sur la liste des
immigrants sous le nom de Sababodi ou Saba, avait un goût très prononcé pour
la chasse. Il prit en quelques jours, au moyen de trappes, une dizaine de sarigues,
qui pouvaient au besoin servir à notre alimentation. On sait que ces petits
mammifères, qui ont une certaine ressemblance avec le rat, se font remarquer
par la poche dans laquelle la femelle porte ses petits. Le sac est soutenu par
deux os que les naturalistes désignent sous le nom de marsupiaux.
Après douze jours, l'épidémie s'étant complètement arrêtée par le simple effet
du transbordement des passagers, le médecin de la santé vint m'annoncer que
j'avais la « libre pratique. » Ce n'est pas sans plaisir que je reviens à Cayenne.
Le lendemain, les coulies transportés à terre sont groupés par lots de trois
ou quatre personnes et adjugés aux agriculteurs et industriels de la colonie.
J'obtiens des autorités que le jeune Sabàbodi ne soit pas compris clans cette
répartition. Cet enfant m'est délivré contre la somme de cent trente-sept francs
pour une période de cinq années. Les conditions de l'administration portent
en outre que j'aurai à le nourrir et à lui donner cinq francs par mois jusqu'au
montent où il sera adulte.
En fréquentant les salons du gouvernement, où je reçois un accueil des plus
sympathiques[1], j'apprends que
le préfet apostolique de la Guyane française, Mgr Emonet, est un voyageur intrépide
.
Ce missionnaire à fait, l'année précédente, un voyage de quarante-trois jours
dans l'Oyapock pour prêcher la foi aux sauvages de l’intérieur.
Il sait déjà que je me dispose à faire un voyage d'exploration, et il me dit
simplement :
« Voulez-vous un compagnon ?
— J'accepte, lui répondis-je ; quand partirons nous ?
— Quand vous voudrez, » me dit-il.
En attendant le départ, je fais quelques excursions aux environs de Cayenne.
Je loue un nègre, et me munis d'un fusil de quinze francs acheté pour la circonstance.
Je reconnais les endroits où me sont arrivées quelques aventures. C'est ici
que j'ai failli périr dans la vase en poursuivant une aigrette « au panache
de colonel ». C'est là que, près de cocotiers, ayant voulu tirer un perroquet,
mon fusil éclata, sans me faire heureusement plus de mal qu'une minime blessure
à l’oeil.
Je revois surtout avec plaisir la petite montagne de Bourda, au pied de laquelle
s'élève un superbe chalet, maison de plaisance du gouverneur.
J'allai ensuite aux Iles du Salut, situées à trois heures
de Cayenne, et qui sont au nombre de trois : l'île Royale, l'île du Diable et
l'île de Saint-Joseph..
Mon séjour dans ces îles ne fut pas de moins de six mois : la fièvre jaune s'y
déclara, et je faillis moi-même en être une victime
[2] .
Je note qu'il faut à peine le temps de fumer un petit cigare pour faire le tour
de l'île Royale, qui est la plus considérable des trois .
Pendant les quelques journées où l'état sanitaire des officiers et des soldats
fut satisfaisant, je pus explorer la rivière de Kourou sur le vapeur le Serpent
chargé du service hydrographique. J'ai récolté cinq cents espèces de plantes
sur les bords de cette rivière et dans des excursions sur la montagne des Pères
et sur le Mont Pelé.
La pêche n'est pas très productive aux Iles du Salut. Je prenais quelquefois
des langoustes _et des glands de mer quand j'allais recueillir des algues marines
au chenal qui sépare l'île Saint-Joseph de l'île du Diable.
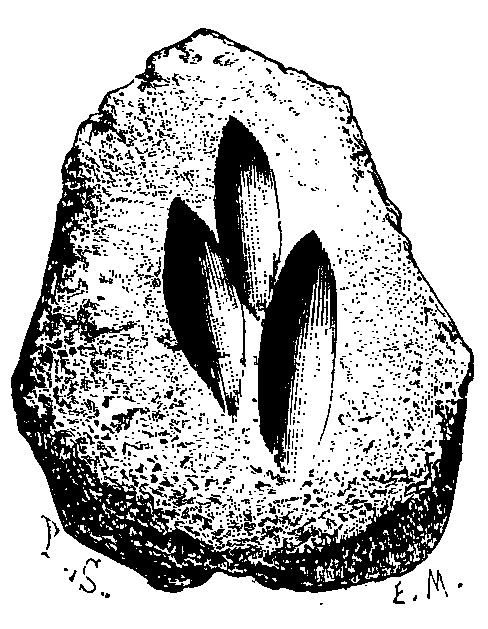 Polissoirs. — Dessin de P. Sellier. |
Dans une de nos promenades, je remarquedes rainures
polies dans les roches de la partie basse de l'île, et je reconnais qu'il s'agit
de polissoirs présentant la plus grande analogie avec ceux que l'on a trouvés
dans des fouilles faites aux environs d'Amiens et qui datent de l'âge de pierre.
Les rainures ont été produites par l'usure des pointes de flèches, et des tranchants
de haches en pierre dont se servaient les Indiens qui peuplaient ces îles avant
l'invasion des Européens en Amérique. On voit à côté de ces rainures des surfaces
planes polies et des excavations en forme d'assiette qui proviennent sans doute
de l'usure des faces de leurs armes tranchantes et particulièrement des haches
.
Le capitaine d'un « charbonnier » qui retourne au Havre veut bien se charger
de transporter en France deux énormes polissoirs que je lui remets à l'adresse
du ministère de l'Instruction publique .
Lorsque je revins à Cayenne, on était près de la fin de la saison des pluies;
et je n'avais que peu de temps pour préparer mon départ.
Un curé de Mana, le R. P. Kroenner, offrit de m'accompagner : il avait déjà
remonté le fleuve Maroni jusqu'à l'Itany, dans la région habitée par les Indiens
Roucouyennes.
Saba se hâta d'apprendre un peu de cuisine au restaurant où j'avais pris pension
avec plusieurs officiers.
II
DE CAYENNE A COTICA .
Les Indiens engagés nous font faux bond. — Industrie. — Quelques étymologies. — M. Littré et le mot hamac. — l'illustre capitaine Bastien. — Une visite au champ des morts. — Discussion médicale. — En route. — Le saut Hermina. — Les haches en pierre, détails de fabrication.— Difficultés de la navigation dans les sauts. — Hydrographie.— Acodi en révolte. — La forêt des Guyanes. — La forêt vierge .— Les Paramakas. — Invasion des fourmis. — Le saut de Manbari. — L'Aoua et le Tapanahoni. — La saison des pluies .— Les rapides et les sauts. — Les Poligoudoux, les Bosch, les Youcas.
9 juillet 1877. Le Serpent est chargé de nous
transporter jusqu'au pénitencier de Saint-Laurent, situé près de l'embouchure
du fleuve Maroni.
Le départ est fixé à deux heures. En arrivant à bord, je trouve Mgr Emonet et
Sababodi, mais je m'aperçois que deux noirs que j'ai engagés ne sont pas encore
rendus à bord du vapeur. Ces hommes, sur lesquels je comptais, s'étant attardés
à faire leurs adieux, arrivent à l'embarcadère au moment où le capitaine commande
: « Machine en avant ! » C'est en vain qu'ils nous font des signes de détresse
et s'efforcent de nous atteindre dans une pirogue : le Serpent ne s'arrête
pas.
Ce contretemps m'impressionne péniblement : une minute de retard me fait
perdre un homme habile et très robuste qui aurait pu me rendre de grands services.
Le bateau devant faire du charbon aux Iles du Salut, nous avons l'occasion de
passer une partie de la soirée à l'île Royale. L'aide pharmacien Bourdon et
le capitaine Daussat, mes ex-compagnons d'infortune dans cette île, me reconduisent
jusqu'à bord. Ces braves garçons me quittent sans partager mes espérances :
ils n'ont pas confiance dans le succès de mon entreprise.
Partis à dix heures du soir, nous arrivons le lendemain à midi à l'embouchure
du Maroni.
Ce n'est pas sans émotion que je contemple ce fleuve superbe dont l'embouchure
n'a pas moins d'un kilomètre et demi de largeur et que je dois remonter jusqu'à
ses sources.
Deux heures après, le Serpent jetait l'ancre devant le pénitencier de
Saint-Laurent. Avant de descendre à terre, nous sommes obligés d'attendre la
visite du médecin sanitaire. Le médecin-major, qui vient lui-même le long du
bord, nous met en quarantaine pour six jours, ayant appris la mort récente d'un
matelot à l'hôpital de Cayenne. Cette mesure gène beaucoup nos combinaisons.
Par bonheur, le fondateur et commandant des pénitenciers du Maroni, M. Mélinon,
vient nous faire une visite le long du bord et met à notre disposition deux
de ses embarcations pour nous conduire le lendemain à l'ancien établissement
de Saint-Louis. C'est lui qui nous apprend que le R. P. Kroenner, mis également
en quarantaine à son arrivée à Mana, est parti aussitôt pour l'intérieur du
fleuve afin de recruter des Indiens Galibis et de louer des canots pour notre
expédition.
Je profite de notre séjour à Saint-Louis pour faire l'inventaire des bagages.
L'aumônier de l'hôpital de Saint-Laurent, le R. P. Lecomte, se charge de nous
procurer les quelques provisions qui nous manquent.
Ce missionnaire se met à ma disposition pour conserver et expédier les collections
que je lui enverrai; il vient nous visiter plusieurs fois durant notre captivité.
Arrivant à cheval sur le bord d'une petite rivière, qui limite d'un côté notre
prison, il s'entretient avec nous d'une rive à l'autre et nous fait passer par
un batelier quelques douceurs culinaires que nous adresse la supérieure des
Soeurs de Saint-Paul de Chartres.
Le 11, vers cinq heures du soir, au moment où la chaleur devient moins forte,
nous allons faire une promenade sur le bord du fleuve.
Pendant que j'examine dans le lointain l'établissement de M. Koeppler, situé
en face et sur la rive opposée, Mgr Emonet aperçoit une embarcation qui descend
le courant : c'est celle du R. P. Kroenner. Je suis heureux d'avoir un bon dîner
à offrir à mon nouveau compagnon; nous vidons une bouteille de champagne en
l'honneur de son arrivée .
Le lendemain, nous chargeons tous nos bagages sur un canot et une grande pirogue.
Le canot est monté par des noirs de Mana et des Chinois, la pirogue par des
Indiens Portugais, de ceux désignés sons le nom de Tapanges, qui de la côte
de Para sont venus se réfugier sur le bas Maroni.
Nous devons quitter l'embarcadère de Saint-Louis à: trois heures du soir, au
commencement de la marée montante, mais une pluie torrentielle nous empêche
de partir avant quatre heures .
Un parapluie dit d'exploration, qui m'a été envoyé par le ministère de l'Instruction
publique, se laisse complètement traverser; en revanche, un vêtement complet
en toile de campement résiste admirablement à ce véritable déluge: En effet,
une poche que j'ai négligé de fermer se remplit d'eau sans en perdre une seule
goutte .
C'est de l'embarcadère de Saint-Louis qu'est partie,
le 9 septembre 1861, la Commission franco hollandaise chargée de l'exploration
du Maroni.
M. Vidal, président de cette commission, qui ne comptait pas moins de sept membres,
raconte son départ dans les termes suivants : « Après avoir reçu les témoignages
de l'intérêt qui allait nous accompagner durant notre excursion, nous nous mimes
en route vers trois heures de l'après-midi.
Le temps était très beau; une foule nombreuse, réunie sur le warf du Pénitencier,
nous adressait ses derniers signaux d'adieu, pendant que la modeste artillerie
de Saint-Louis signalait notre départ par des détonations réitérées. Notre flottille,
composée de onze pirogues avec pavillons arborés, s'éloigna ainsi avec un entrain
qui faisait bien présager du succès de notre entreprise.» Notre départ est moins
solennel; les canons de Saint-Louis sont muets; la foule nombreuse qui agitait
ses mouchoirs sur l'embarcadère n'est représentée que par un surveillant et
sa femme, qui nous servaient pour ainsi dire de geôliers durant notre réclusion
.
Le P. Kroenner a engagé trois Indiens Galibis qui nous ont promis de nous, accompagner
jusqu'à Paramaka. Nous sommes obligés de traverser le fleuve pour aller prendre
ces habitants de la rive hollandaise. L'eau est clapoteuse, nos embarcations
sont chargées, à couler bas, et ce n'est pas sans danger que nous gagnons la
rive opposée, distante d'environ quinze cents mètres. Nous voyons un grain nous
prendre par le travers, et je propose d'abandonner le projet de traversée ;
mais le R. P. Kroenner, qui pourtant, ne sait pas, nager, nous engage à continuer.
Nous arrivons à un endroit où se trouvent accostées plusieurs pirogues; c'est
un dégrad [4] auquel aboutit un
petit chemin frayé qui nous mène aux carbets des Indiens.
Personne ne vient au-devant de nous. Où sont les hommes engagés ? Une femme
répond qu'ils sont partis pour la chasse depuis le matin.
Nous remontons plus haut pour prendre un autre Indien ; un sentier sous tonnelle
nous conduit à une clairière occupée par des carbets, où des femmes, des enfants,
des vieillards se balancent mollement dans leurs hamacs. On nous dit comme plus
bas que les hommes valides sont à la chasse. Cela veut dire en bon français
que ces trois Galibis ne veulent pas nous accompagner.
Tant pis et tant mieux : il est préférable d'avoir peu d’hommes bien résolus
qu'une bande de gens indécis.
Ces Indiens sont petits, ils ont les membres grêles, les pieds parallèles, les
cheveux longs. L'absence de barbe, outre ces caractères, leur donne un aspect
féminin.
Leur état sanitaire ne paraît pas florissant; nous trouvons l'un d'eux couché
: il souffre d'un ulcère grave du pied; un autre est atteint d'une fièvre paludéenne
qui a profondément détérioré sa constitution. Ces malheureux sauvages n'empruntent
à notre civilisation que ses vices, entre autres l'abus de l’alcool.
Leur principale industrie est la fabrication de vases
en terre qui ne manquent pas d'une certaine originalité.
Ils les font de toute pièce, à la main, avec des argiles qu'ils trouvent sur
la berge, sous une couche de sable. Leurs gargoulettes ont l'inconvénient d'être
en partie vernissées, ce qui empêche l'eau de se refroidir par l’évaporation.
J'ai profité de mes loisirs aux Iles du Salut pour me livrer à des recherches
sur la langue des Galibis.
Il est à remarquer qu'un certain nombre de mots français tirent leur origine
du langage des anciens habitants de la côte des Guyanes : ainsi caïman se dit,
en Galibi, caïman; pirogue, pirogue; ananas, nana. Notons
en passant que les ananas sont des fruits indigènes des Guyanes; j'en ai trouvé
à l'état sauvage dans la chaîne des monts Tumuc-Humac et sur les rives de l'Apaouani
au niveau d'un grand saut .
Tapir, en galibi, se dit tapiir; ara, ouara; macaque, macaque;
toucan, toucan .
Si M. Littré avait eu connaissance de ce langage, il n'aurait peut-être pas
fait dériver le mot hamac de l'allemand hangenmatte (Hangen, suspendre,
et matte, natte); car aujourd'hui, comme du temps du P. Biet en 1652,
les Galibis appellent hamac le lit dont se servent nos matelots.
Les Galibis se peignent en rouge. Ils ont pour tout vêtement un calimbé, un
collier, et deux paires de jarretières, l'une au-dessus, l'autre au-dessous
du mollet.
Nous avons une grande route à faire pour arriver chez le capitaine Bastien.
Ne pouvant profiter de la marée que pendant cinq heures, nous ne nous arrêtons
pas à l’île Portal. Mes compagnons de voyage disent que cette île est admirablement
cultivée : on y trouve des plantations de café, de cannes à sucre, et des prairies
artificielles pour l'élevage du bétail.
Ce grand établissement d'agriculture est l'oeuvre de trois Français, les frères
Bar, qui se sont fixés dans le Maroni depuis une vingtaine d’années.
Vers neuf heures le courant devient contraire; il faut toute la vigueur de nos
canotiers pour faire avancer nos lourdes embarcations.
Les noirs de Mana se distinguent par leur entrain; ils s'excitent en chantant
des airs créoles et en battant la mesure à coups de pagaye.
Vers onze heures du soir, nous arrivons au but de notre course. Un nègre, petit,
vieux, presque édenté, marchant en équerre, vient à notre rencontre. C'est Bastien,
l'illustre capitaine Bastien, le chef de la colonie portugaise établie sur le
fleuve Maroni. Cet homme, qui s'est assis à la table de plusieurs généraux et
amiraux, se croit obligé de porter une casquette d'officier de marine et une
canne de tambour-major.
Il est pourtant de manières très simples, ce grand capitaine ; il boit volontiers
les coups de rak [5] que je lui présente pour entrer
en matière : il met sa case à notre disposition et s'en va pendre son hamac
aux arbres de la forêt.
Nous sommes obligés de rester deux jours dans la colonie portugaise en attendant
que Bastien et quatre de ses hommes décidés à nous suivre aient terminé leurs
préparatifs.
Le dimanche matin, je pars en avant pendant que Mgr Emonet et le R. P. Koenner
baptisent des enfants et célèbrent deux mariages .
En route je rencontre un malheureux jeune homme revenant des mines d'or et que
M. Tollinche ramène presque mourant à l'hôpital de Saint-Laurent. Après lui
avoir donné les soins qu'exige son état, je continue ma route en compagnie de
M. Tollinche, qui retourne à son établissement.
Sans instruction, mais plein d'énergie, M. Tollinche a déjà rendu de grands
services à l'expédition franco-hollandaise ; il se met à ma disposition pour
me procurer des pirogues et enrôler sept nègres Youcas venus pour faire des
échanges dans le bas du fleuve .
Je passe la nuit dans un établissement de M. Lalanne, sur l'emplacement de l'ancien
pénitencier de Sparwine. M. Cazale, ancien sous-officier d'infanterie de marine,
qui s'occupe de l'exploitation aurifère, m'y offre une hospitalité des plus
cordiales.
Saba m'accompagne à terre, revêtu d'un splendide vêtement rouge qu'il s'est
confectionné lui-même avec de l'étoffe que j'aurais mieux employée pour les
échanges. Cet enfant marche derrière moi avec l'air sérieux d'un aide de camp
accompagnant son général.
En attendant l'arrivée de mes compagnons, je vais visiter les tombes de mes
collègues qui ont laissé leur vie dans les luttes obscures, mais glorieuses,
qu'ils ont livrées en ces lieux pendant les grandes épidémies de fièvre jaune
.
Beaucoup de médecins prétendent que cette maladie ne sévit que dans les ports
de mer. Cependant de violentes épidémies ont fait de nombreuses victimes, non
seulement à Saint-Laurent, qui est à trente kilomètres dans l'intérieur du Maroni,
mais à l'ancien pénitencier de Sparwine, qui est à soixante kilomètres de l'embouchure
du fleuve. Nous savons bien que l'épidémie de Sparwine a été qualifiée de fièvre
rémittente bilieuse; mais M. Moysan, qui servait sous nos ordres aux Iles du
Salut pendant l'épidémie de fièvre jaune, a reconnu l'identité complète de la
maladie des îles avec celle de Sparwine. Déjà un chef de bataillon faisant partie
d'une commission chargée de remédier à l'état sanitaire de ce pénitencier avait
déclaré que la maladie désignée sous le nom de rémittente bilieuse, était connue
dans son pays natal, à la Havane, dans l'île de Cuba, sous le nom de vomito
negro .
L'expression « rémittente bilieuse » qu'on emploie journellement dans les Antilles,
les Guyanes et toute la côte du Brésil, n'est qu'un nom trompeur, un masque
jeté sur le fléau pour soustraire le pays aux mesures quarantenaires .
Mgr Emonet arrive le lendemain, vers dix heures, avec le R. P. Kroenner; nous
nous mettons en route aussitôt après le déjeuner, que nous a offert M. Cazale
.
Nos quatre pirogues sont montées par vingt hommes d'équipage, tant Indiens Portugais
que noirs de Mana, et nègres de la tribu des Youcas .
Mes deux compagnons et moi prenons chacun la direction d'une pirogue. Saba s'assied
à côté de ma boussole sur un petit banc placé devant moi. Nous sommes abrités
contre l'ardeur du soleil par des feuilles de palmier disposées en voûte au-dessus
de nos têtes.
Nous arrivons au saut Hermina vers cinq heures du soir.
On a donné le nom d'Hermina à une série de sauts et de rapides qui s'étendent
sur une longueur d'environ huit cents mètres.
On trouve une petite île du nom de Sointi-Cassaba, située à trois cents mètres,
en amont des premières roches qu'on rencontre dans le cours du fleuve .
Les noirs et les Indiens qui descendent le fleuve passent quelques jours dans
cette île, pour y faire provision de coumarou, excellent poisson qui ne se tient
que dans les eaux vives .
Les anciens Indiens ont laissé des traces de leur passage dans cette île : on
remarque en effet sur les roches de nombreuses excavations lisses, produites
par le frottement d'instruments en pierre. Ces polissoirs n'ont pas la forme
de rainures, comme ceux des Iles du Salut. Ils sont larges et profonds vers
la partie médiane, et terminés en forme de lances aux deux extrémités. Depuis
longtemps déjà l'introduction des instruments en fer a naturellement fait abandonner
l'usage des haches de pierre à la plupart des sauvages.
Voici la manière dont procédaient les indigènes de la Guyane pour adapter un
manche à la pierre : Une incision longitudinale était pratiquée à travers le
tronc d'un jeune arbre; on plaçait le bord de la pierre opposé au tranchant
dans cette espèce de boutonnière,. et quelque temps après, la cicatrice s'étant
effectuée, l'instrument était solidement fixé .
Le saut Hermina est facile à franchir, car il n'a que quatre à cinq mètres de
hauteur, sur une largeur de huit cents mètres, comme il est dit plus haut.
Il est téméraire de s'engager dans un saut sans avoir à l'avant et à l'arrière
de la pirogue un homme habitué dès l'enfance à franchir ces passages périlleux
.
Les noirs de la côte ne valent rien pour la navigation dans les sauts ; leur
impéritie a déjà causé la mort d'un grand nombre de mineurs.
Nous faisons ici une recommandation capitale, qui s'adresse particulièrement
aux chercheurs d'or remontant les fleuves des Guyanes : c'est d'abandonner à
jamais l'usage des canots avec quille et gouvernail; seules, les pirogues des
nègres Bosch et des Indiens, creusées dans un tronc d'arbre, sont capables de
manoeuvrer au milieu de torrents impétueux ou de gouffres tourbillonnants.
Un vieux nègre Boni et sa femme, établis sur la petite île, nous procurent des
morceaux de maïpouri (tapir) boucané.
Partis le lendemain matin de très bonne heure, nous éprouvons une certaine appréhension
en franchissant les rapides et les petites chutes situées en amont de cette
lie Sointi-Cassaba .
Tous ces fleuves de la Guyane française ne sont navigables, pour les bateaux
à vapeur, que sur une étendue de douze ou quinze lieues au-dessus de leur embouchure.
Plus haut, ces fleuves sont obligés de déchirer, pour ainsi dire, des collines
et des montagnes, afin de se frayer un passage. Des blocs durs, souvent granitiques,
opposent, dans le lit même, mille obstacles à l'écoulement des eaux. Puis, des
roches disposées dans le sens longitudinal rétrécissent le cours de la rivière,
et forcent la masse liquide à marcher d'autant plus vite que l'espace est plus
restreint : c’est ce qui constitue un rapide ; et dans ce rapide, les roches
transversales forment un barrage, une digue pardessus laquelle l'eau se précipite
pour tomber en cascade.
Tels sont les sauts de la Guyane française et les cachoeieras du Brésil.
Les sauts, dit M. Vidal, établissent une série de bassins dont ils constituent
eux-mêmes : les digues de retenue.
« Le courant, d'une rapidité vertigineuse dans les sauts, est faible et quelquefois
presque nul entre deux de ces obstacles. C'est grâce à ce régime tout à fait
spécial aux rivières de la Guyane que le Maroni peut retenir ses eaux malgré
la pente sensible et disproportionnelle qu'offre le profil de son lit. » Un
fait à signaler, c'est que le cours des fleuves change généralement après un
saut ou un rapide.
En examinant les rives, on voit que l'eau, après avoir détruit une partie de
la colline sur les débris de laquelle elle s'est frayé un chemin, a rencontré
des obstacles plus forts qui ont résisté à sa violence .
C'est son impuissance qui se traduit par une déviation dans la direction de
son lit.
Le 16 juillet, les Youcas, excités par un des leurs, veulent nous laisser en
route. Un vieux Youca refuse de remonter dans ma pirogue sous prétexte que j'y
ai dépouillé un singe hurleur, animal qu'ils considèrent comme sacré.
Acodi, mon patron de canot, qui est un grand enfant capricieux, s'est mis à
la tête de cette mutinerie.
Ce sauvage à la taille élevée, aux muscles puissants, est au fond un garçon
très doux, qui n'est pas sans me porter quelque intérêt. Au moment où il parait
le plus irrité, je lui dis d'un ton calme : « Va chercher mon hamac, et pends-le;
je suis fatigué ! » Acodi hésite une seconde, et part en courant exécuter
mon ordre. Voyant qu'il sourit au retour, je lui offre un bon coup de tafia,
et tout est oublié.
L'absence d'habitants pendant plusieurs jours rend la navigation des plus monotones.
Afin de nous distraire nous faisons de petites excursions pendant nos haltes,
pour examiner le pays.
La Guyane est recouverte d'une immense forêt qui généralement n'est interrompue
que par des cours (l'eau et de rares éclaircies dans les endroits où le sol
n'est pas assez fertile pour nourrir des arbres.
Les terrains qu'on appelle savanes sont recouverts de graminées, et servent
à l'alimentation du bétail, qu'on y laisse paître en toute liberté.
Les savanes occupent le bas des Guyanes, près du littoral; nous n'en avons rencontré
qu'une seule dans l'intérieur : c'est près du village de Cotica, dans le pays
des Bonis .
Peu de personnes se font une idée exacte de la forêt équatoriale. Les dessinateurs
et les romanciers ont habitué le public à voir dans ces forêts des palmiers
sans nombre, des arbres aux formes bizarres, recouverts de parasites et entremêlés
de lianes courant de branche en branche comme des cordages aux mâts d'un navire
.
Cette description n'est guère vraie que pour les petites îles de la côte des
Guyanes et pour le bord des rivières près de leur embouchure .
La forêt vierge, le grand bois, comme on l'appelle en Guyane, se présente sous
un aspect froid et sévère.
Mille colonnades ayant trente-cinq ou quarante mètres de haut s'élèvent au-dessus
de vos têtes pour supporter un massif de verdure qui intercepte presque complètement
les rayons du soleil .
A vos pieds, vous ne voyez pas un brin d'herbe, à peine quelques arbres grêles
et élancés, pressés d'atteindre la hauteur de leurs voisins pour partager l'air
et la lumière qui leur manquent. Souvent ces colonnades, trop faibles pour résister
aux tempêtes, sont soutenues par des espèces d'arcs-boutants ou béquilles comparables
à celles des monuments gothiques désignés sous le nom d'arcabas .
Sur le sol, à part quelques fougères et d'autres plantes sans fleurs, gisent
des feuilles et des branches mortes recouvertes de moisissure.
L'air manque. « On y sent la fièvre, » me disait un de mes compagnons. La vie
parait avoir quitté la terre pour se transporter dans les hauteurs, sur le massif
de verdure qui forme le dôme de cette immense cathédrale .
C'est à cette hauteur de quarante mètres que l'on voit courir les singes; c'est
de là que partent les chants de milliers d'oiseaux aux plumages les plus riches
et les plus variés .
Au niveau des cours d'eau, la végétation perd sa sévérité pour gagner en élégance
et en pittoresque .
Ici, le soleil est le privilège des plus grands arbres, qui s'élancent au-devant
de lui; mais les plus petits trouvent aussi leur part de chaleur et de lumière.
Les herbes, les arbrisseaux, prenant tout leur développement, sont couverts
de fleurs et de fruits aux couleurs éclatantes. Le hideux champignon, l'obscure
fougère font place à des plantes aux feuilles riches en couleurs, aux fleurs
élégantes. Des lianes s'élèvent du sol jusqu'au sommet des plus grands arbres,
en prenant des points d'appui sur les arbrisseaux qu'elles rencontrent. Ce sont
des traits d'union entre les grands et les petits.
La lumière, également partagée, engendre l'harmonie, non seulement dans le règne
végétal, mais encore dans le règne animal. Là-bas, c'est la bête fauve et le
hideux crapaud; ici, ce sont des animaux de toute espèce qui viennent partager,
tous ensemble, les bienfaits de la nature .
Le 18 juillet, une heure après notre départ, nous voyons sortir d'une anse creusée
dans une petite île une pirogue portant sept personnes, toutes du sexe féminin.
Elles sont placées les unes derrière les autres, à la file indienne. La seule
personne âgée est au milieu; mon nègre Bosch me dit que c'est une « maman ».
Nous leur faisons quelques petits présents, et elles s'en vont, vers la rive
gauche, récolter leur riz.
Quelques instants après, nous arrivons au village de Paramaka .
Les nègres Paramakas, au nombre d'une centaine, sont d'anciens esclaves de la
Guyane hollandaise, qui ont échappé aux poursuites de leurs maîtres vers 1826
.
Le R. P. Kroenner, qui a fait un long séjour chez ces noirs redevenus sauvages,
me dit que le nom de Paramaka vient de deux mots galibis : para, rivière, et
maka, nom du fruit d'un grand arbre qu'ils ont trouvé en abondance dans
l'endroit où ils se sont établis .
En arrivant, je fais un présent au chef de la tribu; je lui remets un manteau
en velours vert, provenant d'un assortiment de costumes de théâtre que le ministre
de l'Instruction publique m'a expédié sur ma demande .
Cet homme, qui parait d'abord enchanté, se montre ensuite fort désappointé,
en apprenant que nous possédions de plus jolis vêtements dans nos bagages.
Craignant un coup de main pendant la nuit, car ces nègres ont la réputation
de dévaliser les chercheurs d'or, je couche dans un carbet près du village,
et je place des hommes de garde dans mes canots .
Acodi propose de garder ma pirogue, disant qu'il serait bien aise de trouver
une occasion de tuer un nègre Paramaka .
Pendant la nuit nous sommes tous réveillés par des piqûres douloureuses dans
toutes les parties du corps. C'est une invasion de fourmis qui s'abat sur le
village. Les indigènes font un grand feu en cercle pour se protéger contre ces
animaux. Je trouve plus simple d'aller rejoindre Acodi dans ma pirogue, où je
puis dormir quelques heures.
Le lendemain, les deux missionnaires demandèrent à baptiser les enfants du village,
mais le chef de la tribu s'y opposa.
Nous partîmes à huit heures du- matin, après que Mgr Emonet eut dit une messe
à laquelle assistaient tous les sauvages de la tribu.
Après sept jours de marche, pendant lesquels nous n'avons rien à signaler, nous
arrivons, au pied du grand saut de Manbari; à un autre établissement
de M. Lalanne. Son intendant nous fait visiter un chantier d'exploration
aurifère, sur la rive droite du fleuve. Mgr -Emonet tue deux singes hurleurs
et des marailles .
Nous ne sommes pins séparés que .par quelques lieues du confluent de l'_Aoua
et du Tapanahoni, niais le -fleuve -est ici parsemé de chutes épouvantables:
Ce sont principalement les sauts de Singa- Tetey (doublez l'amarre), de Man-Bari
(l'homme crie), et de Man-Capa (l'homme finit) .
La navigation des rivières des Guyanes est moins périlleuse pendant la saison
sèche (de juillet à novembre) que pendant les grandes pluies. Vers la fin de
décembre, le courant est tellement rapide qu'il est presque impossible de diriger
une embarcation : aussi les indigènes ne sortent-ils à cette époque qu'autant
qu'ils sont pressés par la faim.
A l'exemple- des Indiens, le voyageur ne doit entreprendre un long voyage que
pendant la saison sèche. Malheureusement les fièvres sont plus fréquentes et
plus graves pendant cette Saison, dans l'intérieur du pays aussi bien que sur
les côtes. Elles ont leur maximum d'intensité vers la fin de juillet, c'est-à-dire
au moment où les terres commencent à se découvrir.
Nous pensons qu'il serait prudent de ne pas se mettre en route avant le 10 ou
le 15 août, c'est-à-dire tin mois après la fin des pluies .
La Commission franco-hollandaise qui remonta le Maroni en 1861, partie de l'embouchure
du fleuve le 9 septembre seulement, n'eut pour ainsi dire pas à souffrir de
la fièvre. Sur sept officiers, un seul fut atteint de la maladie. La navigation
des fleuves est beaucoup moins périlleuse en montant qu'en descendant. Le danger
le plus redoutable lorsqu'on descend un cours d'eau, c'est de se laisser entraîner
inopinément dans une chute .
Nous devons rassurer les voyageurs en leur apprenant que le courant, du moins
dans la saison sèche, n'est généralement pas violent au-dessus des plus grands
sauts. Nous savons par expérience qu'une embarcation mal manoeuvrée ou abandonnée
au courant éprouve un mouvement d'arrêt avant de franchir une cascade.
Cela tient à un remous des eaux qui luttent contre les roches formant barrage.
D'ailleurs on est généralement prévenu par un grondement qui s'entend parfois
jusqu'à la distance de deux kilomètres.
L'attention du voyageur devra redoubler lorsque, en descendant un cours d'eau,
il le verra parsemé d'un grand nombre d'îles : c'est un indice presque constant
de l'existence de sauts et de rapides.
Pour franchir un rapide ou une chute, il faut que les hommes pagayent de toute
leur force, car on ne peut diriger une embarcation qu'autant que sa vitesse
est plus grande que celle du courant. L'homme qui est à l'avant doit être aussi
habile que le patron qui est à l'arrière. Chez les nègres Bosch, c'est lui qui,
à l'aide d'une longue perche appelée tacari, dirige l'embarcation et
lui fait éviter les écueils qu'il aperçoit, ou plutôt qu'il devine à l'aspect
des ondulations de l'eau qui se produisent au niveau des roches .
En remontant les Sauts, on est souvent obligé de tirer sur les pirogues au moyen
d'une liane ou d'une corde amarrée à l’avant.
Il faut avoir bien soin de maintenir l'embarcation dans le sens du courant,
autrement il serait absolument impossible de résister à la puissance de l’eau.
Lorsqu'on navigue avec plusieurs embarcations, on emploie tous ses canotiers
pour remonter chacune d'elles successivement.
Le 23, nous arrivons à la bifurcation du Maroni en Aoua et Tapanahoni. Nous
remontons cette dernière branche pendant un mille, et nous trouvons une petite
agglomération de carbets pouvant contenir environ cinquante personnes. Le chef
de cette bourgade, le Gran-man des Poligoudoux, et la plupart des habitants
sont allés danser au village de Malobi, chez les Youcas .
Partis depuis quatre jours, ils ne reviendront que demain. soir .
Je demande au chef qui remplace le Gran-man de me louer une petite pirogue pour
aller jusqu'à Malobi .
Il me répond par un refus catégorique : tout ce que je puis obtenir de lui,
c'est l'envoi d'un messager pour prévenir le Gran-man .
Les Poligoudoux tiennent à montrer qu'ils sont les gardiens de 1a tête du Maroni.
Le chef nous fait attendre deux jours.
Nous avons une soirée superbe : Mgr Emonet et moi nous nous promenons en long
et en large sur une grande place qui occupe le centre du village. Le sol argileux
est parfaitement tassé et soigneusement nettoyé; on en arrache jusqu'aux herbes.
C'est une belle promenade.
Nous éprouvons un vrai plaisir à mettre en mouvement nos jambes, ankylosées
à la suite de neuf jours de canotage, à raison de huit heures par jour en moyenne.
En somme, nous sommes enchantés de la première partie du voyage. Nous avons
parcouru cent milles marins en peu de temps et sans nous trouver incommodés
le moins du monde.
Nous nous sentons tous les trois aussi bien portants qu'à notre départ de Cayenne,
et cela nous fait bien augurer de l'avenir. Nous nous proposons mène de modifier
notre premier plan de voyage. Je soumets à mes compagnons le projet suivant
: Le P. Kroenner irait rejoindre ses paroissiens à Mana, par un affluent de
droite du Maroni, la crique Inini, par exemple ; je traverserais les montagnes
Tumuc-Humac avec Mgr Emonet; et nous nous séparerions une fois arrivés au de-là,
pour revenir, lui par l'Oyapock, et moi par le Yary et l’Amazone.
Pendant que nous nous livrons à ces combinaisons, l'équipage ayant fait connaissance
avec les indigènes se livre avec eux aux danses les plus frénétiques. C'est
à qui surpassera l'autre par l'agilité de ses mouvements et par le bruit qu'il
produira en frappant le sol de la plante de ses pieds.
Les noirs de Mana entonnent un de leurs chants favoris; les Bosch et les Poligoudoux
ne tardent pas à saisir l'air et les derniers mots du refrain; tous répètent
en choeur : Aya maman, aya maman! En attendant le Gran-man, je fais une
excursion en rivière avec une pirogue montée par deux nègres Poligoudoux; mon
but est de juger de l'importance relative des deux grands affluents du Maroni,
l'Aoua et le Tapanahoni.
Nous considérons l'Aoua comme la continuation du Maroni. En effet, un examen
attentif de la largeur et de la profondeur des eaux ainsi que de la vitesse
du courant nous fait estimer que le Tapanahoni est d'environ un tiers moins
important que l’Aoua.
D'après M. Vidal, au mois de septembre, c'est-à-dire au milieu de la saison
sèche, le débit de l'Aoua est de trente-cinq mille neuf cent soixante mètres
cubes par minute, tandis que celui du Tapanahoni est de vingt mille deux cent
quatre-vingt-onze mètres.
Les nègres Poligoudoux qui vivent au confluent de ces deux rivières nous ont
déclaré dans leur langage simple que l'Aoua est la maman du Maroni .
La Commission franco hollandaise, qui a remonté le Tapanahoni pendant cent soixante-douze
kilomètres, pensait avoir atteint un point très rapproché des sources. Mais,
au dire du Boni Apatou, qui est allé chez les Indiens Trios, le Tapanahoni s'étend
à une distance considérable du saut d'Hingui-Foutou, au pied duquel la Commission
s'est arrêtée .
D'après les relations des Roucouyennes, -le Tapanahoni aurait ses sources dans
la chaîne de Tumuc- Humac, en face de la rivière Parou.
Les nègres Poligoudoux sont des soldats noirs de la Hollande qui ont déserté
pendant les guerres soutenues par cette colonie contre les nègres Bonis. Les
Youcas, qui ont plusieurs villages sur le Tapanahoni, sont d'anciens esclaves
marrons fugitifs de Guyane hollandaise dans cette dernière colonie on les désigne
généralement sous le nom de nègres Bosch qui veut dire nègres des bois.
L'évasion de ces noirs marrons a commencé en 1712, après la prise de Surinam
par l'amiral français Cassar. La capitale de la Guyane hollandaise ayant été
imposée pour une somme d'un million et demi tenues de francs, les autorités
eurent la malheureuse idée de répartir cette contribution de guerre d'après
le nombre des esclaves
De grands propriétaires juifs qui voulaient se, ce soustraire à cet impôt engagèrent
une partie de leurs nègres à se réfugier dans la forêt. Beaucoup de ces le malheureux
préférèrent la vie misérable du grand bois à l'esclavage dans une colonie prospère.
Ces bandes de nègres marrons, dont le nombre augmentait tous les jours, finirent
par compromettre la sécurité des habitants isolés. Plusieurs plantations furent
complètement saccagées.
Les Hollandais leur déclarèrent la guerre ; mais la maladie d'un côté, de l'autre
les balles et les flèches d'ennemis acharnés, jetèrent le désarroi dans la petite
colonne d'expédition, qui dut renoncer à tenir campagne.
Devant des hostilités sans cesse renouvelées, les propriétaires de plantations
se virent obligés de traiter avec leurs anciens esclaves. Les conditions furent
discutées et signées en 1761 à l'habitation d’Auka.
Les esclaves obtinrent la liberté complète, à la condition qu'ils rendraient
à leurs maîtres, à partir de cette époque, les esclaves fugitifs qui viendraient
leur demander asile.
A la suite de ce traité, les nègres Youcas cessèrent leurs incursions guerrières
pour s'établir sur les bords du Tapanahoni.
Docteur Jules CREVAUX
(La suite à la prochaine livraison.)
VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'INTÉRIEUR DES GUYANES
PAR M. LE DOCTEUR JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE FRANÇAISE
1876-1877
TEXTE ET DESSINS INÉDITS .
III
Le Gran-man consulte le ciel, qui se montre propice, mais à des conditions inacceptables. — Une panique. — Encore la fièvre. — Saba malade. — Une toilette qui m'horripile. — Cotica. — Réception. — L'état-major du Grand-man. — Toujours la fièvre ! — Le H. P. Kroenner et Mgr Emonet tombent malades : je les renvoie au pénitencier de Saint-Laurent. — Seul ! — Josepi. — Une pluie diluvienne. — La tribu des Bonis et son histoire. —:Conséquences désastreuses d'une promesse non remplie : guerre entre des Hollandais et les Bonis. Guerre des Bonis avec les Oyampis. — Un brillant fait d'armes. — Guerre Guerre avec les Oyacoulets. — Reprise des relations entre les Bonis, les Hollandais et les Français.
Le Gran-man des Poligoudoux, au retour de ses fêtes et
de ses danses chez les Youcas, ne consent à nous donner des hommes qu'après
avoir consulté le ciel ou le Dieu (Gadou). Pour faire ces invocations, il se
barbouille le front avec une argile blanche, et parait ensuite à la fenêtre
d'une case, où il entonne une chanson lugubre qui ne dure pas moins de deux
heures. Ce noir, se livrant à des contorsions d'épileptique, et roulant ses
grands yeux dans leur orbite en regardant le ciel, nous fait songer involontairement
à un damné demandant une place au Paradis.
Le Gadou, nous dit-il, autorise le Gran-man à nous fournir des hommes, en remplacement
de deux de nos noirs malades et de tous nos Youcas qui nous abandonnent. Mais
les conditions qu'on veut nous imposer nous semblent tellement onéreuses, que
nous ne pouvons les accepter. Mgr Emonet, le R. P. Kroenner et moi, après avoir
pris conseil, nous nous décidons à nous mettre en route avec les huit hommes
d'équipage qui nous restent
Mes deux compagnons partent en avant avec le patron Bastien et ses Indiens Taponyes.
Je monte le deuxième canot, qui est le plus lourd, avec quatre noirs de Mana.
Arrivés à deux kilomètres du village, nous rencontrons un petit saut que la
première embarcation franchit sans beaucoup de peine. Cependant, au moment où
nous touchons l'obstacle, mes hommes sont pris tout à coup d'une véritable panique
en voyant que l'embarcation recule, et que la force du courant menace de nous
entraîner dans une grande chute. L'un d'entre eux s'étant jeté à l'eau, l'autre
ayant perdu sa pagaye, je me trouve dans une situation très embarrassante et
dont j'ai beaucoup de peine à sortir.
Le découragement de ces hommes, qui m'accusent de vouloir les faire noyer tout
exprès, m'oblige à revenir sur mes pas pour demander des secours aux Poligoudoux.
Bon gré mal gré, il faut que je passe par toutes les conditions que m'impose
le chef de la tribu.
L'excédant de mes bagages est déposé en toute hâte sur un deuxième canot, et
je m'empresse de rejoindre mes compagnons, qui commencent à s'inquiéter de moi.
Nous mettons six jours pour aller du village des Poligoudoux au pays des Bonis;
on pourrait facilement faire ce voyage en quatre jours; mais nos guides montrent
beaucoup de mauvaise volonté, et alors s'attardent à pêcher dans les sauts,
me faisant perdre ainsi un temps précieux. D'un autre côté, ces arrêts intempestifs,
en plein midi, nous exposent aux ardeurs d'un soleil torride qui commence à
altérer ma santé. Le quatrième jour, je suis pris d'un accès de fièvre, au moment
où nous arrivons au terme de notre étape, c'est-à-dire à l'endroit où nous allons
passer la nuit.
Impatient d'arriver au plus vite chez les Bonis, je veux partir en avant, avec
une petite pirogue que nous rencontrons sur notre route, mais les deux indigènes
qui la montent refusent de me prendre avec eux; sous prétexte que leur embarcation,
trop légère, pourrait chavirer dans les sauts qui nous séparent de leur village.
Je suis obligé de m'incliner devant cette observation, et il nous faut deux
jours pour faire un trajet de quelques heures avec mon misérable patron de canot,
qui se fait toujours un malin plaisir de nous exposer à l'ardeur du soleil.
Mon petit Saba, pris d'une fièvre intense, est obligé de se coucher dans mon
canot. Quant à moi, je ne parviens pas à digérer le modeste repas composé de
sardines et de biscuit que je prends avec mes compagnons sur une roche nue,
par une température excessivement élevée; je rejette tout, aliments et boissons
.
Cependant je me console en voyant que nous approchons du terme de cette pénible
excursion. Je supplie le patron de l'embarcation d'accélérer la marche; mais
au lieu de me répondre, ce vieillard sans pitié, me laissant en plein soleil,
perd deux grandes heures à faire sa toilette, c'est-à-dire à arranger son calimbé
et à se badigeonner le front avec de l'argile blanche.
Enfin nous arrivons, à la grande satisfaction de tout le monde, près du petit
village de Cotica, où est établi le Gran-man des Bonis.
Pour annoncer notre arrivée, j'ordonné à mes hommes de tirer quelques coups
de fusil en l'honneur de mes nouveaux hôtes. Cette manière de les saluer a le
don de leur plaire. Le cérémonial de l'arrivée terminé, je fais distribuer un
litre de tafia à tout l'état-major, et me hâte de gagner mon hamac, que j'ai
fait suspendre à l'écart. Depuis une heure, en effet, je sens ma tête tourner,
et je fléchis sur mes jambes comme un homme ivre. Sababodi se couche près de
moi; nous sommes tous les deux en proie à une fièvre violente.
Dans la soirée, malgré mon état pitoyable, je suis obligé de me lever pour apaiser
une querelle qui s'est élevée entre les Bonis et le capitaine Bastien sur un
sujet de peu d'importance, mais qui, blessant les coutumes de ces sauvages,
aurait pu avoir des conséquences graves. On entourait déjà le pauvre capitaine
avec des hurlements sauvages. Je parvins heureusement à faire cesser le malentendu.
Le mal empira jusqu'au troisième jour, à la fin duquel mon état s'améliora subitement;
mais ce fut le tour du R. P. Kreonner de tomber malade, et plus gravement que
moi, car la fièvre me laissait de courts moments de repos, tandis que, chez
mon compagnon, elle était absolument continue.
Pendant que je me rétablis assez rapidement et que la fièvre persiste chez le
R. P. Kroenner, Mgr Emonet est pris d'un léger mal de tête, un soir, en revenant
de la chasse; le lendemain, une violente crise se déclare dans la matinée. Le
surlendemain, il est sous le coup d'une fièvre comateuse qui, pendant deux jours,
ne nous laisse aucun espoir.
La constitution des deux missionnaires apostoliques est profondément altérée
par ces maladies de quelques jours. Je les fais descendre au plus vite, pour
les diriger sur l'hôpital du pénitencier de Saint-Laurent .
Mes compagnons ainsi partis, avec un Bonis et trois de nos hommes, je fais venir
le Gran-man, pour lui de demander une escorte et des vivres, afin de pouvoir
continuer ma route. Il me répond qu'il ne peut accéder à ma demande sans l'assentiment
du grand conseil, qui ne se réunira que dans deux jours.
Pendant ce temps, j'enrôle un mulâtre de la côte nommé Josepi, qui a passé sa
vie au milieu de ces sauvages. C'est, me dit-on, un habile patron de canot qui,
entre autres qualités précieuses, possède celle de pouvoir me servir en même
temps d'interprète. Je m'engage à lui payer dix francs par jour, et une gratification
de cinq cents francs, s'il m'accompagne jusqu'au terme de mon voyage, c'est-à-dire
jusqu'à l’Amazone.
Cet homme m'ayant été chaleureusement recommandé par un de mes collègues, je
lui donne en toute confiance la direction de mon équipage.
Cependant le conseil s'est réuni et à décidé, après de grandes délibérations,
que mon départ ne pourra avoir lieu que dans dix-sept jours, après la fin clos
fêtes données en l'honneur du Gran-man défunt.
IV
Constitution physique. — État moral. — Maladies
et remèdes. — Costumes. — Ornements. — Habitation. — Religion. — Magie. — Place
du Conseil .
Tous ces sauvages se ressemblent au physique et au moral.
Cela tient sans doute à ce qu'ils ont tous une origine commune, et qu'ils ont
vécu dans les mêmes milieux. Ce sont des noirs de la côte d'Afrique, qui ont
été esclaves plus ou moins longtemps dans la Guyane hollandaise, et qui sont
redevenus sauvages après un court séjour dans la forêt vierge.
Quelques femmes portent une jolie rosace autour de l’ombilic.
Cette espèce de tatouage se pratique en faisant de petites incisions sur la
peau. La cicatrice n'étant pas assez saillante après une première opération,
on est obligé de refaire quatre ou cinq fois des incisions sur les cicatrices.
Il est à noter que, chez les nègres, les plaies n'intéressant que le derme produisent
des cicatrices couleur de jais, tandis que les plaies profondes sont complètement
blanches après la guérison .
Ces sauvages ne se peignent pas la peau comme tous les indigènes de l'Amérique.
Ils se barbouillent le front avec une argile blanche lorsqu'ils font des invocations
à leur divinité.
Les hommes et les femmes se font des tresses en forme de couronne, et quelquefois
leur coiffure affecte une forme pyramidale.
Pour donner à leur chevelure la forme qu'ils désirent, ils enduisent leurs cheveux
d'un corps gras, tel que l'huile de carapa.
Les hommes ne portent jamais la barbe, qui est d'ailleurs peu développée. Ils
se rasent avec des tessons de bouteilles ou avec des couteaux plus ou moins
bien affilés.
Leurs peignes sont faits de bois. Les dents en sont très volumineuses et très
longues. Les jeunes gens se donnent beaucoup de peine pour faire de ces instruments
un véritable objet d'art, qu'ils offrent en signe d'amitié à la beauté de leur
choix.
Tous ces noirs ont des dents magnifiques et d'une blancheur remarquable. Le
premier soin d'un Boni ou d'un Youca en se levant, est de se laver la bouche
avec de l'eau tiède, que sa femme est chargée de préparer.
Jamais ils ne finissent un repas sans se rincer la bouche, mais cette fois avec
de l'eau froide.
Les hommes et les femmes, ainsi que les plus petits
enfants, ne passent jamais un jour sans se plonger dans la rivière.
Le plus souvent ils prennent leur bain quand ils ont très chaud. Ils trouvent
qu'il n'y a pas le moindre danger à se plonger dans l'eau au milieu de la plus
forte transpiration.
Leur état sanitaire est généralement satisfaisant. Les maladies les plus fréquentes
chez eux sont les maladies de la peau. Nous avons remarqué plusieurs cas d’éléphantiasis.
Les ulcères des membres inférieurs sont assez fréquents.
Ces sauvages ont généralement la vue bonne.
Le strabisme et les affections de la conjonctive et de la cornée sont rares.
Celles du cristallin sont plus communes; nous avons rencontré un assez grand
nombre de vieillards atteints de cataracte.
Les maladies des nerfs de la moelle et du cerveau sont beaucoup moins communes
que dans la race blanche : cela tient sans doute à ce que les noirs ont le système
nerveux beaucoup plus apathique que les blancs.
La scrofuleuse est peu fréquente.
Nous n'avons pas rencontré d'individus porteurs de cicatrices provenant d'abcès
ganglionnaires, mais nous avons vu une jeune fille et un enfant atteints de
coxalgie.
Les infirmes, ne connaissant pas l'usage des béquilles, se traînent péniblement
en s'appuyant sur un grand bâton.
L'anémie et la chlorose se traduisent par une décoloration de la peau. On peut
établir, en fait général, que ces sauvages se portent d'autant mieux, et paraissent
d'autant plus beaux, que leur tégument cutané est d'un noir plus brillant et
plus foncé.
Beaucoup d'enfants ont le ventre très volumineux.
Les hernies ombilicales sont extrêmement fréquentes, mais peu volumineuses.
Cette infirmité provient peut-être de ce qu'ils coupent le cordon au ras de
l'ombilic. Parmi les plantes usitées par ces sauvages pour le traitement des
maladies, nous n'en avons remarqué qu'une seule présentant un intérêt réel.
C'est le bamba, qui donne un liquide limpide et aromatique (ouata bamba, eau
de bamba) dont ils se servent pour la destruction de leurs parasites.
Ils obtiennent ce liquide en faisant des incisions profondes dans le tronc de
l'arbre désigné sous le nom de bamba, et qui appartient à la famille des laurinées .
Ces noirs, redevenus sauvages, n'ont pas tardé à réduire leur costume à sa plus
simple expression. La plupart des femmes ne portent, pour tout vêtement, qu'un
morceau d'étoffe de dix centimètres carrés, suspendu, comme un linge qu'on fait
sécher, à une ficelle fixée autour de la ceinture. Dans les grandes circonstances
seulement, elles s'enveloppent d'un morceau d'étoffe, qui va de la ceinture
jusqu'à mi-cuisses (camisa) .
Les hommes portent un linge passé entre les cuisses et fixé à une ceinture à
l'avant et à l'arrière (calimbé). Les hommes et les femmes ont de nombreux colliers
et des anneaux au cou; aux poignets et aux jarrets. Ces sauvages tiennent beaucoup
à leurs ornements. Les nègres Poligoudoux, qui m'accompagnent jusque chez les
Bonis, n'ont jamais voulu se présenter à leurs voisins sans avoir revêtu toutes
leurs parures.
Ces colliers ont généralement une signification religieuse. Le vieux chef Yagui,
dont j'ai déjà parlé, porte au cou un morceau d'argile dans lequel se trouve
englobée la tête d'un aiglon, de façon que le bec seul paraisse à l'extérieur
.
Ce bonhomme m'ayant prêté son collier pour le dessiner, me demanda un peu de
rhum en récompense de ce petit service. J'ai constaté qu'il avait insufflé ce
liquide sur son morceau de terre sans en avaler une goutte.
C'était une offrande qu'il faisait à son Dieu ou Gadou.
Les Bonis vivent généralement sous des huttes carrées, recouvertes de feuilles
de palmier. Quelques unes de ces habitations sont ouvertes à tous les vents.
La plupart sont fermées de tous les côtés, et l'on ne peut y entrer que par
un orifice étroit et très bas, qui est quelquefois fermé par une porte munie
d'une serrure en bois.
Nous avons vu une seule maison ayant un étage; où l'on ne pouvait d'ailleurs
monter que par une échelle appuyée contre la fenêtre.
C'est dans cette espèce de réduit, qui sert en même temps de poste, que le Gran-man
des Poligoudoux fait des invocations au Gadou, comme on le voit page 353 .
On trouve généralement, à côté des maisons, des calebasses coupées en deux et
placées sur un trépied en bois, élevé à un mètre du sol.
Ces calebasses contiennent des herbes cuites à l'eau, qu'on pourrait prendre
pour une soupe à l’oseille.
Cette décoction possède toutes sortes de propriétés magiques.
Une jeune fille buvait de ce breuvage pour se faire aimer, disait-elle, par
un de nos canotiers.
Sur le seuil de la maison, on remarque un bâton auquel est suspendu un petit
linge provenant du calimbé d'un des ancêtres.
Ce chiffon, qu'ils arrosent fréquemment, en manière de sacrifice, est chargé
d'empêcher l'introduction des voleurs. C'est une image des dieux lares des Romains.
Les maisons qui constituent un village sont disposées en une circonférence plus
ou moins régulière; l'espace libre qui se trouve au milieu sert de place publique.
Les femmes y font sécher le riz ou préparent les racines de manioc pour faire
de la cassave et du cachiri [9] .
C'est sur cette place que les anciens, assis sur des escabeaux, délibèrent gravement
sur toutes les questions qui intéressent la tribu.
Cette place est balayée tous les matins au lever du soleil. Les plus petits
brins d'herbe sont soigneusement arrachés par les femmes, afin de débusquer
les serpents, les araignées-crabes, les scorpions, enfin les milliers de bêtes
venimeuses qui mettent à chaque instant la vie des enfants en péril.
Dans tous les villages j'ai remarqué une petite habitation soigneusement fermée,
située en un endroit un peu écarté. En passant chez les nègres Paramakas, j'avais
eu l'idée de m'établir dans cette habitation, afin de reposer plus tranquillement.
Personne n'est venu me déranger pour voir mes bagages.
Ces sauvages ne pénétraient pas dans cette case, même lorsque je les appelais
pour leur faire des cadeaux.
La réserve de ces populations, qui ennuient si souvent le voyageur par leur
indiscrète curiosité, m'étonna fortement; j'ai su plus tard que cette maison
est un temple exclusivement réservé aux femmes pendant certaines périodes .
Chez les Bonis, j'ai trouvé une petite case au milieu de laquelle se dresse
une grossière statue en argile, remarquable par ses immenses mamelles.
Cette espèce de divinité s'appelle maman-groon (mère de la terre).
Ayant demandé aux Bonis si ce n'est pas cette déesse qui fait pousser le manioc
et le riz, ils me répondirent, en riant, que maman-groon ne fait rien autre
chose que de s'amuser .
En voyant à ses pieds un tambourin et divers instruments de musique, j'ai pensé
que c'est la déesse de la danse et des plaisirs.
V
Forêt. — Pirogues. — Productions naturelles.
— Animaux, Péche et chasse.
La forêt vierge, qui couvre presque toute l'étendue des Guyanes, ne permet pas
l'usage des bêtes de somme : on est obligé ou bien d'aller à pied, ou bien de
naviguer sur les nombreux cours d'eau qui sillonnent le pays.
Les nègres Bosch passent une grande partie de leur existence à courir les rivières.
Les embarcations dont ils se servent sont faites d'un tronc d'arbre creusé à
coups de hache; elles sont très longues, mais très étroites, l'avant et l'arrière
fortement relevés. Les bois dont ils se servent sont souvent le grignon et le
bamba. Ce dernier est préféré à cause de sa légèreté et de sa résistance à la
putréfaction.
Les Bonis évitent surtout de se servir du bois d'un arbre qui possède la propriété
de conduire l’électricité.
Plusieurs d'entre eux naviguant dans une crique où il y avait des gymnotes électriques,
avec des canots faits du bois bon conducteur, ressentirent des secousses qui
les firent tomber à la renverse.
Leurs pagayes, étroites et très allongées, ont la forme d'une lance.
Pour calfater leurs pirogues, ils se servent de l'aubier, préalablement écrasé
à coups de massue, d'un grand arbre (Bertholetia excelsa.) qui donne une amande
enveloppée d'une coque trigone : coque que les habitants du bas Yary expédient
en Europe sous le nom de castâna .
En guise de goudron, ils imprègnent cette étoupe d'une substance dure, noirâtre,
appelée manil.
Cette résine est employée par les indigènes des Guyanes pour enduire les fils
des arcs et des flèches.
Les voyageurs qui remontent le Maroni ne doivent pas compter sur les produits
agricoles des populations noires.
Ils doivent se procurer, dans le bas des rivières, la quantité de couac et de
riz indispensables pour arriver chez les Roucouyennes de l'Itany.
Depuis Sparouine jusqu'au village des Roucouyennes, on doit se considérer comme
traversant un désert de plus de cent lieues de largeur, nécessitant trente jours
de navigation à raison de huit heures par jour .
Les nègres des grands bois cultivent quelques plantes : le riz, les ignames,
les patates, le maïs, les cannes à sucre; mais ils s'occupent si peu de ces
diverses plantations qu'il est à peine utile de les mentionner .
Le riz. Le riz est remarquable par la grosseur de ses grains. Il se conserve
bien moins que le riz acheté à Cayenne, venant de Chine, sans doute, parce que
sa dessiccation n'est pas aussi complète.
Pistaches. Nous avons mangé quelques pistaches qui nous ont paru plus belles
que celles du Sénégal; il est à regretter que cette culture soit à peu près
abandonnée.
Café. Le café est d'un grain très gros et très aromatique; mais on à beaucoup
de mal à s'en procurer plus de quelques poignées.
Coton. Le coton est également de bonne qualité, mais excessivement rare; la
plupart des hamacs sont de fabrication indienne.
Tabac. Le tabac est bon, mais rare. Les nègres Bosch des deux sexes fument la
pipe et la cigarette.
Les pipes sont faites avec de l'argile qu'ils font cuire comme les vases en
terre.
Les Bonis connaissent l'usage du tabac. Les personnes des deux sexes fument.
Ils remplacent le papier à cigarette par l'écorce de divers arbres qui se divise,
après dessiccation, en lamelles minces; leurs cigarettes sont longues d'environ
quinze centimètres ; elles renferment une feuille de tabac non découpée. Pour
les empêcher de se dérouler, ils les entourent avec une ou deux petites lanières
de la même écorce.
Les Bonis ont une manière particulière de priser : ils se servent, non pas de
la poudre de tabac, mais du produit d'une macération concentrée de cette plante.
A les voir aspirer par le nez ce liquide noir, qui retombe ensuite sur leurs
lèvres, on ne se sent guère de velléité de les imiter.
Légumes. La culture des légumes est insignifiante; les abatis ne contiennent
que du piment, quelques calalous et des melons d'eau .
Ce dernier fruit était autrefois cultive en très grande quantité. J'ai déjà
dit que le village de Pampou-groon, qui à été occupé par les Bonis fuyant les
Hollandais, tirait son nom de pampou, melon d'eau, et de groon, qui veut dire
terrain. .
Arbres fruitiers. On trouve également quelques arbres fruitiers aux alentours
des villages. Ce sont des manguiers, des bananiers, des orangers, des papayers
et quelques ananas. On rencontre plusieurs manguiers d'une taille gigantesque
près de Cotica, à l'endroit où s'élevait le village de Pobianchi (Providence),
qui était jadis habité par le chef de la tribu.
Sucre. On cultive quelques cannes à sucre, pour les manger au fur et à mesure
qu'elles mûrissent, sans aucune préparation. On en fait aussi une boisson légèrement
fermentée, qui est des plus agréables.
Nous l'avons toujours trouvée de beaucoup supérieure au cachiri, qui est, ainsi
que nous l'avons expliqué déjà, un produit de la farine de manioc fermentée.
Pèche. La pèche et la chasse sont les occupations favorites de ces sauvages.
La pèche ne se fait guère que de deux façons. On prend les petits poissons avec
des plantes enivrantes, telles que le conami, le sinapou et la liane du robinia
nicou. Les deux premières sont cultivées dans tous les abatis, tandis que le
nicou se récolte dans la forêt vierge, sur le bord des rivières.
On chasse plutôt qu'on ne pèche le gros poisson au moyen de flèches en roseau
terminées par un harpon. Les principaux poissons qu'on prend de cette façon
sont le coumarou, l'aymara et le cocota.
Le coumarou est un poisson qui se tient dans les eaux vives et limpides des
sauts. Il pèse trois ou quatre livres; sa chair blanche et ferme est excellente,
rôtie ou bouillie avec du piment.
La partie la plus recherchée est celle qui est voisine de la tète; les sujets
les plus gras sont les plus estimés.
Lorsque la pèche est abondante, on voit les Bonis ouvrir le ventre aux poissons
et les rejeter aussitôt s'ils ne trouvent pas assez de graisse autour des intestins.
Le coumarou, très musclé, jouit d'une vivacité extraordinaire; on l'attaque
généralement au moment où il remonte les rapides. On le trouve en telle quantité
dans certains sauts de l'Aoua et du Yary, qu'on peut en prendre deux ou trois
en l'espace de quelques minutes.
Le coumarou atteint par une flèche munie d'un harpon continue sa course, mais
il nage beaucoup moins vite, non seulement à cause de sa blessure, mais parce
que le poids de la flèche tend à le renverser de côté. Lorsque ces poissons
sont en grand nombre, les Bonis lancent quatre ou cinq harpons à la suite, sans
s'inquiéter du résultat de leurs coups.
Ce n'est qu'après avoir épuisé tous leurs engins qu'ils se mettent à la poursuite
des poissons blessés.
En retirant le poisson de l'eau, il faut avoir soin de tenir un sabre d'abatis
dans la main droite, afin d'assommer l'animal quand sa tête paraît à fleur d’eau.
La pêche au coumarou est une véritable passion, non seulement pour les noirs,
mais pour tous les Indiens des hautes Guyanes; les nègres Bosch ne passent jamais
un saut sans s'arrêter pendant des heures-entières à cette occupation récréative.
Pendant ce temps, le voyageur est abandonné en plein soleil, et n'a d'autre
ressource pour se délasser que de se promener sans abri sur des rochers qui
lui brûlent les pieds.
Ce sont ces arrêts intempestifs qui ont failli causer la mort des deux missionnaires
qui nous accompagnaient, et du pauvre petit Indien qui me servait de domestique.
Ce qui exaspère surtout le voyageur, c'est de voir ses canotiers s'amuser à
pêcher lorsqu'ils ont déjà du poisson en quantité plus que suffisante. Cependant
malheur à lui s'il s'impatiente et se laisse aller jusqu'à adresser des reproches
à ses hommes pour les rappeler à leur devoir ! Car, plus il s'emportera, plus
ceux-ci s'obstineront à le laisser cuire aux ardeurs du soleil.
L'aymara, plus gros que le coumarou, pèse quatre on cinq kilogrammes; il présente
une certaine analogie de forme avec la carpe de nos rivières; sa chair tendre
et grasse est meilleure bouillie avec du piment que rôtie.
La meilleure partie est la queue. Ce poisson à l'inconvénient de se conserver
très peu de temps par le boucanage ; la graisse qui continue à suinter, même
après cette opération, amène très rapidement la putréfaction.
L'aymara ne vit que dans les eaux calmes; on le rencontre surtout près de l'embouchure
des petites criques, où on le voit dormir sur la vase.
Pour le surprendre au gîte, il faut avoir soin de marcher très doucement avec
une légère pirogue. Un jour, un de nos hommes a tué à coups de fusil un gros
aymara qu'il avait aperçu dormant dans le tronc d'un arbre pourri, tombé au
milieu de la rivière. Il est impossible de tirer un second coup sur un poisson
manqué, car en fuyant il trouble tellement la vase qu'il n'est plus visible.
L'aymara blessé se réfugie souvent dans des racines ou des broussailles, où
il parvient quelquefois à se dégager de la flèche qui le blesse.
Si l'on voit -qu'il est sur le point de s'échapper, il faut s'empresser de lui
décocher un nouveau harpon. L'aymara et le coumarou se nourrissent de graines,
d'herbes, ainsi que de petits poissons : On les trouve en grand nombre
sous les copayers (copahiva Guyanensis) qui laissent tomber leurs graines dans
la rivière. Nous avons vu souvent le coumarou manger les herbes qui couvrent
les roches des rapides et qui sont alternativement baignées et desséchées dans
les diverses saisons de l'année. Le mourera Fliuviatilis, remarquable par ses
jolies fleurs violettes et ses feuilles, qui ressemblent beaucoup à celles de
l'acanthe, est désigné par les noirs du Maroni sous le nom de coumarou nianian
(nourriture des coumarous).
Le Comata (langue bosch), Alamachi (langue roucouyenne), est un poisson moins
volumineux que le coumarou, et remarquable par la singulière conformation de
sa bouche, qui à la forme d'un véritable suçoir. Cet animal aspire, avec cet
organe, le limon qui se trouve sur les roches. C'est un véritable géophage :
nous n'avons jamais ouvert les entrailles de ce singulier animal sans les trouver
remplies d'une grande quantité de boue. Il est probable que la terre dont il
se nourrit contient en abondance des animaux et des plantes microscopiques.
Les Bonis s'amusent quelquefois à lancer des flèches sur un poisson désigné
sous le nom de piraï. Cet animal, un peu plus gros que le coumarou, est très
redouté de tous les indigènes des Guyanes.
Deux Bonis, que nous avons eus à notre service, ont été attaqués par ce poisson
pendant qu'ils traînaient des pirogues dans les chutes. L'un d'eux à eu deux
doigts de pied enlevés, l'autre à perdu un gros morceau des chairs du talon
.
Ces poissons suivent quelquefois les embarcations, comme les bonites et les
requins qui nagent dans les eaux du navire; il est très dangereux de mettre
ses mains dans la rivière pour les rafraîchir.
Un jour, un de nos hommes ayant éprouvé de la résistance en relevant sa pagaye,
nous a dit que ce devait être quelque piraï qui s'y était attaché. En effet,
nous avons pu nous convaincre de la puissance des mâchoires de ce poisson, en
voyant l'empreinte profonde de ses dents à l'extrémité de la rame .
Il ne faut pas supposer que ces sauvages sont tous d'une grande habileté à frapper
le poisson de leurs flèches. Quelque uns d'entre eux sont même d'une insigne
maladresse.
Durant mon séjour chez les Bonis, je fus une fois réveillé par une dispute très
vive entre l'homme et la femme d'une case voisine de la nôtre. La cause de cette
querelle de ménage était la maladresse du mari, auquel sa femme se plaignait
d'en être réduite à ne manger que des queues de coumarou et des têtes d'aymara,
c'est-à-dire les plus mauvais morceaux de ces poissons, que lui distribuaient
les voisins.
Chasse: — Les noirs du Maroni ont une passion extrême pour la chasse. Ils ne
naviguent jamais sans avoir des chiens dans leurs embarcations; et quand ceux-ci,
apercevant ou flairant un gibier sur la berge, donnent de la voix, les canotiers
abordent au plus vite, et poursuivent le gibier pendant des heures entières.
Il arrive souvent au voyageur de se trouver inopinément abandonné dans une pirogue,
qu'il est obligé de garder jusqu'au retour de son équipage.
Il ne faut pas lutter contre leur entraînement pour la chasse : ce serait un
infaillible moyen de les amener à la désertion.
Nous avons remarqué un grand luxe de chiens chez les Bonis, qui font tous les
ans des voyages de plus de cent lieues pour se les procurer chez les Indiens
Roucouyennes de l'Itany et du Yary.
Les armes dont ils se servent pour la chasse sont, outre les flèches, quelques
mauvais fusils qu'ils échangent dans le bas du fleuve.
Les gibiers principaux sont : Parmi les mammifères : le tapir, le pata, le cabiai,
l'agouti, le singe rouge, le conata, le macaque, l'aï ou paresseux et le tigre;
Parmi les oiseaux : le hocco, la maraille, le paracoi, le canard sauvage, l'ara,
le toucan ; .
Parmi les sauriens et les reptiles : l'iguane, le caïman, le boa et autres serpents.
Mammifères. — Le tapir. - Ce pachyderme, très commun dans les Guyanes, est connu
par les noirs de la côte sous le nom de maïpouri, tandis que tous les Indiens
(Emerillons, Roucouyennes, Galibis) l'appellent tapir. De la grosseur d'un petit
cheval, il a beaucoup de ressemblance avec l'éléphant. Il a le dos très large,
les jambes courtes, le nez terminé par une espèce de trompe. Cet organe, qui
se raccourcit à volonté, sert au toucher et non à la préhension : le tapir prend
les objets avec ses dents.
Durant notre voyage nous avons trouvé très souvent des empreintes de cet animal,
et aussi bien dans le haut des rivières que près de leur embouchure.
Le tapir se tient généralement aux environs des cours d'eau. On s'assure facilement
de sa présence par les profondes empreintes qu'il laisse dans l’argile.
Ses membres antérieurs sont terminés par quatre doigts recouverts de sabots,
et les postérieurs par trois seulement.
Les déjections de cet animal, qu'on rencontre à chaque instant sur les rives
du Maroni et du Yary, ont la plus grande ressemblance avec celles du cheval.
Le tapir se nourrit exclusivement de plantes herbacées.
Le tapir circule surtout pendant la nuit; nous avons été réveillés quelquefois
par son passage à quelques pas de nos hamacs. On l'entend, dans l'obscurité,
brouter l'herbe et les jeunes pousses qui se trouvent sur les bords de la rivière.
On pourrait croire que cet animal, qui n'a pour toute défense que l'épaisseur
de sa peau, souffre beaucoup des tigres; mais un Boni nous à dit avoir achevé
un grand tigre qui avait été blessé dans une lutte avec un maïpouri.
Celui-ci, attaqué par derrière au moment où il dormait paisiblement, s'était
précipité tète baissée au milieu d'un fourré très épais, et y avait assommé
son adversaire.
La tète du tapir comprimée latéralement agit comme l'éperon d'un navire pour
ouvrir un passage à travers les fourrés les plus épais .
Cet animal est assez facile à tuer lorsqu'on le surprend au moment où il traverse
les- rivières; sur neuf tapirs que nous avons poursuivis, nos hommes n'en ont
tiré que deux, parce qu'ils n'employaient que des chevrotines.
En examinant les victimes de nos chasseurs, nous avons vu que les chevrotines
glissent sur la peau en n'y produisant qu'une simple contusion; il n'y a que
les balles tirées à une faible distance qui soient capables de produire des
plaies pénétrantes.
Le tapir n'est dangereux que lorsqu'il est blessé : il lui arrive alors
de se retourner même contre une pirogue, qui le poursuit, et de la faire chavirer
d'un coup de tête.
La chair du tapir est excellente ; lorsque l'animal est gras et jeune, elle
à tout à fait le goût du boeuf; la partie la plus recherchée est une bosse de
graisse très ferme, ayant la consistance de la couenne de lard, et qui se trouve
au niveau de la crinière .
Le tapir, d'un naturel timide, n'attaque pas l'homme, même pour ses jeunes.
Ayant poursuivi un jour un tapir femelle et son petit, dans un endroit où le
Yary est large, mais peu profond, nous avons vu celle-ci prendre la fuite toute
seule. Il est vrai qu'elle n'a point quitté le rivage avant que nous ayons
relâché sa progéniture qu'un de nos nègres tenait enlacée clans ses bras vigoureux.
Le petit animal poussait des sons aigus, comparables aux sifflements de certains
singes.
On a dit que le tapir ne sortait dans la journée que par les temps de pluie
: c'est une erreur. Nous avons vu neuf tapirs se promener près des bords de
la rivière et la traverser pendant la saison des fortes sécheresses, en plein
midi.
Au dire des habitants du haut Maroni, il arrive quelquefois que le tapir, broutant
l'herbe de la rivière, est assailli par un serpent boa qui l'enlace rapidement
de ses anneaux. Il ne succombe généralement pas dans cette lutte avec le géant,
des reptiles. Ceux qui ont observé un de ces combats disent qu'une fois saisi
il fait un mouvement d'expiration pour diminuer le diamètre de sa poitrine;
le boa profite de ce mouvement pour resserrer les anneaux autour de sa proie;
alors le tapir, d'un mouvement d'inspiration, qui est d'autant plus grand que
l'expiration à été plus forte, dilate subitement son thorax et détend les anneaux
du reptile.
Les Bonis racontent qu'un homme vigoureux de leur tribu est parvenu à se dégager
ainsi de l'étreinte d'un boa, en dilatant fortement sa poitrine.
Paca, Agouti, Cabiai. — Ces trois gibiers appartiennent à la famille des rongeurs.
Les mots agouti et cabiai ont été empruntés à la langue
des indigènes des Guyanes. Agouti se prononce en Galibi et en roucouyenne comme
en français, mais cabiai se dit capiaï et quelquefois capionar .
L'agouti et le pata ont une chair ferme et excellente.
Le cabiai est le plus gros des rongeurs connus; il présente la particularité
d'avoir des pattes à moitié palmées; c'est ce qui lui permet de passer une partie
de son existence à courir les rivières. S'il est poursuivi par les chasseurs,
il plonge comme un canard.
Nous avons rencontré un grand nombre de cabiais sur le bord de toutes les rivières
des Guyanes. Dans les chutes du Yari nous avons vu quelquefois de petites familles
de ces bêtes, composées du père, de la mère et d'un petit, regarder passer notre
pirogue sans manifester la moindre crainte.
Pécari. Au sujet de cet animal nous transcrivons textuellement les notes suivantes
que nous avons écrites le 5 août dans le village de Cotica :
« Je suis allé aujourd'hui au village de Pobianchi, voir un sauvage nommé
Apatou, qui paraît décidé à remonter le fleuve.
« Au retour, nous entendons un cri d'alarme qui part du village : « Pingo
! pingo ! Mon compagnon court ventre à terre et disparaît en un clin d'oeil.
Ne sachant de quoi il s'agit et voyant les femmes et les enfants se précipiter
vers la rivière, je cours moi-même dans cette direction, pensant qu'un grand
malheur est arrivé, et que mes connaissances médicales pourront servir.
« Pingo! pingo ! Gadou ! » S’écrie une femme qui me montre plusieurs points
noirs dans la rivière. Quinze pirogues sillonnent le fleuve dans tous les sens;
on entend des coups de fusil, et l'on voit les pagayeurs se lever à chaque minute
pour frapper à coups redoublés sur les corps noirs en question.
« Quel est donc l'animal qui donne lieu à cette chasse effrénée ?
Est-ce un poisson, ou bien un mammifère amphibie ? Enfin le champ de bataille
se rapproche, on distingue les combattants. Les points noirs sont des têtes
qui ressemblent à celle du sanglier, la lutte va finir; les derniers survivants
reçoivent sur le nez de grands coups qui les assomment. Une petite tête dépassant
à peine le niveau de l'eau à échappé aux regards des chasseurs; je reconnais
un petit pécari que je recueille dans mes bras au moment où il atteint la rive.
« Les pirogues chargées à couler bas reviennent au plus vite. On pousse des
cris de joie. Une légère embarcation montée par un homme et sa femme rapporte
sept pécaris d’un poids moyen de vingt kilogrammes. Notre équipage, n'ayant
plus de canots et s'étant embarqué à bord de différentes pirogues montées par
des Bonis, reçoit trois pécaris et demi pour sa part de prise.
« Le soir, après dîner, je vais fumer un cigare dans la case d’un voisin.
Ces braves gens sont radieux et bénissent le Gadou (bon Dieu) de leur avoir
donné trente-huit pingos. Hommes et femmes travaillent avec la plus grande activité
à préparer la viande. Tous ne procèdent pas de la même façon pour enlever les
poils, qui ressemblent aux soies de sanglier : les uns passent le corps tout
entier sur une flamme vive et raclent la peau avec un couteau; les autres coupent
la viande par quartiers et la plongent dans l'eau bouillante pour arracher ensuite
les poils à la main.
« Je remarque qu'on rejette au loin un morceau de peau de la région lombaire
: elle renferme une glande sécrétant une matière blanche qui a l'odeur du musc.
Cette glande, se trouvant immédiatement sous le derme, à une longueur de six
centimètres, sur trois de largeur, et sept ou huit millimètres d'épaisseur;
à l'oeil nu, elle présente les plus grandes analogies de structure avec les
glandes salivaires de l'homme; son canal excréteur débouche dans un petit mamelon
qui est recouvert de poils.
« La viande est disposée sur des espèces de treillis élevés à un mètre
du sol et soutenus par trois ou quatre piquets. Au-dessous, on allume un grand
feu qu'on entretiendra pendant toute la nuit.
« Demain, on aura une viande qui se conservera pendant quatre ou cinq jours;
elle sera boucanée.
« Le boucanage est le seul procédé employé par les indigènes des Guyanes
pour la conservation du gibier et du poisson. La viande boucanée est réellement
bonne; la surface, devenue un peu croustillante à la flamme, à une légère odeur
qui flatte le palais.
« En voyage, on peut conserver le gibier pendant longtemps si l'on a soin
de le placer chaque nuit sur Un boucan.
« La chair ainsi conservée se mange généralement bouillie, mais on peut
la consommer sans aucune préparation.
Il est à noter que les noirs du Maroni, aussi bien que tous les Indiens, n'enlèvent
pas la peau du gibier, mais se contentent seulement d'arracher les poils.
« Nous avons été quelquefois effrayés par des beuglements épouvantables qui
partaient de la rivière. C’était une bande de loutres qui remontaient le courant
à la poursuite du poisson.
«Les Bonis ne chassent la loutre que pour se divertir, car ils ne font aucun
cas de sa viande, qui à mauvaise odeur, ni de sa peau, parce qu'ils n'ont pas
besoin de fourrures. .
En descendant le Yary, un de nos hommes à été assez habile pour envoyer sa flèche
dans la bouche d'une loutre au moment où elle arrivait à la surface de l'eau
pour respirer. »
Docteur Jules CREVAUX .
(La suite à la prochaine livraison.)
VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'INTÉRIEUR DES GUYANES
PAR M. LE DOCTEUR JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE FRANÇAISE
1876-1877
TEXTE ET DESSINS INÉDITS .
VI
Singes. — Un duo par un seul singe hurleur. — Macaque et abeilles. — Oiseaux : le poco, la maraille, regarni. — Sauriens. — Serpents. — Les danses. — Le mariage. — La religion. — Les funérailles. — Le gouvernement et la justice. — Le langage.
Mammifères (suite). — Les Bonis chassent trois
espèces de singes, ce sont : le singe rouge ou hurleur,que les anciens habitants
des Guyanes désignaient sous le nom d'alouata; le singe noir ou couata, et le
singe blanc, que les Bonis et les noirs de la côte appellent macaque.
Le singe rouge est très commun dans tout le pays; il n'est pas de nuit où nous
n'ayons été éveillés par ses hurlements, qui, bien que plus forts que les beuglements
d'un boeuf qu'on égorge, ont une certaine ressemblance avec eux.
Cet animal se fait entendre surtout le matin, à l'heure où les coqs réveillent
les habitants du village. Une particularité intéressante, c'est que le singe
hurleur est capable de donner en même temps des sons aigus et des sons graves,
de manière à faire croire que deux individus s'accompagnent.
L'examen attentif de l'appareil vocal du singe hurleur nous rend compte de ce
phénomène.
Chez lui, l'air sortant des poumons par la trachée peut suivre en même temps
deux directions différentes : ou sortir directement par la glotte, ou passer
par une énorme cavité creusée dans l'os hyoïde, et qui forme un véritable résonateur.
L'air qui sort directement donne les sons aigus, tandis que celui qui passe
dans la caisse de l'os hyoïde produit les sons graves et sonores.
En examinant à plusieurs reprises des bandes de singes hurleurs, nous avons
remarqué que lorsque l'un de ces animaux se livre à ces exercices de chants
plus ou moins harmonieux, il se promène seul tout le temps que dure ce concert
peu récréatif, tandis que ses compagnons restent dans une immobilité complète.
Il est à noter que c'est toujours le plus gros mâle qui lance en se promenant
ces véritables duos à travers l'espace.
Le singe hurleur a le cerveau petit relativement à la grosseur de son corps,
et encore ses circonvolutions cérébrales sont-elles peu développées.
Le couata ou singe noir est beaucoup plus intelligent et plus habile que le
singe hurleur. Il a le cerveau relativement volumineux et les circonvolutions
cérébrales nombreuses.
Nous avons vu un couata de taille moyenne poursuivre un gros singe rouge, qu'il
frappait à coups de bâton.
Les mains du couata sont remarquables par leur peu de largeur et leur longueur
démesurée.
La chair de ce singe constitue un excellent aliment, de beaucoup préférable
à celle du singe rouge et du macaque.
La graisse du couata, liquide à la température de la zone torride, est excellente
pour graisser les fusils et pour faire la cuisine.
Le macaque ou singe blanc est l'espèce la plus commune dans les Guyanes. Cet
animal donne des preuves manifestes d'intelligence.
Pendant que nos hommes couraient le bois, nous avons assisté un jour à un curieux
spectacle: Un gros macaque se tenait posté devant un essaim de mouches à miel
: l'index gauche, placé devant l’ouverture du nid, se relevait de temps en temps
comme le clapet d'une soupape.
La mouche qui se présentait à cette porte entrouverte était habilement saisie
entre le pouce et l'index de la main droite et placée sous la dent.
Un tout petit singe, qui se trouvait à côté, manifestait un air d'envie à chaque
capture. Enfin, furieux de ne pas prendre part à ce festin, dont l'éloignait
impitoyablement la menace d'une calotte bien appliquée par le gros singe, il
se précipite d'un bond sur le nid, le met en morceaux, et s'enfuit au galop.
Legros macaque, auquel sa gloutonnerie n'avait pas permis de prévoir ce tour
machiavélique, est assailli par des milliers de mouches qui lui font payer cher
son égoïsme.
Oiseaux. — Les meilleurs oiseaux sont ceux qui appartiennent à la famille
des gallinacés, principalement le hoco et la maraille.
Le hoco, qui est du volume d'une petite dinde, est très facile à tuer; son bréchet
est recouvert d'une couche musculaire épaisse, que l'on peut faire griller comme
de véritables filets de boeuf.
Le mâle se fait entendre assez souvent pendant la nuit, et de grand matin, comme
le coq. Il se distingue de la femelle en ce que le panache, qu'il porte en guise
de crête, est complètement noir, tandis que celui de la femelle est tacheté
de blanc.
Cet oiseau, très facile à apprivoiser, se promène comme les poules autour des
habitations; nous en avons vu une paire apprivoisée qui faisait son nid sur
un arbre.
Les hocos se servent de petites branches qu'ils cassent avec leur bec et qu'ils
disposent avec les pattes d'une façon très ingénieuse.
La maraille se tient sur les arbres ; elle donne une chair excellente lorsqu'elle
est grasse.
Agami — Très commun sur le bord des rivières, on ne le mange qu'à défaut
d'autre gibier. Ces oiseaux attaquent les serpents les plus dangereux pour en
faire leur pâture.
Sauriens —Dans l'ordre des sauriens, nous trouvons le caïman. Le mot
caïman, qui sert à désigner les crocodiles d'Amérique, est usité chez
les indigènes des Guyanes qui n'ont jamais eu de rapports avec la civilisation.
La chair de ce saurien, qui à une forte odeur musquée, n'est jamais mangée par
les nègres Bosch.
Il nous est arrivé de mettre pied à terre à côté d'un caïman que son immobilité
nous faisait prendre pour un morceau de bois mort. Cet animal féroce n'avait
qu'à ouvrir la gueule pour nous saisir par une jambe; mais, loin de nous attaquer,
il se laissa choir à l'eau et se sauva.
Un Boni qui m'accompagnait ayant voulu prendre des oeufs de caïman fut poursuivi
avec une telle célérité qu'il ne trouva d'autre moyen d'échapper à son adversaire
qu'en grimpant au plus vite sur un arbre.
Notre compagnon serait resté de longues heures dans cette position s'il n'avait
frappé d'une balle le caïman,qui l'assiégeait avec l'opiniâtreté d'une mère
défendant sa progéniture.
Le caïman attaque avec avantage tous les mammifères qui traversent la rivière;
mais, à terre, le tigre lui livre des combats desquels le puissant représentant
de la race féline sort généralement vainqueur.
Nous avons vu un caïman sans queue que des piraïs dévoraient tout vivant. Nos
compagnons nous ont dit que ce malheureux avait dû se battre avec un tigre qui
lui avait arraché cet appendice.
Le tigre, n'osant affronter la mâchoire formidable de son ennemi, saute sur
son dos et lui arrache la queue, qu'il dévore à son aise. Le caïman mutilé regagne
au plus vite la rivière pour se mettre en sûreté, mais il est aussitôt attaqué
par les piraïs, qui lui déchirent la plaie pour se repaître de son sang.
Iguanes. — On trouve un grand nombre d'iguanes sur le bord des rivières; on peut les tuer avec un fusil ou une flèche lorsqu'on les voit sur des arbres qui sur plombent la rivière. Souvent ces animaux se précipitent dans l'eau dès qu'ils voient une pirogue. Nous avons saisi un iguane qui s'était assommé en tombant sur le bord de notre embarcation. Lorsque la rivière n'est pas profonde, les Bonis flèchent l'animal ou bien vont le prendre à la main, ce qui est très facile.
Serpents. — Les reptiles sont représentés par
un grand nombre d'espèces dans les Guyanes. Ces animaux se tiennent de préférence
sur les lianes qui bordent les rives; nous avons manqué de nous faire piquer
en cueillant les fruits parfumés d'une passiflore que les gens de la côte appellent
Marie-tambour,et dont les serpents sont très friands.
Une espèce de serpent aquatique, que les Bonis appellent ouatra yacouca,est
particulièrement dangereuse pour les voyageurs qui suivent les rivières.
Le serpent boa est assez commun dans les rivières ou sur leurs bords.
Cet animal se nourrit d'animaux inoffensifs qu'il surprend 'lorsqu'ils viennent
s'abreuver sur le bord des rivières ou bien lorsqu'ils les traversent.
Mon fidèle Apatou, voyant un jour son chien emporté dans la rivière par un boa
gigantesque, n'hésita pas à se porter à son secours,et ce ne fut pas sans une
grande émotion que j'ai assisté à la lutte de mon compagnon de route contre
le redoutable habitant de ces contrées peu hospitalières.
Les anneaux du reptile gigantesque entouraient le pauvre animal, le pressaient,
l'étouffaient et semblaient devoir faire déjà craquer ses os; mais bientôt ils
furent tranchés par le sabre d'Apatou, qui ramena triomphant son chien vivant
sur le rivage. Les nègres Youcas mangent volontiers la chair du boa, ainsi que
celle des serpents venimeux. Une répugnance invincible m'a empoché de goûter
de ce mets peu engageant
Danses. — Les nègres du Maroni aussi bien que
tous les noirs d'Afrique dansent avec frénésie. Deschants et une musique infernale,
composée de tam-tam et quelquefois de vieilles casseroles, donnent au danseur
un entrain indescriptible.
Les femmes laissent échapper par intervalles depetits sons perçants; parfois
leurs jambes ne se déplacent pas : elles font seulement quelques petitsmouvements
qui rappellent, jusqu'à un certain point, les Espagnoles dansant la bandera.
Ces sauvagesses ont une manière particulière de saluer : elles abaissent légèrement
le corps par Une flexion des genoux, sans incliner le buste, et se relèvent
brusquement. C'est ainsi qu'elles remercient le voyageur qui leur fait cadeau
de quelques aiguilles ou autres menus objets.
Mariages. — Les nègres Bosch n'ont généralement
qu'une femme; il n'y a guère que les chefs qui en possèdent deux ou trois. Le
Gran-man n'accorde une femme aux jeunes gens qu'autant que ceux-ci ont montré
leurs dispositions pour le travail en plantant un champ de manioc et en construisant
une petite maison.
Un jeune homme paresseux ou incapable est condamné au célibat. Les unions entre
cousins germains sont assez fréquentes, mais elles sont rares entre frère et
soeur. Les enfants nés de ces derniers mariages ne m'ont pas paru moins forts
que les autres. Nous devons pourtant signaler que cette sorte d'union est un
acte réprouvé parles sauvages. Un nègre Youca qui vit dans de semblables conditions
est obligé de se tenir dans l'isolement, ses voisins refusant la fréquentation
de sa maison.
Ces noirs ont généralement trois ou quatre enfants, et quelquefois huit ou dix;
les jumeaux ne sont pas rares; on nous à montré une femme qui avait eu trois
enfants de la même couche. La poitrine de ces négresses est d'un volume ordinaire
et n'a rien de répugnant.
Je donne textuellement mes impressions telles que je les ai écrites au village
de Cotica le 12 août 1877.
Religion. — Un chef (le Gran-man) m'apporte
une poule domestique qu'il vient de tuer avec une flèche.
Je l'invite à s'asseoir dans mon carbet, et, pendant que nous prenons un café,
je l'interroge sur ses croyances religieuses. Il me dit que tous les nègres
du haut Maroni ont un bon Dieu qu'ils appellent Cadou. C'est lui qui a fait
les hommes, les singes rouges, le riz, les pingos, le manioc (sic).
Le Gadou à une femme connue sous le nom de Maria et un fils nommé Jest Kisti.
J'étonne beaucoup mon sauvage en lui disant que nous appelons le fils de Dieu,
Jésus-Christ, et sa mère Marie.
Il n'a aucune notion sur le Saint-Esprit.
Je lui demande ce que les nègres Bonis deviennent après la mort : il me répond
qu'il n'a pas d'opinion bien arrêtée sur cette question, mais il pense que les
bons vont avec le Gadou et les mauvais avec le Didibiou diable.
D'où viennent ces idées religieuses, qui ont une si grande analogie avec le
christianisme? Il est hors de doute qu'elles leur ont été transmises par leurs
ancêtres qui furent captifs chez les blancs.
Les Bosch adorent certains animaux, mais pas tous les mêmes; telle famille respecte
le singe rouge, telle autre la tortue, telle autre le caïman, etc.
Beaucoup ne mangent pas la viande de capiaï sous prétexte qu'elle donnerait
la lèpre. Remarquons que cet animal présente beaucoup d'analogie avec le cochon.
N'y aurait-il pas chez ces sauvages une notion vague de la loi de Moïse, qui,
par mesure hygiénique, défendait à son peuple de manger la viande de porc ?
Ces noirs sont très superstitieux : ainsi jamais ils ne diront le nom d'un saut
au moment où ils le passent.
Le voyageur fera bien de se renseigner avant le départ sur les chutes qu'il
doit successivement franchir dans la journée.
Lorsque l'obstacle est dangereux, ils recommandent aux canotiers étrangers de
garder le plus profond silence, ou au moins de ne parler que très bas afin de
ne pas éveiller la colère de la Divinité. Quelquefois ils me demandaient un
peu de tafia pour faire une offrande au Gadou vers le milieu de la chute.
Il est vrai que le sacrificateur prélève généralement une forte part sur ces
libations.
Funérailles. — Les morts sont conservés huit
jours, pendant lesquels on se livre à des danses et à des chants lugubres.
Le cercueil est transporté matin et soir dans tout le village par des hommes
qui l'inclinent à droite et à gauche pour imiter des mouvements de salutation.
On considère comme un bon augure ces politesses que le défunt semble adresser
en passant devant les carbets.
Ledit cercueil fait de longues haltes au milieu du conseil, réuni sur la place
pour le recevoir. Les plus anciens lui font chacun des questions auxquelles
il répond en s'inclinant à droite, à gauche, en avant,en arrière.
Tous les matins, un vieillard dont la voix n'est pas moins désagréable que celle
du singe rouge, pleure en chantant jusqu'à ce que ce roi des forêts vienne s'associer
à la douleur de la nation.
Les cadavres ne sont inhumés qu'en état de putréfaction avancée. J'ai été assez
heureux pour ne pas rencontrer le Gran-man et sa femme défunts en chair et en
os. Ceux-ci, étant morts dans le bas de la rivière, n'ont pu être transportés
tout entiers : on s'est contenté de rapporter leurs cheveux et leurs ongles.
La fosse, qui avait six pieds, était garnie au fond de madriers disposés en
long et en travers. De nombreux objets ayant appartenu aux défunts furent déposés
dans la terre avec leurs restes.
Gouvernement. — Justice. — Épreuves. — Les diverses tribus noires du
Maroni sont gouvernées par un chef qui porte le titre de Gran-man. Le pouvoir
est héréditaire. Le Gran-man actuel des Bonis est par les hommes un descendant
du fameux chef qui adonné son nom à la tribu. Mais nous devons signaler que
le droit d'aînesse n'existe pas; le Gran-man désigne pendant sa vie celui de
ses enfants ou de ses frères qui doit lui succéder. Le Gran-man, aidé de plusieurs
lieutenants, est surtout chargé du pouvoir exécutif. à lui doit s'adresser le
voyageur pour obtenir des canotiers.
Toutes les affaires générales sont discutées par un conseil composé des notables
de la tribu. Les jeunes gens en sont exclus jusque vers l'âge de trente ans,
tandis que les vieillards en font partie de droit. Ce conseil est également
chargé de régler les différends qui existent entre personnes d'une même tribu.
Lorsqu'il y à une affaire entre des sujets de deux tribus, le conseil de justice
est mixte. Les assemblées se tiennent en plein vent ; tous les membres sont
assis sur des escabeaux, à l'exception de l'orateur, qui se tient debout.
J'ai remarqué que presque tous parlent avec une facilité qui ne le cède en rien
à la faconde des races latines. La plaisanterie n'est pas interdite à l'orateur,
et l'on voit souvent l'auditoire éclater de rire.
Les affaires criminelles sont réglées par le Gran-man et ses lieutenants.
Tout individu soupçonné de meurtre est obligé de boire le poison d'épreuve.
Nous savons par expérience que l'écorce servant à faire l'infusion présentée
au criminel, et quelque fois au voyageur qu'on veut effrayer, ne présente aucune
propriété toxique.
Quand les accusés tombent en syncope, ce qui arrive, c'est qu'ils se sentent
coupables.
Les innocents n'éprouvant aucun malaise après la prise de ce breuvage : ne sont-ils
pas convaincus qu'il est toujours sans action sur ceux qui n'ont pas commis
de crime ? J'engage les voyageurs à demander à boire le poison d'épreuve
; c'est la manière de prouver à ces sauvages qu'on vient les voir sans mauvaise
intention. Ce n'est qu'après avoir bu ce prétendu poison qu'on peut circuler
librement chez les Bonis et les Youcas.
L'arbre qui fournit le poison d'épreuve n'est connu que par le Gran-man et ses
lieutenants. D'après la légende, cet arbre merveilleux, capable de tuer les
criminels et de guérir les maux les plus incurables, a été indiqué par le Gadou
lui-même au premier chef de la nation des Bonis.
Les assassins sont condamnés à la peine de mort : on les brûle vivants
sur la place publique.
Langage. — Le langage des noirs du Maroni est
surtout composé de mots hollandais et anglais plus ou moins altérés. On trouve
en outre des expressions empruntées à l'espagnol, au français et aux divers
langages des indigènes américains.
A part les mots empruntés aux sauvages, la langue bosch est identique au créole
qui se parle actuellement dans toute la Guyane hollandaise.
Noms de nombre
|
ouan |
un |
tini |
dix |
feivitenti |
cinquante |
|
tou |
deux |
tina ouan |
onze |
siguisitenti |
soixante |
|
di li |
trois |
toualoufou |
douze |
seibitenti . |
soixante-dix |
|
fu |
quatre |
tina dili |
treize |
ouan hondro |
cent(hondred, hollandais) |
|
feivi |
cinq |
tina neigui |
dix-neuf |
ouan douzound |
mille (dinzend, hollandais) |
|
siguisi |
six |
tiventi |
vingt |
||
|
seibi |
sept |
tiventi-neigui |
vingt-neuf |
||
|
eiti |
huit |
di tenti |
trente |
||
|
neigui |
neuf |
fortenti |
quarante |
Chaque individu n'a qu'un seul nom pour le distinguer
de ses semblables; ce n'est pas un nom de famille : c'est simplement un prénom,
ce qu'est chez nous le nom de baptême, et il est donné, tantôt suivant le
caprice des parents, tantôt d'après un véritable calendrier qui ne diffère
du nôtre que par sa simplicité.
Chez nous on a le choix entre autant et plus de prénoms pour chacun des deux
sexes qu'il n'y a de jours dans l'année; tandis que chez eux il n'y a que
sept noms pour les garçons et sept noms pour les filles; ils correspondent
aux jours de la semaine.
Calendrier des nègres Bosch.
|
|
Noms d'hommes. |
Noms de femmes. |
|
Dimanche |
Couachi |
Couachiba |
|
Lundi |
Codio |
Adiouba |
|
Mardi |
Couami |
Abéniba |
|
Mercredi |
Couacou |
Acouba |
|
Jeudi |
Yao |
Yaba |
|
Vendredi |
Cofi |
Afiba |
|
Samedi |
Couamina |
Amba |
Ces gens naïfs croient que le jour de la naissance, et
par suite le nom qu'il impose au nouveau-né, influent sur le caractère des individus.
Ainsi les femmes qui sont nées le dimanche et s'appellent Couachiba ont la réputation
d'être frivoles; les Codio sont rancuniers, les Couacous ivrognes, etc...
Faisons observer que, sans être superstitieux à cet égard, nous aussi nous nous
laissons souvent influencer pour ou contre les individus rien qu'en entendant
prononcer leurs noms. Ces préjugés sont quelquefois une cause d'ennuis, et même
de malheurs, pour toute une existence.
Jours de la semaine
|
Monday |
Lundi (1er jour de travail) |
|
Tou day woko |
Mardi (2e jour de travail) |
|
Dili day woko |
Mercredi (3ejour de travail) |
|
Fo day woko |
Jeudi (4e jour de travail) |
|
Feda |
Vendredi (5e jour de travail) |
|
Sata |
Samedi (6e jour de travail) |
|
Sunday |
Dimanche (7e jour de travail) |
Noms des mois
|
Ouan moun |
Janvier (2e mois) |
Seibi moun |
Juillet (7e mois) |
|
Tou moun |
Février (2e mois) |
Eiti moun |
Août (8e mois) |
|
Dili moun |
Mars (3e mois) |
Neigui moun |
Septembre (9e mois) |
|
Fo moun |
Avril (4e mois) |
Tini moun |
Octobre (10e mois) |
|
Feivi moun |
Mai (5e mois) |
Tina ouan |
Novembre (11e mois) |
|
Siguisi moun |
Juin (6e mois) |
Toualoufou |
Décegabre (12e mois) |
Quelques autres noms d'hommes.
Cofi, Acodi, Lomi, Acoman, Diamoli, Apatou, Alamo, Dogue-Mofou.
Noms de femmes.
Yaca, Sankina.
Substantifs.
|
sopi |
eau-de-vie |
mofou |
bouche |
|
glasi |
verre |
alichi |
riz (ryst en holl. et areci en créole de Surinam) |
|
banki |
banc |
saoutou |
sel (zout en hollandais) |
|
siki |
malade |
Gadou |
bon Dieu et Ciel |
|
bata |
bouteille |
kini |
genou |
|
bolo |
bec |
tapa-bali |
tonnerre (bruit en haut) |
|
foui |
oiseau |
groom |
terrain (grond, hollandais) |
|
mapapi |
aile |
yesi |
oreille |
|
tè |
queue |
neki |
COU |
|
saca |
sac |
coyïpi |
mollet |
|
nefi |
couteau |
finga |
doigt |
|
yemba |
coton |
cepou |
jarretière |
|
hamaca |
hamac |
tetey |
corde |
|
soula |
saut |
boui |
anneau |
|
can |
soleil |
tikifoutou |
jarret |
|
moun |
lune |
manga |
ongle |
|
smoko |
fumée |
boto |
pirogue ou canot |
|
folo |
poule |
pali |
pagaye |
|
cacafoli |
coq |
hamaca tetey |
corde de hamac |
|
sebita |
pléiades |
bototetey |
corde pour haler les pirogues dans les sauts |
|
lingua |
pendant d'oreille |
watra |
eau |
|
ouidi |
poil |
wàtramofou |
salive (eau de la bouche) |
|
mongo |
montagne |
apouana |
bras |
|
rataman |
serpent |
ibaca |
dos |
|
pecina |
orange |
knopou |
bouton (knoop, holl.) |
|
eggi |
veuf |
hempï knopou |
bouton de chemise |
|
nodou |
bois |
casaba |
cassave |
|
faya |
feu |
tabaka |
tabac |
|
faya wodou |
bois à brûler |
bouschi |
grand bois |
|
osôu |
carbet |
doti |
terre |
|
chiton |
roche |
cofi |
café |
|
data |
père |
neugré |
nègre |
|
maman |
mère |
Youca neugré |
nègre Youca |
|
piquin eigué |
petit garçon |
Poligoudou neugré |
nègre Poligoudou |
|
piquin ouman |
petite fille |
coco |
poitrine |
|
patata |
pommes de terre |
cocosiki. |
malade de la poitrine |
|
planca |
planche |
tabiki |
Ile |
|
niamichi |
igname |
feti |
bataille |
|
tatamela |
fourmis |
Gadou |
bon Dieu et Ciel |
|
tifi |
dent |
kini |
genou |
|
beley |
ventre |
coco |
poitrine |
|
coumba |
ombilic |
cocosiki. |
malade de la poitrine |
|
aï |
oeil |
tabiki |
Ile |
|
cocoti |
tatouage en relief |
feti |
bataille |
|
nosou |
nez |
Verbes, adverbes et autres parties du discours.
|
meignan |
manger |
|
cognan |
viens manger |
|
deday |
mourir |
|
suigui |
chanter |
|
slibi |
dormir |
|
gui |
donner |
|
gui mi piquin casaba |
donnez-moi un peu de cassave |
|
ïa |
oui |
|
adey |
rien |
|
aïpi |
beaucoup |
Adjectifs..
|
amoï |
joli (mooi, holland.) |
|
knopoyamoï |
joli bouton |
|
odio |
bon |
|
broco |
cassé |
VII
DE CATICA AU PIED DES MONTS TUMUC-HUMAC.
Excursion au placer d'Aoura. — L'établissement de M. Labourdette désolé par la famine. — Saba et moi nous gagnons le lièvre. — Sans nouvelles de Cotica..— Trahison de Joseph. — Heureuse intervention de M. Labourdette. — Je suis obligé de renvoyer des hommes et de me séparer de Saba. — Joseph Foto.— Dogue-Mofou, Alamo et Apatou. — Leur passion pour la pêche et la chasse. — Agréments d'une station de plusieurs heures sous un soleil torride. — Avantages de la résignation. — Une observation importante pour un voyageur. — Un accès de fièvre persistant. — Le programme d'une journée de voyage. — Heureux contretemps. — Les histoires d'Apatou et de Dogue-Mofou. — Influence de la fumée de mon cigare sur le moral d'Apatou. — Nous arrivons chez les Roucouyennes. — La maladie me quitte la veille du départ. — En route pour les Tumuc-Humac. — Trente Indiens m’accompagne. — Joseph et ses querelles. — Nègres et Indiens. — Quelques détails de moeurs. — Le Knopoïamoï. — Le Maroni. — Préparatifs de départ.
Joseph s'étant chargé de faire mes provisions et de recruter un équipage, j'eus l'idée de remonter le fleuve pour aller faire des études géologiques au placer d'Aoura-Soula, situé à quatre jours de marche en amont. Je trouve l'établissement de M. Labourdette désolé par la famine; les Bonis, occupés de leurs danses, ont négligé de transporter les vivres qu'on attendait depuis plus d'un mois. A mon arrivée, tout l'établissement est en émoi; la moitié du personnel est en proie à des accès de fièvre violents; les coulies et les Arabes ne sont pas plus épargnés que les Européens. Sababodi et moi, nous retombons malades le lendemain de notre arrivé.
Après cinq jours de fièvre continue, je me rétablis Rapidement; mais ce qui me désole, c'est que le délai de dix-sept jours s'est écoulé, et je ne reçois pas de nouvelles de Cotica. Après quatre longs jours d'attente on vient m'annoncer l'arrivée des canots, au moment où je me décidais à partir à la recherche des retardataires.
Iguanes. — Joseph a manqué doublement à sa parole : d'abord en ne venant pas, ensuite en ne m'envoyant point de vivres. Les Bonis, après avoir tenté de m'arrêter par la maladie, essayent sur moi d'un autre petit jeu cent fois plus terrible : la famine.
M. Labourdette, auquel je suis heureux de témoigner ici
toute ma reconnaissance, me sauve de cette situation en m'offrant un baril de
coac qu'il vient de recevoir ; mais ce n'est pas assez pour nourrir dix hommes
pendant une traversée de quinze jours. Je me vois, à mon grand regret, obligé
de renvoyer quatre noirs de Mana et de me séparer de mon pauvre petit Sababodi,
qui est d'ailleurs gravement malade.
Le lendemain, je me mets en route avec un seul canot et quatre hommes. Saba,
que j'ai fait transporter sur la plage, sur le dos d'un Indien Émerillon, qui
chassait près de là, verse des torrents de larmes en me quittant. Forcé par
les circonstances de l'abandonner, je lui remets des lettres pour mes collègues,
le recommandant à leurs bons soins; ils se chargeront de le remettre sur pied,
et il restera à leur service jusqu'à mon retour.
Mon équipage se compose d'un homme de Mana, nommé Joseph Foto, et de trois Bonis.
Deux de ces sauvages sont des vieillards de soixante-cinq à soixante-dix ans.
L'un d'eux, nommé Dogue-Mofou, très grand et très gros, fait enfoncer par son
poids mon canot au point de le faire submerger. L'autre, qui répond au nom d'Alamo
et frère du précédent, est tout petit, malingre et incapable de marcher, par
suite de nombreuses blessures qui lui ont occasionné la perte de tous les doigts
du pied droit. Le troisième Boni se nomme Apatou. C'est un homme d'environ trente
à trente-cinq ans, qui présente des qualités physiques parfaites. C'est lui
que je choisis comme patron de notre embarcation. Joseph Foto, mon cuisinier,
est un sujet rempli, j'allais dire pétri, de bonnes intentions; mais c'est un
canotier des plus médiocres. D'un autre côté, mes hommes ne témoignent pas d'un
bien vif enthousiasme; ce n'est qu'en doublant leur solde que je parviens à
les entraîner.
Nous marchons bien le premier jour; mais, à peine arrivés dans les grands sauts
à la bifurcation de l'Aoua, les Bonis, à l'exemple des Poligoudoux, passent
de longues heures à flécher le coumarou, pendant que je me morfonds au soleil
en les attendant. La chasse a pour eux encore beaucoup plus d'attraits que la
pêche. S'ils aperçoivent la queue d'un gibier minuscule sur la rive, vite mes
scélérats sautent à terre et courent le grand bois pendant des heures entières.
Force est aux voyageurs de se résigner à les attendre avec la patience d'un
autre Job: ce que je me résous à faire d'autant plus facilement que j'ai la
triste expérience de ce qu'il en coûte de contrarier les passions de ces faces
de café au lait. Après avoir passé les grands sauts qui se trouvent près de
l'embouchure de la crique Maroni, nous entrons dans les eaux calmes de l'Itany.
En remontant l'Itany l'on est frappé de la monotonie du paysage. La rivière
présente souvent l'aspect d'une longue avenue masquée au fond par une colline
au pied de laquelle ou aperçoit des roches dénudées par les eaux. Devant ce
tableau qui se renouvelle à chaque pas, le voyageur se demande souvent de quel
côté va tourner la rivière. Rien n'est cependant plus facile que la solution
de ce problème. La rivière tourne toujours à droite si les rochers qui sont
au pied de la colline se trouvent près de la rive gauche; elle tourne à gauche
si les roches sont situées près de la rive droite.
Le pourquoi, le voici, et il s'applique également aux sauts. Les rochers forment comme le squelette d'une partie de la colline ravagée par les eaux. Le courant n'ayant pu traverser le noyau de cette masse, a dû, pour se frayer un passage, subir une déviation du côté opposé à la résistance. Cette remarque, sur laquelle j'ai insisté, est des plus importantes pour le voyageur; elle m'a permis de prendre un grand ascendant sur mon escorte, lorsque à une distance très éloignée encore, sur la nappe d'eau qu'on aurait pu croire sans fin, j'indiquais à mes hommes, qui d'abord refusaient d'y croire, même après expérience, si la rivière tournerait à droite ou à gauche. Ces hommes naïfs, surpris de me voir deviner ainsi le cours de la rivière, ne tardèrent pas à partager ma confiance sur l'issue d'une expédition que le Gadou protégeait si visiblement.
Les rives basses et marécageuses de la rivière me plaisent
d'autant moins que je prévoie des accès de fièvre. En effet, après le cinquième
jour de voyage, je sens mon appétit diminuer et finalement disparaître complètement.
Je passe une nuit agitée, et le matin je vomis le café à la quinine que j'avais
pris à mon lever. Je sens qu’un repos de quelques jours me serait indispensable,
mais il faut marcher; nous avons encore six jours de traversée pour arriver
au pays des Roucouyennes.
Ce qui me fait le plus souffrir, c'est de ne pouvoir confier à personne le secret
de ma maladie.
Je trompe Joseph en jetant aux poissons les repas qu'il continue à me servir
régulièrement. Nous continuons à marcher pendant six jours, et pendant tout
ce temps la fièvre ne cesse de me tourmenter. Je n'ai d'autres soulagements
que de m'arrêter pendant un instant au moment de la forte chaleur, qui correspond
généralement avec le maximum d'intensité de ma fièvre.
Voici à peu près le programme d'une de ces journées,
dont le souvenir restera éternellement gravé dans ma mémoire :
Je me lève à cinq heures avec un léger mal de tête. Je vais me laver le front
au bord de la rivière, mais la fraîcheur de l'eau ne produit aucun effet. Joseph
me prépare mon café, que je prends avec un morceau de biscuit dont j'ai emporté
une petite provision; mais les insectes s'y sont mis, et je ne le mange qu'avec
beaucoup de répugnance. Pendant ce temps, mes hommes mangent quelques gros poissons,
aymaras ou coumarous, qu'ils font bouillir avec du piment. Nous nous mettons
en route vers sept heures ; je m'installe sur mon petit banc, ma boussole d'embarcation
en face de moi, mon cahier de notes sur les genoux. J'inscris le tracé de la
route au fur et à mesure que nous avançons; ce travail ne me laisse de répit
que lorsque la rivière suit un long trajet en ligne droite. Vers huit heures,
la soif me prend. Je puise un peu d'eau le long du bord, avec une calebasse,
et j'en bois une gorgée.
Mais, cinq minutes après, le supplice recommence, ma soif devient aussi vive
qu'auparavant, et malgré les pressantes recommandations du brave Apatou, qui
paraît me témoigner beaucoup d'intérêt, je bois en une heure environ un litre
d'eau; et cela en me retenant le plus possible.
Vers neuf heures, je suis pris de nausées suivies de vomissements. A ce moment, généralement, j'éprouve un peu de tranquillité. La soif disparaît peu à peu, mais j'ai plus chaud, et je suis obligé de changer mon gros veston de laine contre un autre plus léger. A la fraîcheur du matin succède un soleil torride. Je mets une serviette sous mon chapeau de feutre pour me garantir contre les insolations, qui s'ont toujours très graves. Quelquefois cependant, il s'élève un peu de vent vers dix heures; j'éprouve alors une sensation de froid telle, que je serais tenté de croire à un abaissement subit de la température de l'air; cependant mes baromètres n'indiquent qu'une variation minime, quelquefois nulle.
Vers midi, le soleil commence à devenir chaud; l'attention que je suis obligé de donner à mon tracé me fatigue beaucoup. C'est le moment de prendre quelques instants de repos; malheureusement, le feuillage n'est jamais assez fourni pour m'abriter complètement contre l'ardeur du soleil, qui, je l'ai déjà dit, est d'autant plus dangereux qu'il frappe au repos.
Je remédie autant que possible à cet inconvénient en disposant tant bien que mal ma couverture au-dessus de ma tète. Vers une heure, je commence à transpirer, et, à deux heures au plus tard, nous reprenons notre marche en avant. Parfois je me trouve tout à fait bien à partir de ce moment; d'autres fois j'éprouve une peine indicible à abandonner mon hamac, et il me faut un grand bain dans la rivière pour réveiller mon organisme. La température de l'air atteint son maximum vers le moment du départ; je mouille alors la serviette qui est placée sous mon chapeau. L'évaporation de l'eau me procure fine légère fraîcheur qui n'est pas désagréable.
A partir de quatre heures, le soleil est généralement
masqué par un rideau de grands arbres qui bordent la rive. Mais lorsque les
bords sont marécageux comme dans l'Itany, le soleil nous incommode jusqu'à cinq
heures.
Cinq heures, c'est la fin de notre étape; nous avons
marché pendant huit heures en tout. Il nous arrive quelquefois de ne pas trouver
un endroit convenable pour y établir notre campement; nous continuons alors
jusqu'à six et même sept heures. Ces contretemps, dont je suis loin de me plaindre,
me font gagner beaucoup de chemin. Mes canotiers, que presse le besoin de se
réconforter par un bon et solide repas, marchent deux fois plus vite que pendant
la journée.
Arrivé au lieu du campement, je prends rapidement le croquis d'un gibier ou d'un poisson due je rencontre pour la première fois, je calcule la distance parcourue, qui varie entre quinze et vingt-cinq kilomètres, suivant les obstacles que nous avons eu à franchir; je prends ensuite mon bain, et j'attends l'heure du repas sur mon hamac ou sur un rocher.
Je prends quelques notes sur les montagnes, les îles, les criques et les sauts que nous avons rencontrés.
Apatou et Dogue-Mofou éprouvent un vrai plaisir à me
raconter, à propos de chaque accident de terrain, les faits historiques qui
s'y rattachent. C'est par ce chemin que le fils de Boni vint surprendre les
Youcas réunis en conseil, pour venger la mort de son père; c'est là, près de
la crique Juini, que les Youcas ont assassiné Boni.
En passant près de la crique Oyacoulet, ils me racontent le massacre de leurs
ancêtres par les farouches Indiens qui ont donné leur nom à la crique. Actuellement
les ennemis les plus redoutables des Bonis sont encore les Oyacoulets; c'est
précisément pendant cette saison que ces sauvages viennent dans l'Itany à la
recherche des oeufs de lézard dans les bancs de sable mis à sec. Mes hommes
font le quart à courir avec leurs fusils.
Entre six et sept heures du soir, Joseph ayant préparé le dîner pour tout le
monde, Alamo et Dogue-Mofou ayant préparé par le boucanage le poisson et le
gibier, nous mangeons à la lueur d'un morceau d'encens fixé dans un piquet planté
en terre. Après le dîner, je m'assieds par terre près du feu en fumant un cigare
avec un plaisir qui est toujours en rapport direct avec mon état sanitaire.
Apatou est content de me voir fumer : non point parce que je lui donne habituellement
la moitié de mon cigare, mais parce qu'il voit dans ces dispositions un signe
de santé chez moi. Avant de me coucher, je partage avec lui, et quelquefois
avec tout l'équipage, lorsque la journée a été bonne, quelques gouttes de rhum
fabriqué par les soeurs de Mana.
Apatou pend son hamac à côté du mien, et, quand je suis bien disposé, je lui
fais raconter ses exploits de chasse. Je remarque que cet homme est très observateur;
il me donne, sur les moeurs des animaux du pays, des détails pleins d'intérêt.
Pendant la nuit mes hommes entretiennent un grand feu qui sert à boucaner le
gibier et à chasser les animaux dangereux.
Après seize jours d'une marche non interrompue, nous
arrivons enfin au village des Roucouyennes. Je fais un peu de toilette pour
me présenter devant les chefs de ces sauvages et je fais tirer quelques coups
de fusil en leur honneur.
Personne ne vient au dégrad, les aboiements des chiens indiquent seuls
la présence d'habitants dans ces parages. Apatou me dit que les Indiens n'ont
pas l'habitude de se déranger; il faut aller les trouver. A notre arrivée à
la plus grande case, les hommes, nonchalamment étendus clans leurs hamacs, ne
bougent pas, mais les femmes nous apportent deux escabeaux et deux vases en
terre contenant du poisson bouilli avec du piment.
Quelques oiseaux apprivoisés, des toucans, des aras et des agamis, paraissent
seuls impressionnés par notre arrivée. Les agamis tournent autour de nous en
faisant des bonds singuliers.
Après une légère collation, je me couche dans mon hamac au milieu de quelques
Indiens qui se reposent; leurs femmes travaillent aux abatis.
Pendant mon séjour au milieu de ces peuplades sauvages, je suis pris d'un nouvel
accès de fièvre que je suis obligé de leur cacher.
Devant leur surveillance incessante, il faut que je me donne les apparences
d'un homme en bonne santé qui éprouve seulement une fatigue excessive et un
pressant besoin de repos et de sommeil.
Une nuit, me trouvant un peu mieux, je m'entretiens avec
les chefs que j'invite à un repas somptueux préparé par Joseph. Trois boites
de conserve, une bouteille de vin, un litre de tafia, sont absorbés dans ce
festin. Je ne me retire que lorsque mes invités me disent, dans leur langage
fort réaliste, qu'ils sont satisfaits et que leur « ventre est plein. »
Je ne puis dormir une seconde : nous sommes littéralement dévorés par les moustiques.
La fièvre me reprend dans la journée; je fais accrocher
mon hamac dans un carbet, dans le grand bois, où les Indiens passent la nuit
pour éviter les moustiques.
Un peu remis dans la soirée, j'offre un nouveau festin au tamoutchi (chef)
et aux deux membres les plus notables de la tribu. Je trouve mes hôtes plus
communicatifs que la veille : c'est sans doute parce qu'ils ont vu tous mes
bagages étalés au soleil; ces beaux couteaux, ces glaces, ces étoffes aux ,
couleurs brillantes ont excité leur convoitise.
Le tamoutchi consent à me donner tous les hommes valides de la tribu pour m'accompagner jusqu'au Yary. Il enverra le lendemain une embarcation pour prévenir tous les gens qui se trouvent dans leurs abatis. En attendant, les femmes nous préparent des galettes de conserve Pour le voyage.
Le lendemain, me sentant encore indisposé, je prends
un purgatif et de la quinine dans mon carbet, où je me traite sans être vu par
personne. Malgré ces précautions il est évident que les Indiens et les Bonis
commencent à avoir des craintes sur ma santé. Parfois ils s'approchent de mon
hamac pendant la nuit pour m'épier. La vérité est que je me trouve dans un état
de faiblesse extrême, et, en essayant mes forces, je constate que je ne puis
faire cent pas sans m'asseoir.
Comment ferai-je donc pour franchir toute la chaîne des monts Tumuc-Humac ?
Ma situation est déplorable: je n'ai plus qu'une minime confiance dans le résultat
de mon exploration. D'ailleurs l'insuccès de mes prédécesseurs n'est
pas fait pour m'encourager; c'est dans ces parages que s'est arrêtée la Commission
franco-hollandaise qui avait l'intention d'aller au Yary.
Mon collègue Chevalier a tenté deux fois le passage des
montagnes, et deux fois la maladie a trahi son énergie et sa ténacité. Il est
arrivé une première fois jusqu'à Cotica, et une deuxième au dégrad des
Roucouyennes, à la tête du sentier de 1'Apaouani.
Joseph, qui l'accompagnait, m'a dit que l'état de faiblesse dans lequel il se
trouvait lui fit perdre l'équilibre en traversant le premier ruisseau qu'on
rencontre sur la route. Une chute violente acheva de l'épuiser et le contraignit
d'abandonner son projet.
Le R. P. Kroenner n'a, pas été plus heureux : la maladie l'a arrêté une première
fois chez les Indiens Roucouyennes, et cette fois-ci chez les Bonis.
Dernièrement un chercheur d'or audacieux, M. Labourdette, est venu tenter fortune
jusque dans cette région. Ce jeune homme a été obligé de se retirer devant les
pluies qui l'ont empêché de faire aucune observation.
Par un bonheur extrême la fièvre me quitte la veille du jour que j'avais fixé
pour le départ.
Le lundi, 17 septembre, je me mets en route avec trente Indiens Roucouyennes, hommes et femmes. Nous arrivons au point de campement vers cinq heures du soir.
Pressés d'avancer, mes Bonis et mes Indiens n'ont pris
que deux aymaras et un petit couata. Le chef de mon escorte indienne, Apoïké,
qui se montre très flatté des égards que j'ai pour lui, m'apporte un gros morceau
du poisson qu'il a préparé lui-même. Il se montre fort étonné, presque humilié,
en voyant que je consomme à peine la dixième partie de son plat.
La vérité est que ne jouissant pas encore d'une santé très florissante, bien
que la fièvre ait cessé, je dois encore prendre beaucoup de ménagement. Mon
système nerveux n'est pas remis des secousses violentes qu'il a éprouvées.
Joseph, dont l'unique souci est de me bourrer de poisson bouilli ou de gibier,
ne s'occupe en rien de mon état sanitaire; il passe des heures entières à aile
remplir les oreilles de ses histoires, qui, par malheur, ne sont ni instructives
ni intéressantes. Ensuite surviennent des discussions stupides à propos de rien
entre cet irascible cuisinier et Dogue-Mofou. Ce sont à tout moment des disputes
animées, qui finiraient par des coups de poing si je n'étais constamment là
pour m'interposer. Leur ignorance leur suggère incessamment les questions les
plus absurdes du monde, ce que je ne parviens pas à leur persuader. Ces affreux
nègres passent le reste de leur temps à gémir et à se plaindre du défaut de
nourriture et de l'excès de travail.
Les Indiens, au contraire, ont marché toute la journée
sans se plaindre et presque sans parler. Quand ils se sentaient fatigués, je
les ai vus prendre leurs flûtes, qui sont faites de tibias de biche, et donner
le change à leur fatigue en jouant de petits airs pendant que les autres continuaient
à pagayer. Arrivés au lieu du campement, ils se mettent à rire et à causer entre
eux, avec une modération qui me frappe beaucoup et qui contraste singulièrement
avec la grossièreté de mes noirs.
L'Indien des grands bois, sobre dans son langage comme dans ses amusements,
se rapproche plus de la civilisation que les noirs qui ont été élevés ou qui
ont vécu parmi les blancs. L'esclavage, ou le mépris dont ils ont eu. à souffrir,
ont sans doute contribué à dégrader ces derniers. Les voyageurs en Afrique,
tels que Livingstone, ont trouvé plus de qualités intellectuelles et morales
chez beaucoup d'indigènes.
Me trouvant assez dispos au réveil, je me mets en route après le lever du soleil dans une toute petite pirogue montée par deux Indiens de bonne volonté. Le jeune Yaouchi, le meilleur joueur de flûte de sa tribu, me sert de patron de canot. Le beau Tartaicu, qui a eu l'originale idée de se peindre en noir des pieds à la tête pour paraître plus beau, se tient à l'avant de ma pirogue. L'embarcation n'étant pas chargée de bagages, nous marchons avec une rapidité prodigieuse. Mais si notre vitesse est considérable, notre attention doit être bien grande pour nous bien tenir en équilibre, car le moindre mouvement de travers peut faire chavirer notre fragile esquif et nous envoyer prendre un bain dans les eaux profondes de l'Itany, ce qui, par parenthèse, ne nous eût souri que tout juste.
Vers dix heures, nous abordons enfin à un abatis des Indiens Roucouyennes, situé dans le bois à une distance d'un kilomètre environ de la rive gauche. Nous récoltons quelques bananes et des cannes à sucre; je fais suspendre mon hamac entre deux arbres et me repose en attendant l'arrivée de mes canots.
Alamo étant tombé subitement malade dans la
matinée, je le fais redescendre. Je regrette beaucoup la perte de cet homme
qui se montrait très serviable et dont la belle humeur égalait la bonne volonté.
Nous nous remettons en route vers une heure pour arriver à cinq heures à notre
lieu de campement. Notre navigation sur le fleuve Maroni est terminée.
Enfin ! Après trente-trois jours de marche avec une moyenne
de huit heures par jour, nous arrivons au dégrad où les Indiens laissent
leurs canots dans leurs voyages à travers la chaîne des Tumuc-Humac. La largeur
de l'Itany à ce point varie entre douze et quinze mètres. Les Indiens nous apprennent
que la rivière cesse d'être navigable à une demi-journée de marche de notre
station, un peu au-dessus de l'embouchure des criques Saranaou et Coulé-Coulé.
Nous pourrions aller visiter une énorme roche de quartz blanc, réputée dans
le pays et désignée par les Bonis sous le nom de Knopoïamoï. Ce nom barbare
est composé de Knop, qui en boni veut dire bouton (c'est le hollandais
knoop), et de moï, qui veut dire joli (c'est le hollandais mooi).
C'est à ce mamelon célèbre que s'est arrêtée la Commission franco-hollandaise
dans son exploration du Maroni. En raison de ce souvenir nous lui avons donné
le nom de M. Vidal, président de cette commission, qui est encore aujourd'hui
au service de la marine française.
La direction générale du Maroni est sud un quart sud-ouest,
en considérant l'Aoua et l'Itany comme la continuation du fleuve.
Les affluents dignes d'être signalés sont : Sur rive gauche, les criques Ana,
Paramaka, Japanahoni, Gonini, les Trois Iles, Oyacoulet, Aroni, Ouei-Foutou.
Sur la rive droite, les criques Sparonine, Abou- nami , Inini , Araoua , Maroni
, Alama , Saranaou, Coulé-Coulé et Ouaremapan.
Le Maroni est un beau fleuve qui n'a pas moins de douze
à quinze cents mètres de largeur jusqu'à une distance de vingt lieues au-dessus
de l'embouchure, et quatre à cinq cents mètres à quatre-vingt-dix lieues dans
l'intérieur. Sa longueur n'est pas en proportion avec le débit de ses eaux;
en comptant les détours il n'y a que cent trente-trois lieues depuis sa source
dans les monts Tumuc-Humac jusqu'à son embouchure.
La hauteur du Maroni au-dessus du niveau de la nier est d'environ cent dix mètres
au point où nous l'avons quitté près de la crique Saranaou.
Son cours est entravé par des barrages formant une série de bassins ; il présente
plutôt l'image d'un escalier que d'un plan incliné.
Dans la soirée mes hommes descendent tous les bagages et font leurs derniers
préparatifs de départ pour le lendemain matin.
Après une bonne nuit de repos, je vais prendre un bain dans la rivière et faire
une, petite promenade pour essayer mes forces. Je m'aperçois avec plaisir que
je suis plus solide sur mes jambes que les jours précédents.
Joseph, avec sa franchise brutale, m'avait annoncé, il y a quelques jours, que
mes yeux devenaient jaunes.
Je trouve par hasard, en défaisant mes bagages, une petite glace, qui faisait partie des objets que je destinais aux sauvages. Je constate effectivement que mon domestique avait raison; mais peu m'importe la teinte de ma peau et la couleur de mes yeux, je suis trop heureux de pouvoir me tenir sur mes jambes. Si mes forces ne viennent pas à me trahir, dans une heure j'aurai dépassé tous mes devanciers.
Du reste, si je voulais me laisser aller à mes réflexions
sur ma situation présente, je la trouverais aussi mauvaise, sinon plus, que
celle de tous les explorateurs qui sont arrivés jusque dans cette région.
N'est-ce pas, en somme, une véritable folie que de s'engager dans ces forêts
désertes, avec des accès de fièvre presque journaliers, et une maladie de foie
qui a déjà profondément altéré ma constitution et qui peut devenir très grave
? Que vais-je devenir si le mal vient à empirer dans ces solitudes ? J'ai la
triste perspective de me voir abandonner par mes hommes aux premiers symptômes
du mal.
Les Indiens m'ont déclaré, en effet, avant de se mettre en route, qu'ils seraient
obligés de me quitter en cas de maladie, pour ne pas succomber eux-mêmes à la
famine.
Mais, en vue du résultat, je ne veux pas arrêter ma pensée sur ce que je puis
craindre. Le sort en est jeté. En avant !
Le 29 septembre, à huit heures et demie, mes trois Indiens
ont fini de charger mes bagages et mes provisions sur des hottes qu'ils ont
fabriquées avec des feuilles de palmier. Pour les mettre en train, je leur distribue
trois litres de tafia ; au fond, je dois avouer que ma générosité n'est pas
aussi grande qu'ils pouvaient le supposer : je ne saurais emporter ce liquide.
A trois heures nous nous mettons en route.
J'éprouve un moment de défaillance au départ; je crains
que mes jambes ne se refusent à un trajet aussi fatigant. Il me faut un grand
effort de volonté pour me mettre au pas ordinaire sans que mes compagnons s'aperçoivent
de ma faiblesse. J'y réussis mieux que je ne l'avais espéré.
Nous sommes obligés de traverser sur des rochers et des troncs d'arbres les
nombreux cours d'eau qui sillonnent notre route.
Docteur Jules CREVAUX
(La suite la prochaine livraison

[1] M. le colonel Loubère a secondé ma mission avec un empressement qui lui donne droit à toute ma gratitude .
[2] Note de la direction. — Nous passons à regret sous silence toute la partie du récit qui, relative au service médical du docteur, ferait apprécier son admirable dévouement pendant l'épidémie dont il eut à combattre les ravages aux Iles du Salut comme à Cayenne.
[3] On nomme aussi phaéton cet oiseau de mer, qui a la taille
d’un gros pigeon de volière. Deus des plumes de sa queue forment des brins ou filets très longs, qui dc loin ressemblent a des pailles.
[4] En langage créole, dégrad est synonyme de débarcadère
[5] Terme de marine pour désigner le tafia du bord. Cette expression provient sans doute du mot caraïbe arak (pain de palmier)
[6] Nous donnons cette histoire de Boni telle qu'elle nous a été racontée par les anciens du pays.
[7] C'est en l'honneur de cet exploit que Ies descendants de boni ont désigné leur village principal sous le nom de Cotica .
[8] Les villages de la Paix, de Providence (Pobianchi) et de Goromontiho ont tiré leurs louis des exploits de Boni près des habitations de la Paix, de Providence et de la rivière de Coronimitibo .
[9] Cachiri, boisson fermentée faite avec le manioc