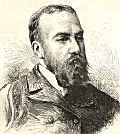
SUR LES FRONTIÈRES DU TONKIN
PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS.
TEXTE
ET DESSINS INÉDITS
(Les
gravures sont téléchargeables en en clickant sur les vignettes.
Si la gravure s'ouvre dans une 2nde fenêtre: Click droit dessus pour l'enregistrer)
I
Formation de la commission. - Départ de Hanoï en canonnière. - Débarquement à Chu.
Au mois d'avril 1885, afin d'exécuter l'article 3 du traité de Tien-Tsin signé le 9 juin, la France et la Chine nommaient une commission de délimitation des frontières du Tonkin. Cet article du traité était conçu en ces termes
« Dans un délai de six mois à partir de la signature du présent traité, des commissaires désignés par les hautes parties contractantes se rendront sur les lieux pour reconnaître la frontière entre la Chine et le Tonkin ; ils poseront, partout où besoin sera, des bornes destinées à rendre apparente la ligne de démarcation ; dans le cas où ils ne pourraient se mettre d'accord sur l'emplacement de ces bornes ou sur les rectifications de détail qu'il Mourrait y avoir lieu d'apporter à la frontière actuelle du Tonkin, dans l'intéret commun des deux pays. Ils en référeraient à leurs gouvernements respectifs. »
Pour accomplir cette mission, le gouvernement français envoya, des représentants de trois ministères. Ce furent : pour le ministère des affaires étrangères, M. Bourcier Saint-Chaffray, consul général, président de la délégation française, M. Scherzer, consul de Canton, et le docteur Neis, médecin de la marine, explorateur en Indochine, membres, M. Pallu de la Barrière, membre adjoint ; pour le ministère de la guerre, le lieutenant-colonel Tisseyre, et, pour le ministère de la marine, le capitaine Bouinais. Un commis de chancellerie de Port-Saïd. M. Delenda, fut adjoint au président comme secrétaire. Nous verrons dans la suite que, pendant ces deux années de voyage, le personnel de la commission subit bien des modifications ; disons tout de suite que, dès son arrivée en Indochine M. Pallu de la Barrière quitta la commission et ne pris aucune part à ses travaux.
MM. Scherzer et Tisseyre se trouvant déjà dans l’Extrême-Orient, les autres membres partirent ensemble de Marseille le 20 septembre et arrivèrent le 11 novembre à Hanoi, où ils furent fort aimablement reçus par le général de Gourcy et son état-major. Le colonel Tisseyre se trouvait à Hanoi, et M. Scherzer y étant arrivé quelques jours plus tard, la commission, au complet, n'avait plus qu'à se rendre à la frontière.
Les commissaires chinois avaient fait avertir qu'ils attendaient à Long-Chéou, ville chinoise située sur les confins du Kouang-Si, non loin de Lang-son, l'arrivée dans cette ville de la délégation française pour se mettre en route et nous rejoindre à la frontière.
Malheureusement, Lang-son, évacué par nos troupes depuis la retraite du colonel Herbinger, n'avait pas encore été réoccupé. L'intention du général de Courcy était de pacifier complètement le Delta et de négliger, au moins pour le moment, les frontières et même tout le haut Tonkin. Dans l'administration comme dans l'armée, cette manière de voir semblait erronée à presque tous ceux qui connaissaient bien le Tonkin : la pacification du Delta paraissait impossible si l'on abandonnait aux bandes irrégulières la plus grande partie du pays qui, on le savait, comprenait dans le nord, du côté de Lang-son et de Cao-bang, des contrées riches et fertiles ; Puis, si l'on regardait le Tonkin comme une voie de pénétration pour notre commerce en Chine ; Il fallait bien s'assurer des routes qui y conduisent. Enfin nous devions à la Chine ; qui avait envoyé une commission de délimitation sur nos frontières, l'exécution de l'article du traité de Tien-tsin. Malgré toutes ces raisons, ce ne fut pas sans peine que M. Saint-Chaffray parvint à triompher des hésitations dit général en chef, et ce ne fut qu'au bout de cinq semaines d'attente à Hanoï que la délégation française put se remettre en route pour rejoindre la délégation chinoise.
Pour atteindre Lang-son, point où nous devions pouvoir nous mettre facilement en communication avec nos collègues chinois stationnés à Long-Chéou, le général Warnet, chef d'état-major, choisit la route prise au mois de février précédent par le général de Négrier. Nous devions trouver à Chu, sur le Loch-nam, organisée par l'état-major, la colonne d'escorte qui nous conduirait, sous le commandement du chef de bataillon Servière, et les approvisionnements et les coolies (porteurs indigènes) nécessaire à cette colonne.
Le 10 décembre au matin, on s'embarque enfin sur les deux canonnières le Moulin et le Jacquin, qui doivent nous conduire jusqu'à Lam, le port de Chu.
De nombreux amis sont venus nous conduire ; on ne sait trop si notre petite colonne pourra arriver sans encombre à la frontière, mais nous avons bonne confiance et nous sommes heureux de sortir de l'inaction forcée où nous nous trouvions à Hanoi, après avoir pli craindre d'être obligés de renoncer même à tenter de remplir le mandat qui nous avait été confié par le gouvernement.
La commission s'est adjoint à Hanoï deux officiers topographes, MM. les lieutenants Vernet et Bohin. Elle est accompagnée d'interprètes; de lettrés, de domestiques; elle emmène de petits poneys tonkinois, adroits, vigoureux et peu difficiles à nourrir; trois cents coolies, qui seront chargés des approvisionnements personnels de la commission, sont distribués dans quatre jonques chargées de riz et accolées à chacun des flancs des deux canonnières.
Ces petites canonnières ne voyagent guère après le coucher du soleil, à cause des bancs de sable qui encombrent tous les fleuves du Tonkin, mais surtout parce que le commandant, se trouvant le seul officier du bord, est toujours de quart et qu'il lui serait impossible de continuer jour et nuit, sans repos, un aussi pénible service.
On s'installe à l'étroit sur le poil[ des deux canonnières, ainsi pesamment chargées; le soir on établit les lits de camp les uns près des autres. Les grandes moustiquaires blanches, qui ne nous défendent que fort imparfaitement- de la nuée de moustiques couvrant le fleuve Rouge, donnent au pont du Moulun l'aspect d'un dortoir.
Le lendemain nous mouillons devant Haï-dzuong, et le 12, après avoir passé devant le poste des SeptPagodes et le Song-thuong, nous nous engageons dans le Loch-nam, charmante petite rivière aux rives boisées, souvent encaissée et parsemée de rochers pittoresques qui en rendent la navigation périlleuse. Quelques jours auparavant, la canonnière le Henry-liivière s'est défoncée sur l'un de ces rochers, et nous la voyons échouée sur un banc de sable où elle attendra une crue du fleuve pour être renflouée. Le courant est rapide, et les jonques chargées de riz que nous remorquons menacent à chaque instant de couler à fond, malgré l'allure très modérée à laquelle nous marchons; une légère brise venant compliquer la situation, la jonque, exposée au vent, se remplit à moitié et coule à pie avant qu'on ait pu la mener à la berge; les coolis se sauvent assez facilement, et la perte du riz n'a pas pour notre expédition une importance majeure.
Nous nous arrêtons dans l'après-midi au poste de Lam, où doit se terminer notre navigation. Ce poste et celui de Chu, qui n'en est distant que de sept kilomètres, ont été fort éprouvés par le choléra pendant la dernière campagne; il existe encore quelques cas, et l'agglomération de soldats et de coolis que nous emmenons avec nous peut faire craindre une recrudescence de l'épidémie; aussi nous décidons-nous à passer le plus vite possible dans ces lieux pestiférés.
II
Chu. - Dong-song. - Thanh-moï. - Réoccupation do bang-son.
Le commandant Servière a tout préparé pour une marche immédiate sur Lang-son; il vient nous recevoir à Lam, et, aussitôt nos chevaux et nos bagages débarqués, nous nous rendons au poste de Chu, pour y passer la nuit.
Là se trouve concentrée la colonne; campée autour du poste, elle se compose d'une compagnie du 23e de ligne, de deux compagnies de tirailleurs tonkinois, d'une section d'artillerie et de trente chasseurs d'Afrique, ces derniers formant l'escorte particulière de la commission. La vue du campement de Chu pendant la nuit formait un spectacle des plias pittoresques; les troupes, placées méthodiquement sur les chemins, entourent complètement les douze ou quinze cents coolis qui portent les bagages et les approvisionnements de toute la colonne; ces coolis. à chacun desquels l'administration a fait distribuer un manteau de feuilles de palmier et une couverture de laine rouge, sont groupés autour de leurs feux, faisant cuire le riz, causant et jacassant toute la nuit au lieu de se reposer; ils ont l'air d'accepter de bon gré la forte corvée qui leur est infligée. Il ne faut cependant pas trop s'y fier, et malgré une étroite surveillance on constate, au moment du départ, une trentaine de désertions.
Le village de Chu se trouve à la limite des régions fertiles ; plus loin, vers Dong-song, le pays est désolé; fertiles partie que les Annamites appellent « le pays de la faim et de la mort »: Malgré l'état troublé des environs, les populations commencent à venir approvisionner le marché de Chu de volailles, d’œufs et (le légumes nous y séjournons vingt-quatre heures pour organiser définitivement la colonne. Nous abandonnons une partie de nos provisions, n'emportant que pour un mois de vivres; cela l'orme encore un convoi assez considérable, car il nous faut tout apporter avec nous et prévoir que nous aurons souvent à traiter nos collègues chinois.
Le 14. nous nous mettons en route pour Pho-cam.
On ne rencontre sur la route que quelques cagnas brùlées et des traces de campements; les rizières sont en friche depuis plusieurs années; ce n'est cependant pas une région infertile, elle a été cultivée autrefois. c'est la guerre et la piraterie qui ont désolé cette partie du Tonkin.
Après le petit poste de Pho-cam, que nous quittons le 15 au matin, le pays deviens boisé et fort pittoresque; la route est coupée de nombreux arroyos, et la marche est pénible pour nos coolis: aussi les désertions continuent, et quelques-uns meurent en route du choléra ou plutôt de cette maladie peu décrite qui, dans nos colonnes au Tonkin, a fait tant de victimes parmi nos soldats et surtout parmi les coolis, et à laquelle je ne puis donner d'autre nom que celui de surmenage.
Un, petit poste perdu; appelé Camp tics Tires, surveille la route et assure la communication avec Dongsong, où nous arrivons le soir.
Ce point passe pour l'un des plus malsains du Tonkin, et comment pourrait-il en être autrement? On s'est battu ici il y a peu de mois : les corps nombreux des Chinois tués par les vaillantes troupes du général de Négrier; et surtout ceux des coolis, des chevaux et des mulets qui ont succombé de fatigue pendant cette pénible marche, n'ont été qu'imparfaitement inhumés; ou respire encore à chaque instant des odeurs de cadavres, et il n'est point étonnant que la petite garnison de Dong-song soit des plus éprouvées.
Le 16 nous en partons au point du jour; l'étape est rude, il faut passer le col de Deo-quao par un sentier fort accidenté, pour redescendre ensuite dans la vallée du Song-thuong, que nous retrouvons à Thanh-moï. Ce n'est plus qu'un torrent coulant au pied d'une haute montagne calcaire, véritable muraille infranchissable; courant du sud-ouest au nord-est ; derrière ce massif qui lui sert de rempart, un pirate ayant des bandes nombreuses sous ses ordres, le Caï-Kinh, tient la campagne et s'est rendu maître du pays. La petite garnison de Thanh-moï devra être renforcée pendant les opérations de la délimitation. Le sous-chef d'état-major du général Warnet, le colonel Crétin, qui s'est chargé de. l'organisation si délicate du ravitaillement de la colonne doit y séjourner pendant tout le temps que cous passerons dans ces parages. La section d'artillerie et mie compagnie du 23` commandée par le capitaine Gignous restent aussi à Thanh-moï, à leur grand regret, car chacun voudrait prendre part à la réoccupation de Lang-son. Nous savons bien que les réguliers chinois évacueront devant nous la ville sans aucune difficulté, mais nous ignorons si quelque bande du Caï-Kinh n'essayera pas de résister.
Thanh-moï n'est réoccupé que depuis peu de semaines, et déjà les habitants, rassurés, commencent à se grouper autour de notre fortin, à reconstruire leurs cagnas, à faire sortir des profondeurs des grottes du massif de Dong-naï, où ils les avaient cachés, et à apporter au marché, les porcs, les volailles, le tabac et le paddy. L'immense muraille calcaire au pied de la= quelle coule le Song-thuong est composée d'une roche d'un aspect tout particulier, que l'on retrouve çà et là dans toutes les parties du Tonkin et dont les Mots de la baie d'Along sont le type le plus connu. Tout ce massif est creusé de grottes naturelles, nombreuses et profondes, qui ont servi et servent encore d'abris aux habitants, mais trop souvent de refuges et de citadelle aux pirates.
A partir de Thanh-moï nous entrons dans l'inconnu; nous ne savons ce qui va se passer, et l'on respecte désormais strictement l'ordre de marche. les cavaliers réglant leur pas sur celui de l'infanterie; avec nos petits chevaux tonkinois vifs et impatients, dans ces sentiers de montagne qui s'appellent ici pompeusement « la grande route mandarine de Hué à Pékin », cette marche lente et réglée est aussi fastidieuse que pénible.
D'ailleurs, pas d'incident. La distance jusqu'à Lang-son est trop grande pour être franchie en une étape, puis il ne faut pas y arriver de nuit; aussi le commandant Servière fait-il camper la colonne dans une rizière à peu près sèche, au pied du col de Cut, qui forme la ligne de partage des eaux entre le versant tonkinois et le versant chinois.
Chacun déploie sa tente, car les nuits sont fraîches; le matin le thermomètre marque treize degrés, et nous ne sommes pas habitués à des températures aussi basses. Dès le jour on se met en route, non sans une certaine émotion : c'est la dernière étape avant Lang-son ! Elle est pénible, car le col de Cut n'est pas d'un passage facile; peut-être même sera-t-on attaqué; mais, nous en avons la confiance, ce soir Lang-son sera réoccupé, et chacun marche joyeusement; il n'est pas jusqu'aux coolis qui, se sentant au bout de leurs peines, ne semblent marcher plus allègrement. Le long de la route on retrouve encore les poteaux renversés et les fils coupés du télégraphe que notre corps d'armée avait établi jusqu'à Lang-son. A midi on s'arrête pour la grande halte, on s'installe à l'abri du soleil dans les hautes herbes pour déjeuner, et pendant ce temps le capitaine Gachet, à la tête d'un peloton de chasseurs d'Afrique, pousse jusqu'à Lang-son, qu'il trouve abandonné et dont les rares habitants, restés chez eux; viennent le recevoir.
A quatre heures nous débouchions entre les forts, sur les collines qui dominent la ville du côté du sud-ouest, et nous apercevions le splendide panorama qu'offre de, ce point la plaine de Lang-son. Au premier plan est la ville, formée, comme toutes les villes annamites, d'une enceinte fortifiée ou ville officielle et d'un marché, situé en dehors, où vivent. les commerçants. La ville fortifiée ne se compose plus que de ses grandes murailles, de magasins de riz et de pagodes brûlées et en ruines. Cependant, sur le réduit, charmante petite colline couverte de sapins, une pagode et les nombreux tombeaux qui l'entourent semblent avoir échappé au désastre.
Au delà de la ville serpente le coking, déjà navigable ici pour les petites pirogues, puis, au delà du fleuve, la petite ville chinoise de Kilua, bien bâtie en brique, dominée par les deux forts entre lesquels le général de Négrier victorieux fut si malheureusement atteint d'une balle dans la journée du 28 mars; à droite et à gauche s'étend une riche plaine bien cultivée, parsemée d'immenses blocs calcaires aux formes tourmentées, qui étaient autrefois des îlots; la mer en a rongé la base et beaucoup affectent l'aspect de champignons.
Les villages sont nombreux et fort populeux tout le long du coking; l'absence presque complète d'aréquiers, de cocotiers et de bananiers leur donne un caractère absolument différent de ceux du Delta.
A cinq heures nous saluons le pavillon français hissé sur la porte nord de la ville, et nous nous installons dans une des maisons du marché. Nous visitons aussitôt la citadelle ruinée, et les officiers nous mènent près du lieu où fut inhume le jeune lieutenant Bossant, officier d'ordonnance du général Brière de l'Isle, qui tomba frappé mortellement d'une balle, à côté de son général; lors de la prise de Lang-son; ses camarades s'apprêtent à lui élever un mausolée, que nous pûmes voir à notre retour dans cette ville et dont nous donnons plus loin le dessin d'après une de nos photographies.
Ce soir-là même, un officier chinois vint nous trouver pour nous dire que les commissaires chinois se trouvaient à Long-chéou et qu'ils allaient se mettre en route pour la Porte. de Chine. Dès le lendemain le commandant Servière passait le Song-kikong avec une faible reconnaissance, et les réguliers chinois, peu nombreux. qui se trouvaient au marché dé Kilua, se retiraient pacifiquement devant nos troupes.
III
Kilua. - Dong-dang. - Les commissaires chinois.
Le 20, accompagné de M. Scherzer, le consul de Canton, qui parlait le chinois, le commandant Servière se rend avec un petit détachement, à Dong-dang, à quinze kilomètres de Lang-son, où un corps de réguliers chinois. sous les ordres du général Tsou, s'était installé et avait préparé les logements des commissaires chinois et de leur escorte.
On parlemente avec eux; le commandant Servière et M. Scherzer poussent même ,jusqu'à la Porte de Chine, située à trois kilomètres de Dong-dang et qui forme ici la frontière du Tonkin et de la Chine.
Ils reviennent le soir à Lang-son, accompagnés d'un tin-chaï, porteur d'une lettre officielle pour le président de la délégation française, après avoir laissé à Dong-dang un détachement de tirailleurs tonkinois.
La lettre était de Teng-tcheng-siéou, président de la délégation chinoise, qui souhaitait la bienvenue, aux commissaires français et les avertissait qu'il allait se mettre en route de Long-chéou pour aller à la Porte de Chine. Dès qu'ils apprirent ces nouvelles, M. Saint-Chaffray et ses collègues furent unanimement d'avis qu'il fallait se rendre le plus tôt possible à Dong-dang et s'y établir. Nous devions regarder Dong-dang comme faisant partie du Tonkin, et, si les commissaires chinois désiraient venir habiter cette ville, nous voulions les recevoir comme nos hôtes, mettre en cette qualité les meilleurs logements à leur disposition, mais leur bien montrer qu'ils étaient chez nous.
Le 21 au matin, on se remettait donc en route avec les trente chasseurs d'Afrique pour toute escorte, et nous suivions, au fond d'une riche vallée, le sentier qui continue la route mandarine au delà de Lang-son.
Le pont de Lang-son a été coupé lors de la retraite du colonel Herbinger; nous passons le coking par un gué assez dangereux, et quelques minutes après nous sommes au marché de Kilua, habité presque exclusivement par des Chinois.
Cette petite ville ne paraît pas avoir beaucoup souffert de la guerre ; les habitants nous regardent avec plus d'étonnement que de malveillance; le marché est assez bien approvisionné, et ce n'est que du côté des forts que l'on aperçoit les ruines de quelques maisons brûlées. Après Kilua on traverse (le grandes rizières; on aperçoit de chaque côté, mais le plus souvent à une certaine distance de la route, des villages bien peuplés; les habitants se sont remis au travail, et les buffles sont dans les rizières.
La présence des réguliers chinois, qui nous ont cédé la place, a suffi pour assurer à ces pauvres gens une sécurité relative en éloignant les pirates; notre arrivée et le changement de maître ne paraissent pas les inquiéter outre mesure. En approchant de Dong-dang, les bords de la route deviennent moins cultivés, et le pays semble moins peuplé; il n'en est rien cependant, et, derrière les collines arides qui bordent la route, nous trouverons, dans nos promenades, des vallées fertiles, des villages peuplés et des bois de badiane qui font la richesse de cette contrée. Sur la plupart des collines qui dominent le chemin on voit des traces de fortins chinois, et ces fortins se multiplient en approchant de Dong-dang; ils ne se composent d'ailleurs le plus souvent que d'une tranchée et d'un rempart de terre couronnant les sommets.
Dong-dang, situé à l'embranchement de la route qui va au nord à That-ké et à Cao-bang et de la route de Lang-son à la porte de Chine, était un marché d'une certaine importance. Nous trouvons la ville, habitée naguère par des Chinois qui s'adonnaient au commerce de riz avec la Chine et aussi à la fabrication de l'huile de badiane, à peu près déserte; des trois ou quatre rues dont elle se composait, une seule et une partie de la grande place sont encore debout ; le reste a été brûlé et détruit pendant les combats qui s'y sont livrés au commencement de l'année. Bâtie en brique au pied de massifs calcaires semblables au mont Dong -naï dont nous avons parlé, sur les bords d'un cours d'eau limpide, elle se présente, en venant de Lang-son, sous un aspect fort pittoresque, entre ses trois grandes pagodes assez bien conservées, mais crénelées et ayant servi de blockhaus; elle est dominée par une petite pagode paraissant sortir d'une grotte creusée dans un rocher élevé, ombragé de grands arbres. Les environs, très accidentés, nous promettent de charmantes promenades pendant les loisirs que nous laisseront les opérations de délimitation.
Ces loisirs ne furent que trop nombreux, grâce aux tergiversations. aux lenteurs et aux contestations peu soutenables de nos collègues chinois. La procédure à suivre, le lieu de réunion, les escortes qui doivent accompagner chaque délégation, voilà les questions graves et importantes qui font d'abord perdre ;plus de quinze jours. Enfin on tombe d'accord que les séances auront lieu alternativement, chez les commissaires chinois, à la Porte de Chine (appelée en annamite Cua-aï et en chinois Che-nam-quan), et, chez nous, dans la pagode de la grande place, à Dong-long. Les deux délégations seront escortées par les soldats de leur pays, sans armes, quand elles se rendront l'une chez l'autre. Après de nombreuses visites et lettres préliminaires; après les cadeaux et les visites du nouvel an, on parvient, non sans peine, à se réunir en séance officielle pour la première fois le 12 janvier 1886, à Dong-dang.
Alors commencent à se produire les prétentions les plus exagérées de la part de la délégation chinoise; mais les commissaires ne les exposent que peu à peu; la moitié de chaque conférence se passe en compliments oiseux, et il est impossible d'obtenir que l'on ait plus de deux ou trois conférences par semaine. Ce qu'il fallut de patience, d'habileté et aussi de fermeté à notre président, qui, le plus souvent, se sachant toujours d'accord avec ses collègues; prenait seul la parole dans ces conférences, on pourra se le figurer quand nous aurons dit qu'après avoir rompu deux fois les négociations, ce ne fut que le 20 mars que purent commencer les opérations effectives de reconnaissance de la frontière.
Heureusement nous n'avons pas à raconter ici l'histoire détaillée de ces chinoiseries peu récréatives; disons seulement qu'en dehors des discussions d'affaires parfois irritantes, les rapports de la plus parfaite urbanité et même de la plus grande cordialité ne cessèrent de régner entre les deux délégations.
On s'invita plusieurs fois réciproquement à dîner. La délégation française fit de son mieux pour rendre à la délégation chinoise les repas, somptueux et détestables où les nids de salangane, les ailerons de requin, les holothuries et autres mets chinois aussi recherchés qu'immangeables nous étaient servis à profusion, arrosés de vin de riz chaud, de ce thé astringent et sans parfum qui fait les délices des grands mandarins, mais aussi de bon champagne de première marque, que nos collègues ne détestaient point.
Sur l'avis du consul de Canton, le seul d'entre nous habitué aux usages des mandarins chinois, toutes les conférences officielles, chez nous comme chez nos collègues, se tenaient autour d'une table servie de gâteaux, de fruits confits et de confitures, en buvant du thé et du champagne, et en fumant des cigares.
Parfois, après une chaude discussion dans laquelle on voyait qu'il serait impossible de s'entendre, Teng le président de la délégation chinoise, changeant de figure et prenant un air, souriant, demandait qu'en remit à quelques minutes les affaires sérieuses, et l'on .causait par interprète de choses et d'autres jusqu'à ce que l'un des deux présidents eût proposé de recommencer à parler d'affaires; la discussion reprenait alors au point où on l'avait laissée. Notons encore cependant le procédé de discussion suivant, employé sans cesse pour nous faire perdre du temps. Une question quelconque étant agitée et le président Teng se voyant à bout d'arguments, le second mandarin Wang-tché-chouen , taotaï des riz de la province de Canton, la j reprenait presque dans les mêmes termes et avec une telle apparence de bonne foi qu'il fallait recommencer à discuter avec lui: puis c'était le tour de Li-bing-jouei, le troisième commissaire, ancien directeur de l'arsenal de Shang-haï, qui, avec les circonlocutions les plus aimables, et les discours s les plus embrouillés, développait les mêmes arguments comme s'il n'en avait pas été question avant lui. Nous ne parlerons pas de Li-ping-heng, le gouverneur du Kouang-si, vieux mandarin mandchou, qui ne prit jamais part à la discussion que par, des gestes et des ricanements inconvenants et que M. Saint-Chaffray dut en plusieurs circonstances faire rappeler à l'ordre par le président Teng .
Nous manquions d'interprètes, car M. Scherzer, comme M. Haïtce, qui lui succéda à la commission, bien que connaissant le chinois, ne pouvaient, en leur qualité de membres de la commission, s'astreindre à ce rôle pénible et subalterne, leur fonction devant être surtout de contrôler l'interprétation; nos collègues chinois étaient beaucoup mieux partagés que nous. Outre M. James Hart, frère de sir Robert Hart, attaché à -la délégation chinoise comme conseiller et qui voulut bien souvent, surtout dans les conversations particulières, nous servir de truchement, un ingénieur de la marine chinoise, Li, qui avait été longtemps attaché à
l'arsenal de Fou-tchéou, avec le commandant Gicquel, et qui était venu se faire diplômé en France, fit presque à lui seul toute l'interprétation.
Après plus de deux mois et demi d'interminables discussions, après avoir par deux fois rompu les conférences et demandé des instructions à nos gouvernements respectifs, on parvint à s'entendre sur les bases suivantes : on commencerait par reconnaître l'ancienne frontière, la seule qui existât pour nous, puis on s'entendrait sur les rectifications de détail qui pourraient y être faites, et l'on ne poserait de bornes qu'après l'achèvement de ces deux opérations.
Le président Teng refusant absolument de se rendre sur les lieux, il fut décidé que les deux présidents ne se déplaceraient pas et que les autres commissaires, voyageant de conserve, parcourraient la frontière en commençant par les environs de la Porte de Chine.
IV
Occupation de That-ké. - Les pirates. - Mort de M. Scherzer.
Pendant ces discussions le commandant Servière ne restait pas inatif Aussitôt après avoir organisé le poste de Dong-dang et assuré sa défense. il se porta vers le nord, occupa sans coup férir That-ké, poste assez important, à trois journées de marche au nord de Dong-dang, servant d'appui et de lieu de ravitaillement au pirate Caï-Kinh, et y laissa une compagnie de tirailleurs tonkinois. Pendant ce temps, le colonel Crétin, qui avait transporté son quartier général de Thanh-moï à Lang-son, organisait fortement notre ligne d'étapes, et la commission pouvait procéder avec une sécurité relative. On en profita pour envoyer immédiatement nos officiers topographes, MM. Vernet et Bohin, avec de faibles escortes de linh-tap, procéder au lever de la frontière, et cette mission était loin d'être sans dangers. Quand il leur arriva par mégarde, ce qui était inévitable, de passer, dans le cours de leurs levés topographiques, sur le côté chinois de la frontière, ils furent toujours, il est vrai, avertis d'une façon convenable par les autorités chinoises et s'empressèrent d'obtempérer à leurs avis. Mais, même après l'occupation de That-ké, des bandes de pirates disséminées ne cessaient d'infester la contrée. La ligne de retraite des bandes dispersées du Cài-Kinh, qui se retiraient en Chine, emmenant avec elles le butin et surtout les femmes volées dans le Delta, passait entre Dong-dang et That-ké. Toute cette région accidentée du nord est sillonnée de sentiers qui donnent accès à des passes nombreuses conduisant du Tonkin en Chine. Au commencement du mois de janvier, MM. Bohin et Vernet, étant partis avec dix tirailleurs tonkinois pour lever la frontière entre Dong-dang et Ban-tao, situé à dix kilomètres seulement, aperçurent, en arrivant près de ce village, un certain nombre de pirates qui s'enfuirent à leur approche. Au même moment ils virent accourir à eux huit femmes annamites avec leurs enfants, qui vinrent se jeter à leurs pieds. Elles racontèrent qu'elles avaient été volées dans le Delta et qu'en ce moment une troupe, forte de plus de trois cents hommes, les conduisait en Chine à marche forcée; les pirates, qui avaient pris la petite escouade de nos officiers topographes pour l'avant-garde d'une troupe plus nombreuse, s'étaient enfuis, et l'une d'elles, femme d'un tirailleur annamite de la province de Bacninh, ayant reconnu l'uniforme des linh-tap, elles venaient leur demander protection. On ramena à Dong-dang ces malheureuses, épuisées par les fatigues et les privations, on les soigna quelque temps, et, après qu'elles eurent donné à l'autorité militaire de précieux renseignements sur les bandes de pirates, elles purent retourner dans leurs familles.
Les promenades, même à peu de kilomètres de Dong-dang, n'étaient donc pas sans dangers dans les premiers temps, et, quand la petite pluie fine et serrée qui tombait presque continuellement nous laissait quelque répit, nous ne pouvions explorer les environs qu'à cheval, en armes; précédés et suivis de deux chasseurs d'Afrique, fort mauvais moyen pour étudier les habitants et les ressources d'un pays, et nous rendre compte des mœurs, de la civilisation, de la langue, etc., de cette population thé si peu connue, qui peuple toute la région de Dong-dang.
Nous pûmes cependant, même dès les premiers jours, parcourir la route déjà connue de Lang-son et celle beaucoup plus intéressante de That-ké. De ce côté la sentier suit à droite, presque continuellement, la frontière formée par une chaîne calcaire parfois taillée à pic comme une immense muraille, parfois formée d'une série de pitons reliés entre eux par de petits vallons très abrupts. De nombreuses grottes sont creusées par la nature dans les parois des rochers; quelques-unes sont habitées par les Thôs, qui y trouvent un refuge contre les pirates; ce sont souvent les plus inaccessibles, et l'on ne peut y arriver qu'au moyen d'une longue et mince échelle de bambou que les habitants retirent chaque soir en cas de danger; d'autres ont été converties en pagodes et contiennent un grand nombre d'idoles bouddhiques d'un travail assez grossier. A gauche de la route se succèdent des mamelons arrondis, couverts de hautes herbes et séparés par des vallées cultivées en rizières qui s'étendent jusqu'au pied des rochers calcaires.
Un jour que le capitaine Bouinais et moi nous nous étions aventurés plus loin que d'ordinaire sur la route de That-ké, précédés et suivis, comme c'était l'ordre, de deux chasseurs d'Afrique à cheval, nous fûmes avertis par les deux chasseurs qui étaient en avant qu'ils apercevaient au détour des sentiers, à moins de cent mètres. une troupe de pirates.
Nous vîmes en effet une petite troupe en armes, dont le chef poussa un cri modulé qui nous parut être un signal ou un appel, et nous distinguâmes parfaitement des fusils et des lances. Aussitôt rejoints par les deux chasseurs qui venaient derrière, nous piquons des deux et nous nous trouvons, avant qu'ils aient pu songer à prendre la fuite, maîtres de six indigènes qui se rendent sans difficulté. Mais les armes ont disparu : plus de fusils, plus de lances; j'interroge celui qui paraît être le chef ; il me répond qu'il n'a jamais eu de fusils ni d'armes d'aucune sorte et qu'il n'est pas un pirate; j'ai beau insister et menacer, me servant de toute ma connaissance, d'ailleurs assez restreinte, de la langue annamite, lui représenter qu'il est inutile de nier, puisque nous avons aperçu ses armes : il continue à protester énergiquement de son innocence. Pendant ce débat, le capitaine Bouinais avait fait mettre pied à terre à deux chasseurs d'Afrique, et, en fouillant les hautes herbes qui bordaient le sentier, ils ne tardèrent pas à trouver trois fusils à mèche ayant encore leurs mèches allumées, un pistolet d'arçon tout amorcé, quelques sabres et des lances. Ne pouvant s'enfuir, ils avaient essayé de dissimuler leurs armes. Aussi, bien persuadés que nous avions arrêté de dangereux pirates, nous leur enjoignîmes de marcher entre nous, et nous revînmes au pas à Dong-long, ramenant les prisonniers, et tout fiers de notre capture.
Ils se laissèrent d'ailleurs conduire avec la plus grande docilité et sans protestations; puis, une fois arrivés et remis entre les mains de l'autorité militaire, leur chef exhiba un papier écrit en français, qu'il s'était bien gardé de nous montrer, et qui n'était autre chose qu'une commission de bang-bien ou chef de la police, signée du commandant Servière. Le commandant reconnut d'ailleurs son homme, qui, interrogé sur la conduite étrange qu'il avait tenue à notre égard, répondit qu'il faisait une ronde, ayant toujours ses armes prêtes à tirer pendant qu'il était en route, et que la vue de six cavaliers fondant sur sa petite troupe l'avait terrifié, il avait alors fait cacher les armes. Une fois celles ci découvertes, comme il savait qu'on ne lui ferait aucun mal avant de le juger, il avait mieux aimé venir s'expliquer à Dong-dang, près du commandant, que de nous montrer son brevet de bang-bien.
Nous avions donc arrêté la. police en croyant arrêter des pirates; nous étions, je l'avoue, légèrement confus et désappointés. Cependant, en pensant à l'effarement de ces gens à notre aspect, au cri d'appel du chef, à leur conduite si extraordinaire à notre égard, nous restâmes toujours dans le doute, et nous ne pouvons nous persuader que leurs intentions fussent aussi pures qu'ils le prétendaient. On peut bien facilement, en ces moments troublés, jouer un double jeu, et les rôles de pirates et de gendarmes ne sont pas incompatibles.
Au bout de quelques semaines le temps devint plus froid, et plus sec; la température, le matin, variait entra six et douze degrés; le pays devint plus sûr. et surtout notre confiance dans les habitants plus grande, et nous pûmes entreprendre quelques promenades intéressantes; ce fut vers cette époque que nous eûmes le malheur de perdre l'un d'entre nous.
M. Scherzer souffrait depuis plus de dix-huit mois d'une dysenterie chronique, contractée au cours de la dure campagne qu'il avait faite pendant la dernière guerre, sur les bateaux de l'escadre de l'amiral Courbet. Mal remis par un court séjour en France, il n'avait pas tardé à subir une rechute peu après son arrivée à Canton. Quand il nous rejoignit à Hanoï, il paraissait encore vigoureux, son appétit n'était que trop bon et il avait toutes les apparences de la santé ; il n'en était pas moins profondément atteint, et il le sentait bien lui-même; mais j'eus beau insister pour le faire renoncer au dessein de nous suivre, il ne voulut rien entendre. La mission que nous avions à accomplir était intéressante, pénible., elle pouvait offrir des dangers : à aucun prix il ne voulait s'y soustraire; il sentait aussi qu'étant le seul d'entre nous qui connût la langue chinoise, son absence eût mis la délégation française dans le plus grand embarras. Il supporta assez bien le voyage, mais pendant le séjour de Dong-dang son état s'aggrava rapidement; l'habitation dans ces logements chinois ouverts de tous côtés, au rez-de-chaussée sur la terre nue, par un temps froid et brumeux, ne laissait pas de prise au traitement, que l'absence de lait frais rendait illusoire.
La maladie progressait, et il abusait de ses forces, montait à cheval, et assista aux séances Jusqu'au dernier moment, toujours gai et content et ne voulant pas entendre parler, du retour en France avant l'achèvement de nos travaux. Au commencement de février arriva de France un membre adjoint à la délégation, M. Haïtce, ancien élève de l'École des langues orientales, connaissant la langue chinoise, et sa présence pouvait permettre à M. Scherzer de nous quitter; il ne consentit à le faire qu'à la dernière extrémité, vers la fin de février; il reçut en route la croix de la Légion d'honneur, mais ne put arriver jusqu'en France et succomba pendant la traversée de la mer Rouge.
V
Le marché de Dong dans. - Les Thôs. - Fabrication de l'huile de badiane.
Les habitants de Dong-dang ne tardèrent pas à prendre confiance dans toute la région, et le colonel Crétin put bientôt trouver à Lang-son des quantités de riz suffisantes non seulement pour nourrir les troupes indigènes, mais encore pour en envoyer aux postes de Thanh-moï et de Dong-son. Chaque jour le marché de Lang-son se trouvait approvisionné de volailles, de poisson du Song-kikong et de légumes, et le jeudi les porcs; les bœufs le tabac, l'opium et l'eau-de-vie de riz abondaient sur le marché. L'intendance put même se procurer une trentaine de poneys du pays au prix de quinze à vingt piastres (soixante à quatre-vingts francs). Malgré tout, le marché de la ville chinoise de Kilua resta toujours plus fréquenté que celui de Lang-son.
A Dong-dang il fut difficile d'empêcher tous les villages environnants de se rendre, comme c'était leur habitude, à la Porte de Chine, où les cinq à six mille réguliers campés dans les forts, les commissaires chinois, leur escorte et leurs nombreux domestiques représentaient une masse respectable de clients et de consommateurs; les habitants s'habituèrent cependant. assez vite à se réunir à Dong-dang au moins tous les samedis, et le marché devint alors considérable.
Dès la pointe du jour on voyait arriver les populations par tous les chemins; portant de lourds paniers. Dans la rue s'échelonnaient les marchands d'oies, de chapons et de poulets, les marchands d'huile de ricin, d'arachides et d'eau de vie de riz, accroupis derrière leurs grandes jarres, puis les marchands de légumes, patates douces, igname, taro, courges, macres; etc. La place était couverte d'un quadruple rang du boutiques.
Les marchands d'opium étalaient sur de petites tables leur précieuse marchandise, opium du Yunnan et du si, d'assez médiocre qualité cependant, qu'ils vendent ordinairement, en détail, au poids de l'argent. Plus loin, les nombreux marchands de quincaillerie et de bimbeloterie chinoises exposaient à terre les petits miroirs, couteaux, pipes à opium, etc., et des cotonnades d'origine anglaise. Près de la pagode, un peu plus loin, ficelés dans des paniers de bambou et poussant des cris lamentables, on voyait des porcs de toutes les tailles et de jeunes chiens destinés, eux aussi. à être mangés.
Les boutiques les plus entourées et les plus nombreuses étaient celles de vieilles femmes rangées à la file. derrière des monceaux de tabac haché très finement et de feuilles de la même plante. Devant chacune d'elles brûle une petite lampe, formée d'un godet contenant de l'huile de ricin et dans lequel trempe une mèche en moelle de jonc. Près de la lampe se trouve une pipe formée par un bambou de la grosseur du poignet, à la partie inférieure duquel est adapté un second bambou de la grosseur d'une plume d'oie. La partie inférieure du gros bambou est remplie d'eau : c'est la pipe à eau de tous les Thôs; que l'on retrouve aussi en bien d'autres endroits en Indochine. Les acheteurs se pressent autour des marchandes et vont de l'une à l'autre, fumant une pipe à chaque boutique pour choisir leur tabac en connaissance de cause.
Près de là sont les marchands de bétel et de chaux. N'ayant que fort peu de noix d'arec séchées ale troisième ingrédient constitutif de la chique de bétel), ils les remplacent par des feuilles de tabac, des écorces astringentes et du cachou.
La garnison de Dong-dang. composée d'une section du 23e de ligne, d'une compagnie de tirailleurs annamites et d'un peloton de chasseurs d'Afrique, circulait librement dans le marché sans qu'il se produise jamais aucun trouble. Parfois quelques réguliers en uniforme venant de la Porte de Chine tentaient de s'introduire dans le marché et on les éconduisait poliment, sans protestation de leur part.
Le télégraphe avait été rétabli de Lang-son à Dong-dang; les routes, améliorées, rendaient la surveillance plus facile; aussi, la sécurité régnant dans le pays, il nous fut possible de nous passer d'escorte dans nos promenades et par conséquent de visiter de près les villages des Thôs. Ce sont des gens vigoureux, de taille moyenne, tenant de l'Annamite et du Chinois du Sud. Ils ont les pommettes moins saillantes, le nez moins aplati que les Annamites, dont ils ont les cheveux longs et les vêtements; les femmes ne portent pas le kékan (pantalon annamite), mais un jupon court en cotonnade grossière, comme les femmes laotiennes. Leur langue diffère totalement de l'annamite. Nous avons trouvé beaucoup de mots siamois ou laotiens et des plus usuels; tels que kinkao, signifiant « manger le riz » et en général « manger ». Cette langue possède aussi, nous dit-on, beaucoup de mots cantonnais. Comme chez toutes les peuplades qui vivent séparées et dont les voies de communication sont difficiles, les dialectes sont nombreux. Les notables connaissent presque tous le cantonnais et parfois l'annamite. C'est un peuple essentiellement agriculteur; je ne lui connais d'autre industrie que l'art, spécial à certaines familles, de fondre l'argent et d'en faire des boucles d'oreilles et surtout des bracelets d'une forme assez originale. On trouve aussi dans les fermes des vans pour le riz, de forme perfectionnée, qu'ils fabriquent eux-mêmes, excepté la partie métallique, qu'ils font venir de Chine ainsi que leurs instruments aratoires.
On peut distinguer autour de Dong-dang deux régions bien dissemblables.
L'une, située entre les routes de la Porte de Chine et celle de That-ké, qui paraît montagneuse, inculte, composée par les massifs calcaires dont nous avons parlé, aux formes tourmentées, tantôt montrant à nu le marbre gris et blanc, tantôt couverts de hautes herbes, et souvent aussi, entre les rochers, de belles plantes ornementales.
Si l'on gravit l'un des nombreux sentiers abrupts qui traversent la première chaîne, on arrive, après une ascension de deux ou trois cents mètres par des défilés étroits, parfois fermés par des portes de bambous ou défendus par des palissades de pierres sèches, dans de véritables cirques entourés de tous côtés par des collines à pic, et au milieu desquels s'élèvent un certain nombre de rochers isolés, de même formation que les collines.
Ces cirques, analogues à ceux formés par les îlots de la baie d'Along, sont assez irréguliers ; le sol est fertile et bien cultivé en rizières; on y rencontre quelques buffles, et dans les angles on aperçoit des villages thôs, composés chacun de trois ou quatre cabanes, situés à proximité des cours d'eau, parfois cachés dans une anfractuosité de rochers, parfois même utilisant, comme magasins à riz, les grottes profondes dont sont percées les montagnes. Les cabanes, bâties sur des pieux, à un mètre au-dessus du sol, ressemblent absolument à celles des Muongs et des Laotiens; elles paraissent encore plus sales et moins confortables; on y constate la même absence de tout mobilier, mais il ne faut pas oublier que ces malheureuses populations des frontières sont sans cesse exposées, depuis de longues années, aux invasions continuelles des pirates.
Plusieurs cirques communiquent entre eux par des défilés très étroits; ils se ressemblent absolument, et il faut s'orienter avec soin pour ne pas se perdre dans ces dédales, car les villages sont encore assez éloignés les uns des autres et en grande partie abandonnés; les rochers isolés présentent la même forme en champignon que dans la plaine de Lang-son, et l'on constate à leur base l'action évidente de la mer, qui autrefois les battait de ses flots. Outre le riz, on ne rencontre guère dans cette région que quelques champs de taro dans les parties les plus inondées et quelques plantes potagères dans un petit enclos près des maisons. Le gibier est rare : pas de cervidés et peu de. félins; on ne rencontre que quelques perdrix dans les hautes herbes, des bécassines dans les lieux humides, et quelques rares poules d'eau le long des ruisseaux.
Le reste du pays diffère totalement de la région que nous venons de décrire. Il est couvert de collines mamelonnées formées de schistes et d'argile ferrugineuse, et l'on aperçoit rarement le rocher à nu sur leurs flancs arrondis couverts de hautes graminées; du moins le long des routes fréquentées. Sitôt que l'on s'enfonce dans le pays en s'éloignant des principales routes, on arrive, en suivant des sentiers à peine tracés, à des villages plus populeux et plus riches que dans la région précédente; les vallées sont cultivées en rizières, et les collines sont couvertes de bois régulièrement plantés d'arbres que, sans être botaniste, on reconnaît immédiatement à la forte et suave odeur d'anis qu'ils répandent.
L'illicium anisetum ou anis étoilé est une charmante magnoliacée qui pousse, dit-on, spontanément dans certaines forêts vierges de cette contrée; mais on la trouve surtout cultivée par les Thôs sur la pente des collines. C'est un arbre de dix à quinze mètres, à feuillage toujours vert, ressemblant à un grand myrte de forme pyramidale assez régulière, avec des rameaux dressés droits, feuillus seulement aux extrémités.
La culture de cet arbre fait la richesse du pays à cause de l'huile ou plutôt essence de badiane très estimée que l'on extrait de ses fruits. Toute la plante, l'écorce comme les feuilles, exhale une forte odeur d'anis; les fleurs, très odorantes, paraissent en janvier en petits bouquets blancs à l'extrémité des rameaux; les fruits se forment et grossissent très vite, puis mûrissent fort lentement, accumulant l'essence de badiane dans l'écorce ligneuse qui entoure la graine. En juin ou juillet, le fruit est mûr; mais, depuis quelques années, probablement à cause dé l'insécurité du pays, qui porte le cultivateur à réaliser le plus vite possible le montant de ses produits, la récolte se fait plus tôt, alors que le fruit est encore vert. Cette coutume, aussi nuisible au producteur qu'à l'acheteur , prendra fin aussitôt qu'une maison française sérieuse voudra s'occuper de la fabrication de cette essence et pourra acheter les récoltes sur pied.
Les Thôs en effet cultivent la badiane, mais vendent toujours les fruits aux Chinois, qui, seuls, ont le monopole de la fabrication de. l'essence.
Un botaniste distingué, M. Balansa, qui séjourna en même que nous du 30 janvier au 25 février à Dong-dang et avec lequel j'eus le plaisir de faire de nombreuses excursions, donne à ce sujet les renseignements suivants
« On voit les Chinois s'établir en été dans tous les villages où l'on cultive la badiane. Presque tous sont originaires du Kouang-si, ils n'arrivent dans la province de Lang-son que pour l'époque de cette fabrication, apportant avec eux leur appareil ou plutôt un chaudron, les autres parties de leur alambic pouvant se trouver sur les lieux. L'essence fabriquée, ils la font parvenir à Canton par la voie de That-ké. Leurs appareils à distiller sont très simples, mais défectueux. ils ne pourront lutter contre ceux, bien plus rationnels, que les Européens pourraient installer dans le pays. »
Au milieu de la plupart des villages thôs on remarque une mare vaseuse profonde où l'on jette toutes les immondices, ce qui doit forcément contribuer à l'insalubrité de ces habitations; les Thôs sont, en effet, très sujets à la fièvre palustre; cette mare sert à l'élevage de nombreux canards et d'une sorte d'oie grise, élégante, à bec noir pointu surmonté de deux tubercules, ressemblant plutôt à un cygne qu'à une oie; mais c'est surtout un vivier presque inépuisable, où pullulent les carpes; qui atteignent des tailles énormes, les anguilles à la peau claire et bigarrée comme celle de certains serpents, et un gros poisson à longs barbillons, à ventre plat, à la chair molle et fade, que l'on retrouve dans les rizières inondées et dans toutes les mares vaseuses de l'Indochine. où il est fort apprécié de tous les mangeurs de riz.
On conçoit qu'à part les promenades dans les alentours et les discussions avec les collègues chinois la vie, à Dong-dang fut assez monotone. Les maisons abandonnées et habitables à l'intérieur de la ville étaient peu nombreuses, et le capitaine Bouinais et moi nous dûmes nous contenter, à noies deux, d'un étroit rez-de-chaussée ne recevant de jour que sur le devant par la porte et par une étroite fenêtre fermée au moyen de planchettes mobiles. Nos deux lits de camp, établis sur la terre nue occupaient la plus grande partie de la pièce, et une petite table raboteuse située près de la fenêtre servait de bureau de travail.
Quand les habitants, la plupart de race chinoise. qui s'étaient réfugiés en Chine à notre approche, revinrent réclamer leurs maisons. on leur dit de produire les preuves de leur propriété et on les indemnisa mensuellement pendant le temps que les logements furent. occupés.
Nous avions quitté Hanoï par des chaleurs de vingt huit et trente degrés. et peu de jours après. dès 1e mois de janvier. le thermomètre marquait six à huit degrés le matin à Dong-dang ; pendant que tombait une petite pluie fine et serrée ; nous commencions à souffrir du froid et plusieurs d'entre nous furent pris de la fièvre. Nous finies bâtir à l'intérieur de nos cases, avec les briques des maisons brûlées, de vastes cheminées. qui les assainirent et les chauffèrent à la fois.
Les miliciens annamites venus du Delta étaient, eux aussi, peu habitués à cette température; étant fort légèrement vêtus. n'ayant pour tout couchage qu'une mince couverture; ils furent bientôt atteints en grand nombre de fièvre et de bronchite et en l'absence de tout autre médecin militaire j'offris au commandant Servière d'installer le service médical et de m'en charger tant que mes occupations de membre de la commission m'en laisseraient le loisir. D'autres malades fort intéressants étaient les malheureux coolis qui passaient par Dong-dang, allant de Lang-son à That-ké pour approvisionner cette garnison. Je les soignais de mon mieux, dans des hangars ouverts de tous côtés où l'on fit construire des claies de bambous qui leur servirent de lit: mais j'en perdis quand même par suite d'accès pernicieux à forme algide. Nous ne croyons cependant pas qu'en temps ordinaire cette région soit malsaine; les chaleurs d'Afrique, bien vêtus et bien nourris, ne donnèrent que peu de malades. Dans tous ces pays de rizières la suspension des cultures pendant un an ou deux suffit pour engendrer la malaria: telle région qui, bien cultivée et peuplée; sera saine et pourra sans danger être habitée même par les Européens, deviendra un foyer pestilentiel, infesté de fièvres pernicieuses si les rizières restent en friche pendant quelques années. Les conditions défavorables dans lesquelles se trouvent les troupes en campagne, dans des contrées aussi éloignées des approvisionnements font aussi qu'on ne peut juger de la salubrité du pays par leur état sanitaire dans un état normal. Les troupes qui formaient les escortes de nos collègues chinois à la Porte de Chine et les réguliers chinois campés dans les forts environnants furent beaucoup plus éprouvés par la fièvre que nos soldats européens et annamites.
P. NEIS.
(La suite à la prochaine livraison.)
SUR LES FRONTIÈRES DU TONKIN,
PAR LE DOCTEUR P. NEIS.
TEXTE ET DESSINS INÉDITS
VI
Commencement de la délimitation du terrain., Aspect du pays
Après s'être enfin mis d'accord sur la manière de procéder, avoir réglé le chiffre et la marche des escortes, on convint, avant de partir, d'avoir à la Porte de Chine une séance officielle à laquelle assisteraient les deux présidents, pour déterminer en ce lieu le point qui devait servir de frontière.
Au moment de quitter Dong-dang pour nous rendre à la conférence, nous apercevons sur la route de Chine, sur les hauteurs qui dominent Dong-dang et jusque sur la route de That-ké, sur des territoires que nous regardions à juste titre comme annamites, les réguliers chinois se déployer de tous côtés, portant de nombreux pavillons, qu'ils plantent dans toutes les directions. L'autorité militaire s'émut de cette manifestation et l'on envoya un officier parlementer avec le commandant chinois; les réguliers, devant ces représentations, arrêtèrent le mouvement en avant, mais ne se retirèrent pas des points occupés.
Nous nous rendons quand même à la Porte de Chine, passant avec notre escorte au milieu des réguliers chinois et des nombreux pavillons plantés sur la route de Chine. Aussitôt arrivé, M. Saint-Chaffray proteste, devant les collègues chinois contre cette invasion de notre territoire, et déclare que nous ne pouvons entrer en séance qu'après le rappel des réguliers dans les frontières chinoises. Les commissaires chinois prétendent d'abord ne rien comprendre à nos réclamations; puis, après avoir pris des renseignements, il, nous disent que tout s'est fait à leur insu et que l'autorité militaire chinoise ne les a avertis de rien. Li prétend même que tout cet appareil provenait d'un excès de zèle des mandarins militaires, qui voulaient nous rendre des honneurs. Finalement, ils donnent des ordres pour la rentrée des réguliers dans leur campement; l'incident est: déclaré clos, et l'on se met immédiatement à discuter d'affaires.
La Porte de Chine est située au fond d'une gorge peu profonde, les collines escarpées qui la surplombent n'ont guère que cinquante à soixante mètres de hauteur. Depuis la paix les Chinois la reconstruisent en pierre de taille et elle est reliée par un mur crénelé aux camps retranchés qui couronnent les collines. Les commissaires chinois tiennent absolument à ce que la porte et le mur crénelé ne soient pas la ligne frontière; ils veulent au moins quelques mètres de terrain inculte situé en avant. On se rend sur les lieux, et comme concession grande de notre part et dont nous nous targuerons sans cesse dans la suite nous convenons que la frontière suivra le ruisseau qui passe au pied des collines de la Porte de Chine, à cent cinquante mètres environ en avant de cette porte. Telle fut ce que j'appellerai la première séance de délimitation, six mois après notre départ de France, trois mois après notre arrivée à Dong-long.
Le lendemain, les commissaires des deux nations, moins leurs présidents, se mettaient en route vers l'ouest de la Porte de Chine. accompagnés des officiers topographes. Les deux escortes marchaient séparément; nous étions accompagnés d'une section du 23e de ligne, d'une compagnie de tirailleurs annamites, d'une vingtaine de chasseurs d'Afrique commandés par le lieutenant Hairon, et de coulis portant les vivres et les bagages. Les deux commissaires chinois Li-Hing-Joueï et Wang, accompagnés de l'ingénieur Li comme interprète et de M. James Hart comme conseiller, étaient portés par une centaine de réguliers; mais leurs domestiques, leurs porteurs, leurs secrétaires, leurs chaises et leurs nombreux bagages leur faisaient une suite bien plus nombreuse que la nôtre.
La route est un sentier frontière, où l'on peut rarement marcher deux de front, et où les chaises à porteurs des commissaires chinois avançaient difficilement. De temps en temps, près des points qui nous passaient importants, comme faciles à reconnaître sur la carte ou à décrire dans un procès-verbal, nous attendions nos collègues chinois, nous nous mettions d'accord avec eux et nous repartions sur nos petits chevaux, pour nous mettre en avant de la colonne. Afin de ménager réciproquement notre prestige près des populations, nous étions convenus que, tant que nous marcherions sur le territoire annamite, la délégation française précéderait la délégation chinoise, et que l'inverse aurait lieu quand nous serions sur le territoire chinois. Les étapes, dans ces conditions, ne pouvaient être bien longues, d'autant que le terrain, accidenté, formé de collines schisteuses, recouvertes d'argile, était extrêmement glissant.
La première journée se fit cependant sans autre accident que la perte de mon chien. Il était de cette espèce comestible que l'on vendait sur le marché de Dong-Dang : s'étant un peu écarté de moi pendant la route, il dut fournir à l'un de nos coolis ou à ceux des Chinois un succulent repas pour le soir.
Les villages de Thôs sont assez rapprochés les uns des autres dans cette région; nous en traversons trois dans la journée. L'Illicium anisetum est cultivé partout, et autour de chaque village on aperçoit sur le penchant des collines ses bois élégants. Ce qui nous frappe surtout pour un pays aussi habité, c'est l'absence totale de pagode ou de tout monument religieux autre que les tombeaux. Ceux-ci, placés dans des lieux assez éloignés des villages, sont réunis dans des bosquets fourrés, ombragés d'immenses banians; on y pénètre par des sentiers étroits, et au centre se trouve un espace libre avec un petit édicule en forme de pagode, sans aucune idole; on y remarque des traces de feu, et des résidus de victuailles, restes des sacrifices que les Thôs viennent faire en ces lieux. Nous remarquons dans la journée plusieurs de ces bois sacrés. A trois heures nous nous arrêtons au village de Chinong, et nous nous installons avec notre escorte dans ce village à moitié désert; 1e colonel Tisseyre, qui remplaçait notre président, avait désigné, à peu de distance de là, le village plus riche de Naphï comme campement aux commissaires chinois et à leur escorte, que nous devions regarder comme des hôtes tant due nous voyagerions sur le territoire annamite.
Avant la nuit, les deux délégations se rendent ensemble à la Porte de Chine d'Aïro dont elles reconnaissent ensemble la position. Quand nous revenons au village, nos gens ont déjà établi leur campement; comme il fait beau, les coulis se sont installés en dehors des cases et ils passent la nuit à la belle étoile autour des grands feux qu'ils ont allumés, causant, riant et chantant bien avant dans la nuit, et nous empêchant de goûter un repos bien mérité, jusqu'à ce due, impatienté, après les avoir fait avertir plusieurs fois, l'un de nous se lève et, saisissant dans leur feu de bivouac un brandon enflammé, leur fait une véritable chasse pour les éloigner de la case en paillote que nous occupions et que nous pouvions craindre à chaque moment de, voir incendiée par leur imprudence.
Le lendemain matin nous nous réunissons eu conférence et nous nous apercevons que, malgré cette manière de procéder sur les lieux, qui devrait écarter tous malentendus, nous n'en avons pas encore fini avec les discussions oiseuses et irritantes; on se met en route sans avoir pu tomber d'accord et l'on suit un sentier plus difficile que la veille.
Le pays est plus accidenté, les collines plus élevées et les bas-fonds occupés par de véritables fondrières; les sentiers, taillés le plus souvent à flanc de coteau, ont été ravinés par les premières pluies de l'hivernage; souvent ils n'ont conservé que juste la largeur qu'il faut à nos chevaux pour poser 1e pied. On marche lentement à la file indienne, et quand le pays est découvert, cette caravane ne manque pas de pittoresque. L'uniforme bleu des chasseurs d'Afrique qui nous accompagnent, montés sur leurs beaux chevaux arabes,, se détache vigoureusement sur le paysage un peu jaune; puis viennent les tirailleurs annamites, plus loin la langue ligne des coulis, portant en guise de manteau leurs couvertures rouges, les soldats du 23e de ligne à 'arrière-garde, avec leurs casques blancs, et derrière, quand la vue s'étend assez loin, les. réguliers chinois portant la chlamyde range ou bleue, avec une large lune blanche sur la poitrine, puis enfin les palanquins de nos collègues chinois, qui leur servent fort peu dans ces routes de montagnes.
Nos petits chevaux annamites sont habitués à ces chemins, et nous admirons comment les chevaux des chasseurs arrivent à passer dans des endroits où l'on croirait qu'une chèvre s'en tirerait à peine.
VII
Conférence près de la Porte d'Ailoa. - Signature du premier - procès-verbal à Khodien.
Le 24, la route est meilleure jusqu'au village de Bakkat, où nous arrivons de bonne heure, et où nous nous installons. A deux kilomètres se trouve la Porte de Chine d'Ailoa; les commissaires chinois nous demandent de les accompagner jusque-là; ils doivent aller passer la nuit en Chine, dans un village voisin de la frontière. Nous continuons donc notre route, qui, à partir du village, devient détestable; nous traversons un cours d'eau encaissé, puis des fondrières situées au pied de la colline élevée et escarpée où se dresse la Porte d'Ailoa.
En traversant une fondrière, le cheval de M. Haïtce roule avec son cavalier, et celui-ci se relève couvert d'une boue noire et visqueuse. Nous ne pouvons cependant nous passer en ce moment de M. Haïtce, qui seul sait le chinois; la situation est délicate, il s'agit de s'entendre sur le premier procès-verbal de délimitation, et depuis deux jours on discute sans résultat sur la manière dont on désignera le lieu ou (endroit situé cinquante mètres de la Porte de Chine sur la route de cette porte à Dong-dang, au point où cette route est coupée par un ruisseau! On est parfaitement d'accord sur la carte pour vouloir désigner le même, point, mais les commissaires chinois refusent toutes les manières dont nous proposons de désigner ce lieu, sans vouloir en proposer une eux-mêmes. Nous sommés obligés de nous demander si norme sommes pas dupés, et si toute notre bonne volonté et nos peines aboutiront à faire enfin apposer sur un procès-verbal raisonnable les signatures de nos collègues à côté des nôtres.
Aussi, sans pouvoir même se laver la figure, souillée de vase, ce brave M. Haïtce nous accompagne jusqu'au haut de la colline, et là, mouillés tous jusqu'à la ceinture, à cause du passage de la rivière, on discute au grand air, assis sur des bancs de bois près de la porte, de quatre heures de l'après-midi jusqu'à la nuit noire. Il fait une brise aiguë, nous sommes glacés et affamés; les commissaires chinois ne se rendent pas; ils nous font servir une soupe chaude de fruits de nénuphar. et enfin, vers huit heures, on arrive à se mettre d'accord sur une des manières de désigner le point en question, manière qui depuis deux jours avait été vingt fois proposée. Nous faisons immédiatement un brouillon de procès-verbal; nous ferons le soir les deux copies en français, ils feront les deux copies en chinois; et l'on se sépare transis de froid mais avec la promesse solennelle de signer dès le lendemain matin les procès-verbaux.
Il fait nuit. il faut redescendre la colline à pic, repasser les fondrières, traverser la rivière, et cela parait à peu près impossible; il le faut cependant bien, car nos deux procès-verbaux et les cartes en double doivent être prêts pour le lendemain matin, avant que les commissaires chinois, qui nous ont fait affirmer par M. Hart et par l'ingénieur Li que l'accord était fait, puissent revenir sur leur parole. Heureusement nos chasseurs d'Afrique n'ont pas perdu leur temps : pendant notre discussion, aidés de quelques coolis armés de pelles et de pioches, ils ont placé des fascines dans les fondrières, adouci les pentes abruptes de la rivière, modifié les passages les plus dangereux, et, malgré la nuit noire, nos petits chevaux nous ramènent sans encombre jusqu'au campement.
Nous avions donné rendez-vous aux commissaires chinois, pour le lendemain, au village de Khodien, afin d'échanger les procès-verbaux. C'est une longue opération de vérifier les quatre procès-verbaux (deux en français et deux en chinois) et les deux cartes, et d'y apposer, nous nos signatures, et les commissaires chinois leurs signatures et leurs sceaux.
Sachant bien que nos collègues ne se lèvent pas de bonne heure, nous ne partons qu'à huit heures du matin, et nous arrivons à neuf heures à Khodien sous une pluie battante. Il fait si obscur dans l'intérieur des quatre ou cinq maisons qui composent ce village, et les chambres nous paraissent tellement sordides, que nous-faisons prolonger le toit par quelques vieilles paillotes tout enfumées, que l'on trouve à grand’ peine et qui laissent bientôt passer de grosses gouttes de pluie. On installe quelques planches pour servir de bancs et de tables sous cet abri improvisé, et nos collègues ne tardent pas à arriver mouillés, crottés, malgré leurs chaises à porteurs, mais toujours gais, avenants et de bonne humeur.
On se communique réciproquement les procès-verbaux. Ceux en chinois sont minutieusement vérifiés par M. Haïtce, et ceux en langue française, avec les cartes de la Porte de Chine à la porte d'Aïro, dont les noms sont à la fois en caractères français et en caractères chinois, sont scrupuleusement examinés par MM. Hart et Li. On s'ingénie pour abriter ces précieux papiers des taches d'eau souillée de suie qui tombent de tous côtés, mais une tournure de phrase française de notre procès-verbal éveille les susceptibilités de l'ingénieur Li ; les commissaires chinois ne signeront pas si l'on ne change ce membre de phrase, qui d'ailleurs n'a pour nous aucune importance. Le capitaine Bouinais, le meilleur calligraphe parmi nous (le secrétaire était resté avec le président à Dong-dang), recopie les deux procès-verbaux en français, et sous une pluie diluvienne on arrive vers midi à avoir apposé ses signatures sur les premiers procès-verbaux, accompagnés de cartes, de la délimitation du Tonkin. Chaque délégation garde un procès-verbal en chaque langue et une carte, dressée et dessinée par nos officiers topographes, où tous les noms des points que nous avons vus ensemble sont désignés en lettres françaises et en lettres chinoises. C'est là une bonne et utile besogne
elle n'est pas considérable, il est vrai, mais elle est définitive, c'est un gage pour l'avenir; puis elle nous a donné tant de peine, que nous en sommes réellement fiers et que nous buvons de bon cœur un verre de champagne avec nos collègues chinois, qui paraissent aussi heureux que nous.
Le 26, nous partons à huit heures. Le chemin est meilleur, le pays plus peuplé; â onze heures nous nous arrêtons au grand village de Connang, où nous attendons les commissaires chinois, et nous nous mettons assez facilement d'accord sur le procès-verbal de délimitation entre les portes d'Aïro et d'Aïloa. A partir de ce point nous nous éloignons de la frontière; nous sommes au pied d'un grand massif montagneux qui domine tout le pays et que l'on aperçoit bien de la citadelle de Lang-son, le mont Mauson. Ce massif fait tout entier partie du Tonkin; il serait bien intéressant à explorer; mais au point de vue de la délimitation il n'y a aucune contestation, et nous ne pouvons songer à nous y engager, surtout à cette époque de l'année, avec une escorté aussi nombreuse.
VIII
Phodeng - Le Mauson - Voyage sur territoire chinois - Nathong
Pour contourner le Mauson en restant sur le territoire tonkinois, il faudrait retourner presque jusqu'à Lang-son. Un convient donc de le contourner en passant sur le territoire chinois. L'après-midi, laissant les Chinois à Connang, nous allons nous installer dans un beau village bâti en briques et en tuiles et ayant un marché pavé: c'est le village de Phodeng. Là nous trouvons un convoi de vivres, qui nous a été envoyé de Lang-son., sous la conduite d'une compagnie de tirailleurs tonkinois, et une compagnie du bataillon d'Afrique qui vient remplacer les soldats du 23e de ligne rappelés en France. Ce n'est pas sans regrets que nous voyons s'éloigner la compagnie du 23° de ligne et remplacer les soldats du recrutement qui la composent, toujours si disciplinés, si vaillants et si ponctuels dans leur service, par les hommes du bataillon d'Afrique que l'on désigne encore sous les noms de Joyeux ou de Zéphyrs.
Pour préciser suffisamment le tracé de la frontière; comme il n'y a aucune contestation au sujet d'une porte assez éloignée, on envoie les officiers typographes accompagnés par les topographes chinois pour reconnaître la frontière. Nos collègues avaient en effet avec eux une douzaine de jeunes gens sortant des différents arsenaux de l'empire et qu'ils intitulaient officiers topographes; nous devons dire qu'à part deux d'entre eux, qui avaient passé quelque temps en Amérique et qui parlaient un peu anglais, les autres, au dire des officiers topographes français, qui ont eu occasion de les voir à l'oeuvre, paraissaient ne pas savoir seulement lire une carte.
Le 17, nous partons donc d'un côté et nos officiers topographes de l'autre; nous nous rendons directement au village de Napia, non loin de la porte de Naki, par laquelle nous devons pénétrer en Chine. Comme toutes les autres dont nous avons parlé jusqu'ici, à part celle de Che-nan-quan, c'est une simple porte en bambou reliée par des palissades aux deux mamelons qui dominent le défilé où elle est située.
Nous avions monté constamment depuis deux jours, et, malgré la saison déjà avancée, le thermomètre variait dans la journée entre onze et treize degrés. Assemblés en plein air près de la porte, on vérifie les deuxièmes procès-verbaux et les cartes annexées: , on convient que l'on est d'accord sur chaque mot, et l'on se retire chacun de son côté, les Chinois en Chine, où nous irons les rejoindre le lendemain, et nous au village de Napia.
Tous ces villages sont, avons-nous dit, habités par des Thôs, dont le langage contient un grand nombre de mots siamois ou plutôt laotiens ; aussi est-ce sans étonnement que nous retrouvons ici les noms des villages précédés du mot Na, qui veut dire « rizière » près de Luang-Prabang; autrefois, sur la rive droite du 'Mékong, nous avons passé par une série de villages appelés Nalê, Napê, Nala, etc…..
Le 18, sous une pluie battante nous pénétrons dans le défilé de Nakiaî; après la porte, le sentier devient des plus dangereux; nous descendons très rapidement sur une argile glissante, tenant nos chevaux par la bride, et nous arrivons, transpercés par la pluie, au village chinois de Nathong, vers dix heures et demie du matin. C'est un pauvre village, ne contenant que quelques misérables cases en paillotes; les commissaires chinois ont dressé leurs tentes, trouvant les cases trop peu commodes, et en ont fait monter une très vaste et très confortable pour nous, avec des claies de bambous pour nous servir de lits.
Dès notre arrivée nous nous réunissons dans la tente de Wang pour signer le deuxième procès-verbal, sur lequel on s'était mis d'accord précédemment. Wang eut l'heureuse inspiration pendant ce temps de nous faire servir un bol de potage fort chaud et fort épicé, composé de vermicelle, de riz, de poisson et de jambon finement hachés, qui, peut-être à cause de la circonstance dans laquelle il nous était servi, nous parut infiniment supérieur à tous les mets chinois que nous ayons jamais goûtés.
L'après-midi était splendide. Les commissaires chinois nous avaient avertis que nous pouvions sans inconvénient circuler partout où nous voudrions, et comme il fallait passer la journée à Nathong pour attendre les officiers topographes, nous partîmes, sous la conduite d'un officier chinois, faire une longue promenade aux alentours.
Au pied du Mauson, qui s'élève au sud-ouest comme une muraille à pic, formant une frontière naturelle indiscutable, s'étend du côté de la Chine une vaste plaine bien cultivée, semée de nombreux villages et parcourue par une petite rivière qui coule presque parallèlement à la frontière vers le nord et se rend à la sous-préfecture chinoise de Ning-ming-chéou, d'où elle se jette dans le fleuve de Canton, dont elle est un affluent. Nous suivons le cours d'eau en le remontant et en le passant plusieurs fois à gué sur de grosses pierres jusqu'à un village de quelques centaines d'habitants. Les hommes d'abord, puis les vieilles femmes, enfin toute la population, sortent du village pour venir examiner de près ces diables étrangers qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Il n'y a aucune malveillance dans leur curiosité, et, après que nous eûmes distribué quelque menue monnaie aux petits enfants, nous fûmes tout à fait en pays ami.
Cette population est toute différente des Thôs : le type chinois s'accentue, le nez est plus épaté, les pommettes plus saillantes, la face plus carrée, les yeux plus bridés.
Les maisons ne sont pas bâties sur pilotis, mais au ras de terre, et près de l'entrée du village on remarque une pagode bouddhiste. M. Haïtce ne parvient pas à se faire comprendre en employant la langue mandarine; ils ne parlent pas cependant la langue des Thôs, mais la langue cantonnaise, qui diffère complètement du chinois du Nord.
Quand nous regagnons le campement, il fait presque nuit, et les huit trompes des commissaires chinois sonnent la retraite avec un bruit formidable. Nous avions souvent entendu le soir, à Dong-dang, le son de ces trompes à la Porte de Chine, mais nous n avions jamais assisté de près à cette cérémonie. Huit soldats en tenue de réguliers et portant sur la poitrine le nom du commissaire auquel ils appartiennent sont alignés devant les vastes pavillons chinois plantés devant leurs tentes. Armés d'immenses instruments de plus de deux mètres de long., semblables à la trompe allégorique dont on arme la Renommée, ou à celles que donnent les artistes aux anges du jugement dernier, ils poussent avec assez d'ensemble des sons étranges qui s'entendent de fort loin, alternativement très aigus et très bas, en levant vers le ciel dans la direction du soleil couchant ou en abaissant vers la terre les pavillons de leurs instruments.
Notre première nuit en Chine -se passe sans incident, sous la tente que nous a fait établir S. E. Wang; et le matin avant le jour nous sommes réveillés en sursaut par le bruit éclatant des trompettes qui saluent le soleil levant.
Le 29, dans la matinée, nos officiers topographes arrivent sous une pluie torrentielle; ils ont vérifié, de concert avec les topographes chinois, le point qu'il s'agissait de déterminer, mais ils n'ont pas trouvé d'abri pour la nuit et ils arrivent harassés de fatigue. La pluie tombe avec une telle abondance que notre tente ne nous préserve bientôt plus et qu'un véritable torrent creuse son lit au milieu e!: monde tous nos bagages.
Vers midi le soleil se montre; on peut faire enfin la cuisine; nous déjeunons en compagnie des officier topographes et des officiers de l'escorte, puis à une heure, nous nous mettons en route, mais non sans avoir donné le temps au lieutenant de chasseurs Hairon de photographier le campement de Nathong et les commissaires chinois.
Le colonel Tisseyre pressait le départ malgré la fatigue de ceux qui étaient arrivés le jour même. Le village de Nathong était en effet bien petit. et, pour chercher un abri contre la pluie, nos soldats et les réguliers chinois, puis les coolis chinois et nos coolis annamites, se trouvaient mélangés et pressés les uns contre les autres; il était prudent de faire cesser au plus tôt cet état de choses.
L'après-midi fut splendide; nous traversons par une belle route la plaine, en une heure et demie, en suivant le Mauson, passant près d'un petit torrent qui se précipite en cascade du sommet d'un contrefort du Mauson d'une hauteur de plus de cinquante mètres. et nous sortons de Chine à. deux heures trente, par la porte de China, située dans un défilé élevé ii peine d'une soixantaine de mètres au-dessus de cette plaine.
IX
Porta de Chima - Phaïsan -Vi-Van-Li - les Mans - Retour à Dong-dang.
Près de cette porte, qui commande la route faisant communiquer Anchau, Tien-yen et Lang-son à Sening-chéou, nous traversons un camp retranché, et mie centaine de réguliers chinois on armes viennent se ranger de chaque côté de la route pour nous rendre les honneurs. Nous apprenons que le gouverneur du Kouangsi, Li-Ping-Heng, qui ne nous a pas accompagnés surla frontière, est arrivé à Chima la veille en passant par Sening-chéou. Ce gouverneur, qui faisait partie de la commission de délimitation, devait signer les procès verbaux, et nous craignions fort qu'il ne nous fit attendre plusieurs jours sa présence.
Le village annamite de Phaïsam se trouve il un kilomètre et demi environ de la porte de Chima; c'est là que nous devons nous établir, pour être à portée des commissaires chinois qui le jour même viendront s'installer au camp retranché de Chima . Près de la porte du village, un vieillard annamite chef de canton qui a une grande influence dans la contrée, le vieux Vi-Van-Li, s'avance vers nous accompagné d'une vingtaine de miliciens assez mal armés et précédé du pavillon du protectorat, jaune avec le yacht français.
Les habitants de Phaïsam sont en majeure partie des Thôs; nous leur demandons des renseignements sur les populations qui habitent le Mauson, et l'on nous amène un montagnard de ces villages qui, sur l'invitation de Vi-Van-Li, promet qu'il reviendra le lendemain avec quelques hommes et quelques femmes de son village. Le reste de la journée se passe à soigner les malades de notre escorte, qui sont assez nombreux. Les soldats du bataillon d'Afrique, fatigués déjà par un long séjour au Tonkin et, il faut bien le dire, par le dur régime disciplinaire auquel on est bien forcé de les soumettre, se traînaient avec peine; pendant la dernière étape plusieurs furent atteints assez gravement d'accès pernicieux, et l'un d'eux mourut dans la nuit. Ces malheureux, dont la plupart provenaient des prisons centrales et des maisons de correction, se battent, dit-on, fort bien; mais en campagne on ne se bat pas tous les jours, et chaque jour il faut marcher, se fatiguer, veiller et obéir : or on ne peut obtenir tout cela de ces pauvres gens que par une discipline de fer trop souvent incompatible avec les prescriptions de l'hygiène.
Le 30 mars, les commissaires chinois que nous avions laissés à Nathong nous font prévenir de leur arrivée à la porte de Chima. M. Hart et l'ingénieur Li viennent préparer avec nous le procès-verbal, et dans l'après-midi, sous une pluie battante, MM. Haïtce et Neis retournent à la porte de Chima pour vérifier avec les Chinois l'exactitude et la concordance des procès-verbaux et des cartes que nous devons signer le lendemain. En revenant à Phaïsam, la pluie a cessé, et Vi-Van-Li nous amène quelques Mans du Mauson accompagnés d'une femme.
Ces montagnards, qui reconnaissent l'autorité des Annamites, sont de petite taille, - la femme n'avait qu'un mètre quarante, - robustes, leurs mollets sont développés, leurs épaules larges, la face ressemble à celle des Tbôs, mais avec un nez plus proéminent et un teint plus clair. Comme ces derniers ils logent dans des maisons bâties sur pilotis, mais toujours dans l'intérieur des massifs montagneux. On ne peut se rendre chez eux que par des sentiers très escarpés : aussi ne possèdent-ils ni chevaux ni buffles; ils portent leurs fardeaux dans des hottes semblables à celles de tous les montagnards indochinois, c'est-à-dire retenues sur le dos par deux bretelles passant sur les épaules et une troisième passant sur le front comme un bandeau. Ils étaient habillés chaudement et proprement, d'un pantalon de grosse cotonnade bleue, bordé dans le bas d'une bande de broderie rouge et jaune., à dessin assez original, et d'une veste carrée entourée d'une broderie semblable; les cheveux, roulés sur le sommet de la tête, étaient retenus par un turban bleu bordé de la même façon. La femme, âgée d'une quarantaine d'années, portait une coiffe formée d'un rectangle de cotonnade bleue aux quatre coins duquel pendaient de longs rubans de coton blanc. La robe, croisée sur le devant et entourée d'une broderie, laissait voir un cache-sein semblable à celui que portent les femmes annamites, formé d'une grande bavette brodée de rouge et d'argent. Leur langage ne paraît avoir aucun rapport avec celui des Thôs; les Annamites et les Chinois ne le comprennent que d'une façon générale.
Un jeune homme intelligent de race thô, qui nous rendit, comme guide et comme interprète, les plus grands services pendant cette partie du voyage, connaissait presque tous les dialectes de la frontière. Avant notre arrivée il avait été doï des tram, pour le gouvernement annamite, sur cette partie de la frontière, et chargé en cette qualité de fournir des tram (porteurs de dépêches) aux autorités annamites dans leurs relations avec la Chine; plus tard, sur les frontières du Yunnan, nous nous aperçûmes qu'il comprenait aussi la plupart des dialectes muongs, qui ne sont que des patois dérivés du siamois, comme le laotien.
Le 31, nous nous rendons à la porte de Chima et l'on signe sans trop de difficultés les procès-verbaux et les cartes de la porte de Naki à celle de Chima; le gouverneur du Quang-si lui-même appose sa signature et son cachet sur les procès-verbaux des trois sections. que nous avions dressés et signés en route, mais cette opération n'a pas l'air de lui agréer beaucoup; il signe avec une telle mauvaise grâce, que ses collègues, Wang et Li-Hing-Joueï, crurent devoir l'excuser après qu'il se fut retiré, sans même nous saluer, en nous expliquant que S. E. Li-Ping-Heng ne s'est jamais encore trouvée en relations avec des Européens et que c'est à l'ignorance de nos usages et non à l'intention de nous froisser que nous devons attribuer ses étranges manières.
De Chima à Dong-dang et à la Porte de Chine, où nous devons retourner pour retrouver les deux présidents et continuer la reconnaissance de la frontière vers le nord-est, la route est plus courte et plus praticable en passant par Lang-son que par Se-ling-chéou. Aussi; pendant que nous étions leurs hôtes, avions-nous offert aux commissaires chinois de passer avec nous par cette voie, et ils avaient accepté avec beaucoup de plaisir. Au moment de partir ils nous firent annoncer qu'il leur était impossible de profiter de notre offre obligeante, et nous restâmes persuadés que ce refus était suggéré par le gouverneur du Kouang-si, qui venait peu auparavant de refuser au président de la délégation française l'autorisation de me rendre à Long-chéou.
Long-chéou, situé sur la Rivière de Gauche, branche du Li-kiang au confluent du Song-ki-kong, rivière de Lang-son, et de celle de Cao-bang, a servi pendant la guerre de magasin général et de base d'opérations aux troupes chinoises du Kouang-si ; cette ville est destinée par sa position à devenir l'un des points ouverts au commerce entre la Chine et le Tonkin; il y avait donc intérêt à la visiter et à se rendre compte de sa position, de ses ressources et de sa facilité de communication avec le reste de la Chine. Le gouverneur du Kouang-si prétexta que, tant que la délimitation ne serait pas achevée, il lui était impossible d'autoriser un Français à passer en Chine par la voie de terre, fût-ce un membre de la commission de délimitation. Je dus en conséquence renoncer à mon projet de voyage.
En deux petites journées de marche nous fûmes de retour à Lang-son, contournant les contreforts sud-ouest du Mauson, au pied duquel coule le Song-ki-kong. La route, en assez bon état d'ailleurs, est taillée en corniche, surplombant le fleuve sur une grande partie du parcours; la vallée s'élargit à mesure que l'on s'approche de Lang-son ; les villages, nombreux et fort peuplés, sont ici habités par des Annamites, les Thôs sont en minorité, et l'on rencontre des pagodes bouddhistes. dont quelques-unes de construction assez soignée.
A Lang-son nous retrouvons le président de la commission, qui est venu de Dong-dang au-devant de nous pour nous féliciter de notre succès, qu'il avait d'ailleurs si bien préparé; son inaction forcée pendant ces quelques jours lui avait été pénible, et il se promet bien désormais de nous accompagner dans la suite de la reconnaissance de la frontière.
Depuis trois mois que Lang-son a été réoccupé, le colonel Crétin, qui de Hanoï est venu s'établir à Langson, a changé complètement l'aspect de la ville.
Les ruines ont été déblayées, l'intérieur de la citadelle débroussaillé, et les troupes occupent maintenant des logements convenables; les jardins potagers, cultivés dès l'arrivée, sont en plein rapport, et, le long de la muraille ouest de la citadelle, dans un emplacement naguère couvert de décombres et de broussailles, la vue se repose avec plaisir sur un vaste champ d'avoine, qui parait donner les meilleures espérances. C'est un essai de culture qui n'est pas sans importance, car la nature du terrain et la température fraîche qui règne dans cette région pendant trois ou quatre mois de l'année peuvent faire espérer que la culture des céréales y donnera de bons résultats.
Malgré l'aimable accueil qu'on nous fit à Lang-son, nous repartîmes le lendemain matin; et le 2 avril nous étions arrivés à Dong-dang.
Nous ne devions pas d'ailleurs y séjourner longtemps. Les commissaires chinois, qui avaient eu à parcourir un chemin bien plus long que le nôtre, arrivèrent le 5 à la Porte de Chine, et il fut convenu que dés le 7 on se mettrait en route, pour reconnaître la frontière du nord-ouest de la Porte de Chine, jusqu'au point où le Song-ki-kong (rivière de Lang-son) entre en Chine. La température s'élevait, les pluies commençaient à devenir incessantes, il ne fallait pas perdre de temps.
X
Délimitation des environs de la Porte de Chine - En route pour Binai - Phiamet.
Nous avions, vingt fois et plus, parcouru, seul ou en compagnie de M. Balansa, le botaniste, ou de notre collègue le capitaine Bouillais, le massif calcaire situé au nord-ouest de la Porte de Chine ; nous en connaissions bien tous les sentiers ; conduisant à une série de cirques, qui. à première vite, semblent inextricables: mais quand il fallut, le 7 au matin , parcourir ces collines avec les commissaires chinois; pour déterminer la ligne frontière, ce ne fut pas une besogne facile. Les chaises encombrantes de nos collègues ne pouvaient passer dans ces sentiers de montagne; ils étaient obligés de faire de longs détours: puis ils s'obstinèrent si bien à la recherche d'un village, Signalé par le sous-préfet (Tchéou) de Pin-tsiang, village détruit depuis longtemps et dont on ne put jamais nous indiquer l'emplacement, que, partis à six heures du matin de Dong-dang, nous nous trouvions tous vers deux heures sur la route de That-ké, à moins de huit kilomètres de notre point de départ; près de la porte de Kida. Le thermomètre marquait vingt-huit degrés à l'ombre, et nous avions été forcés de faire les trois quarts de la route à pied.
La porte de Kida, simple barrière en bambou, placée dans un étroit défilé, se trouve à cinq cents mètres environ de la route de Dong-dang à That-ké ; après l'avoir reconnue; nous revenons affamés à Dong-dang, où nous retenons les commissaires chinois à déjeuner avec nous.
Le lendemain 8, nous repartions, accompagnés cette fois par notre président, qui aima mieux suivre la frontière jusqu' à Binhi que de s'y rendre directement par le plus court chemin, comme. le faisait S. E. Teng, le président de la commission chinoise.
Une question d'une certaine importance devait d'ailleurs de résoudre pendant ce trajet : à plusieurs reprises, les habitants de quatre villages annamites étaient venus réclamer près de nous, nous avertissant que lu mandarin de Pin-tsiaug avait déplacé la porte de Bo-chaï de telle façon que leurs quatre villages se trouvaient, contre tout droit, enclavés dans la Chine. Il fut convenu que les officiers topographes des deux delégations contourneraient le massif calcaire qui forme la frontière du côté du Tonkin, tandis que les commissaires passeraient par la Chine et se rendraient directement à la porte de Pakéou-aï, que les mandarins de Pin-tsiang nous affirmaient n'être pas distante de plus de vingt li, dix kilomètres ) de la Porte de Chine.
Nous partîmes donc avec une faible escorte, laissant notre convoi et nos bagages prendre la route de That-kê et donnant rendez-vous au capitaine Quénette, qui commandait le détachement, au village de Ban-tao, qu'on nous affirmait devoir être tout proche de la porte de Pakéou-aï.
La première partie de la journée fut fort agréable le temps était beau, la route à peu près praticable; la population, assez dense près de la Porte de Chine, accourait avec curiosité sur notre passage.
Nous passâmes non loin du village de Ban-bo, qui avait été le théâtre du combat opiniâtre où tombèrent le lieutenant Normand et plusieurs de nos compatriotes.
Sur la demande du colonel Tisseyre, notre collègue chinois Li-Hin-Joueï avait fait. quelque temps auparavant, réunir les corps d'une dizaine de Français morts dans ce combat, et leur avait fait donner une sépulture convenable; mais nous ne pûmes visiter ce lieu qui se trouvait trop éloigné de notre route.
Vers midi nous nous arrêtâmes, pour déjeuner; dans une vaste rizière, sur le bord d'un cours d'eau; nous ne devions pas être; à notre estime, loin de Bau-tao et par conséquent de Pakéou-aï; mais aucun de nous ne connaissait le pays, et en l'absence de nos officiers topographes nous étions obligés de nous fier au guide donné par le mandarin de Pin-tsiang. En réalité nous étions à quelques minutes de Ban-tao et des quatre villages dont nous voulions appuyer les réclamations; mais fort loin encore de Pakéou-aï ; nous nous figurions être encore en Chine, et nous étions au Tonkin Le mandarin de Pin-tsiang, qui conduisait nos collègues Li et Wang, ne les laissa pas se concerter avec nous et nous fumes obligés de continuer notre route sous la direction du guide chinois.
Le sentier étroit et accidenté qu'il nous fallut suivre est difficilement praticable en temps ordinaire; mais en ce moment une pluie fine et serrée qui se mit, à tomber tout l'après-midi nous rendit le voyage des plus pénibles. Malgré leur habileté, nos petits chevaux glissaient sur l'argile humide ou s'embourbaient dans les rizières, et à chaque instant l'un de nous roulait dans la vase avec son cheval. Ces chutes étaient en général peu dangereuses, mais au bout de peu d'heures nous étions tous couverts de boite des pieds à la tète. La nuit approchait et nous n'arrivions toujours pas à Pakéou-aï. Nous commencions à craindre qu'il eut fallut renoncer, ce soir-là, à voir arriver nos bagages et le reste de notre escorte ; nous rejoignîmes enfin près du fort de Kéo-cho nos collègues chinois Wang et Li qui avaient été trompés comme nous; par le mandarin de Pin-tsiang; sur la distance à parcourir; et qui nous firent toutes leurs excuses; leur voyage avait été aussi accidenté que le nôtre et ils n'étaient guère moins souillés de boue. Ils nous offrirent de venir passer la nuit en Chine, au village de Pioko, à quelques kilomètres du fort de Kéocho, mais nous voulions nous éloigner le moins possible de notre escorte et de nos bagages que nous espérions toujours voir arriver, et nous nous établîmes dans le pic pauvre village de Phiamet.
C'est un petit village thô, composé de quelques cabanes mal recouvertes en paillotes; nous ne pûmes nous y procurer que du riz, des poulets et de l'eau fort peu potable. La vieille femme qui habitait notre case nous fit de son mieux une cuisine annamite, à laquelle nous ne fimes guère bonheur, empoisonnés, comme nous l'étions tous, plus on moins, par les émanations des marécages dans lesquels nous avions pataugé durant la journée. Ne pouvant changer de vêtements, on alluma un grand feu au milieu de la case; on se rangea tout autour pour sécher les habits; chacun essaya de dormir sur la paille. sans couverture, mais ou y réussit fort mal, et plusieurs d'entre nous furent pris, de fièvre et de vomissements bilieux.
Dans la soirée nous vîmes arriver l'ingénieur Li avec quelques soldats chinois, nous apportant des provisions de de la part de nos collègues étrangers qui avaient appris que nous n'avions pas réçu nos bagages; ils nous faisaient en outre renouveler leurs regrets et leurs excuses. L'ingénieur Li avait fait, pour nous apporter ces provisions, plusieurs kilomètres dans la rivière par une nuit noire et un temps détestable, et elles arrivaient trop tard pour nous être bien utiles, à part cependant quelques bouteilles de champagne. qui firent le plus grand bien à nos malades.
Le lendemain, 9 avril, il fallut séjourner à Phiamet, peur attendre notre escorte et nos bagages; dans la nuit on avait envoyé un habitant du village au capitaine Quénette pour l'avertir de venir nous rejoindre. Ils arrivent dans la matinée, mais les porteurs étaient harassés de fatigue, et l'on ne pouvait songer à leur faire parcourir une autre étape dans la journée. Les commissaires français profitèrent de ce séjour pour fuir, comparaître et interroger 1e maire de Nathong chef-lieu de canton des quatre villages contestés, et celui-ci leur fournit des preuves convaincantes de la nationalité annamite de son village, aussi le pria-t-on de nous accompagner jusqu'à Binhi, où nous devions définitivement rédiger et signer le procès-verbal de la délimitation de cette région.
Le 10 on ne fit guère qu'une dizaine de kilomètres passant par une plaine assez sèche, parsemée de rocs calcaires comme aux environs de Lang-son. et au fond de laquelle on aperçoit les toits des pagodes de la ville de Pin-tsiang. Cette plaine est parfaitement cultivé et nous y trouvons, de vastes champs de sarrasin, déjà en fleur à cette époque de l'année ; il est d'ailleurs petit, peu fourni, et ne paraît pas promettra une belle récolte.
Dans l'après-midi nous retrouvons à Ban-cuyen nos collègues chinois et nous faisons déposer devant eux de maire de Nathong, auquel le mandarin de Pin-tsiang, qui voudrait bien l'intimider, ne peut répondre par aucun argument sérieux; les commissaires chinois conviennent assez facilement avec nous que la porte de Bo-chai a été indûment déplacée et que les quatre villages en litige sont et doivent rester annamites ; sur tout le reste du parcours, les topographes chinois ayant accompagné nos officiers topographes, l'accord parait devoir su faire sans difficulté quand nous signerons à Binhi les procès-verbaux et les cartes. Dans l'après-midi, nous passons en Annam, laissant les Chinois à Ban-cuyen, et nous, nous installons pour la nuit au village de Nappa.
XI
Binhi - Le Song-ki-kong. - Signature des proces verbaux - définitifs - retour à Hanoï
Dans ce village nous recevons de Lang-son et de Dong-dang des nouvelles alarmantes. Un fort parti de pirates est signalé sur la route de That-ké parlaquelle nous comptions revenir, et nous coupe le passage de ce côté ; notre escorte est bien faible, el les petites garnisons de That-ké et de Dong-dang, trop affaiblies pour la fournir, ne peuvent un ce moment prendre une offensive sérieuse . Le colonel Crétin nous avertit du nous replier le plus tôt possible sur Dong-dang par la route que nous venions de suivre. Il nous est impossible de nous conformer à cet avis car avant tout il faut nous rendre à Binhi, où le président de la délégation chinoise, Teng, doit nous attendre pour apposer sa signature sur les cartes et les procès-verbaux.
Le 11 on se met en route dès le point du jour. L'étape est longue et pénible dans ces sentiers défoncés ; nous passons en vue de plusieurs portes et forts chinois, et nous arrivons l'après-midi au village chinois de Binhi en chinois, Pigneur) sur la rive droite du Sing ki-kong.
Ce fleuve, que nous avions vu à peine navigable à Lang-son pour des pirogues ou des radeaux de bambous, paraît ici bien grossi; il a une largeur de soixante mètres environ et peut porter des jonques de moyenne taille. Le corrant est rapide, et un moins d'un jour on peut, par cette voie, se rendre à Long-chéou, point où ce bras se réunit à la rivière de Cao-bang pour former la Rivière de Gauche, branche du Si-kiang ou rivière de Canton.
Un barrage, maintenant en fort mauvais état, interrompait la navigation un peu en amont de Banni. Ce villages se trouvant en Chine, nous étions encore une fois les hôtes de nos collègue ; ils nous reçurent de leur mieux, nous installèrent dans une cabane en bambou doublée de toiles de tente, qu'ils avaient fait construire à notre intention; notre escorte campa dans une rizière sèche à l'entrée du village, et deux réguliers chinois furent placée à notre porte pour nous rendre les honneurs.
En face de Binhi le Song-ki-kong est bordé sur la rive gauche par des collines élevées, couronnées par une série de forts ou plutôt de camps retranchés, en avant desquels on remarque de petites tours carrée, peintes à la chaux et situées à mi-hauteur du versant. Ces camps retranchés défendent la route de Long-chéou.
Ici saison des pluies était décidément commencée, et dans la nuit du 11 il tomba, un véritable déluge. Les toiles de tente qui doublaient notre toiture en bambou furent vite traversées et bientôt il n'y eut plus un point de notre case où il ne plu autant que dehors ; réveillés en sursaut par cette douche froide. nous dûmes jusqu'au jour recevoir philosophiquement l'averse, grelottants, accroupis et enveloppés de nos couvertures mouillées . Nos hommes, campés dans la rizière, souffrirent encore plus que nous; il y eut un assez grand nombre de malades, et dès le lendemain un tirailleur annamite succomba à une pneumonie double. Ses camarades ne voulurent pas laisser son corps sur la terre chinoise et on l'inhuma à quelques kilomètres de là sur la terre annamite.
Le 12, toute la journée se passa à établir les procès verbaux, à en discuter les termes, et MM Haïtce, Hart et l'ingénieur Li vérifièrent minutieusement les traductions. Teng était arrivé, et nous espérions pouvoir signer immédiatement; mais au moment d'en finir et d'apposer leurs signatures, les commisaires chinois soulevèrent une multitude de difficultés de détail : on dut remettre la conclusion au lendemain, et nous pûmes craindre. un moment encore, que malgré nos efforts nous n'aboutirions à aucune solution. II fallait cependant se presser, le temps était précieux, notre colonne n'avait pu recevoir le convoi de vivres que nous attendions de That-ké, et nos approvisionnements touchaient à leur fin: chaque jour augmentait pour nous, le danger de trouver notre retraite sur Dong-dang coupée par les pirates et l'état sanitaire de notre petite troupe devenait de plus en plus mauvais. Atteint moi même d'accès bilieux et occupé à visiter nos malades sous leurs tantes on même étendus dans la boue, sous des abris de feuillage. pendant notre séjour à Binhi je m'occupai, je dois l'avouer, beaucoup plus de médecine que de la discussion des procès-verbaux.
Enfin. le 12, après avoir passé la matinée à remanier les procès-verbaux, on put croire qu'on allait les signer vers quatre heures de l’après-midi ; mais la discussion recommença de plus belle au dernier moment, et ce n’est qu'à onze heures du soir que tout fut terminé à la grande satisfaction des deux parties. On se passa ce soir-là de dîner, et, bien que couchés sur des claies de bambou, l'on s'endormit l'esprit tranquille et le coeur content. Nous avions réellement fait de bonne besogne ; notre président, qui venait d’être nommé ministre plénipotentiaire pouvait être justement fier du résultat, et nous avions le droit de songer à prendre jusqu'à la saison sèche un repos bien mérité.
Le 13, les commissaires chinois nous firent leurs allions dés le jour et partirent sur la route de Long-chéou au son de leurs trompes, précédés de tous leurs pavillons. Nous ne tardîmes pas à suivre leur exemple.
La route la plus commode et la plus sûre passant par la Chine; nos collègues nous donnèrent avant de partir un guide pour nous l'indiquer; nous n'avions plus maintenant à nous détourner de notre route ni à nous occuper de la frontière, aussi arrivâmes-nous en une seule journée au village de Phiamet, où nous avions passé de si durs moments quelques jours auparavant .
Eu passant non loin de la ville de Pin-tsiang, près du fort chinois de Kéo-cho, que traversait la routa le mandarin du fort vint au-devant de nous pour nous prier de rebrousser chemin : nous étions à peine à deux kilomètres de Phiamet, et il nous eût fallu faire un immense détour. Ce mandarin disait que n’ayant pas reçu d’ordre du sons-préfet de Pin-tsiang, il s’exposait aux plus graves punitions s'il ne s'opposait pas à notre passage. Nous eûmes beau parlementer; il se mit à genoux en travers de l'étroit sentier, barrant le chemin à M. Saint-Chaffray, qui nous précédait et il fallut que celui-ci fit mine de lui passer sur le corps pour le décidâmes à se ranger. Il supplia alors notre président de lui donner un certificat constatant que nous étions passés de force et malgré ses prières; on le lui promit volontiers, et nous passâmes par le fort de Kéo-cho dont le soldats vinrent curieusement assister au défilé de notre colonne.
Le retour à Dong-dang se fit sans autre incident, et nous y arrivâmes le 15 au soir. N'ayant plus rien à y faire, nous revînmes à marche forcée jusqu'à Chu. où nous trouvâmes une canonnière qui amena à Hanoi.
P. NEIS.